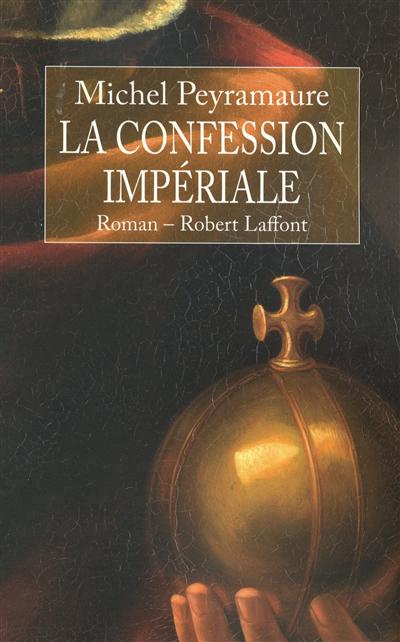![La confession impériale]()
La confession impériale
Palais impérial d’Aix : printemps 800
Je ne l’ai ni vue ni
entendue entrer dans mon cabinet. Alors que ma sieste quotidienne tire à sa
fin, rideaux tirés et fenêtre entrebâillée sur la chaleur moite de mai, elle a
grimpé sur mes genoux, légère comme un chat. C’est à peine, à demi endormi, si j’ai
perçu sa présence. En revanche, j’ai sursauté quand j’ai senti ses mains
caresser ma barbe et s’y perdre.
— Que fais-tu là ? lui ai-je demandé
d’un ton rogue. Ignores-tu que personne n’est autorisé à pénétrer dans cette
pièce à l’heure de ma sieste et, qui plus est, à fouiller dans ma barbe ?
Y aurait-il le feu quelque part ? Et d’abord, qui es-tu ? Je te vois
mal.
— Vous ne me reconnaissez pas,
sire ? Je suis une de vos filles, Rothilde, et ma mère se nomme
Maltegarde. Voulez-vous que j’ouvre les volets ?
— Dis-moi d’abord ce que tu veux.
— Faire un jardin de votre barbe, sire.
Je viens de cueillir quelques fleurs dans le gazon : des pâquerettes, des
violettes, des renoncules… Elles étaient à l’ombre et ont gardé leur rosée et
leur parfum. Ne bougez pas, sinon elles vont tomber, et cessez de rire, s’il
vous plaît. Votre barbe grise était trop triste. Maintenant vous êtes beau
comme un Jésus, beau comme le printemps.
Éginhard, mon conseiller, mon secrétaire, mon
ami, vient d’entrer dans mon cabinet. Il s’esclaffe puis s’offusque, me propose
de chasser cette gamine effrontée et de la faire fouetter. Comment a-t-elle pu
tromper la vigilance des deux colosses saxons qui gardent mon cabinet ? Elle
répond en riant derrière ses menottes :
— Ils dormaient ! Je n’ai eu qu’à
pousser la porte.
Rothilde est une de mes bâtardes, ces gamines
qui me précèdent ou m’escortent à chacune de mes promenades dans les allées de mes
jardins, chantent, dansent, font les folles et jettent du gravier aux merles. Elle
est délicate, avec encore les attendrissantes gaucheries de l’enfance. J’aurais
dû la reconnaître d’emblée, malgré la pénombre. Quel âge ? Moins de dix
ans sans doute, mais déjà fort vive et la réplique facile. Sa mère, une de mes
concubines préférées, est une forte esclave aquitaine amenée au palais il y a
une douzaine d’années par mon fils Louis. Elle souhaite confier sa fille à un
couvent de Mayence pour lui éviter, l’âge venu, de céder aux avances d’un des
officiers de Germanie qui hantent les couloirs de mon palais. Rien ne presse.
Mettre en pot cette fleur sauvage me semble à la fois absurde et prématuré. Un
projet auquel je vais m’opposer.
Laquelle de mes autres bâtardes aurait eu
cette idée de planter des fleurs dans ma barbe ? Emma, Adaltrude,
Adélaïde ? Laquelle aurait eu l’insolence de troubler la fin de ma sieste
en sautant sur mes genoux, au risque de réveiller la douleur dans mes vieux
os ? J’aurais dû la sermonner, la chasser, lui interdire de reparaître.
Elle ajoute :
— Sire, mon père, je ne vous ai pas vu
hier, au bain. Étiez-vous souffrant ?
Je lui rappelle que, la veille, nous avons eu
un bel orage, avec une pluie froide amenée par les vents de Germanie, et que le
bassin n’était fréquenté que par quelques jeunes téméraires. Elle se flatte
d’avoir été parmi eux et poursuit son babil. Je la prends dans mes bras pour
l’arracher à mon fauteuil ; elle boude ou fait semblant, tourne entre ses
doigts le talisman que je porte sur ma poitrine, qu’elle appelle une médaille, et qui contient un cheveu de la Vierge. C’est un bel objet, un bijou
reliquaire fait d’un cercle d’or enchâssé de pierreries.
Après avoir déposé sur mes genoux ce qui reste
de son bouquet, Rothilde me demande la permission de revenir, « demain ou
un autre jour ». Devant mon refus, elle prend une attitude de vierge
outragée. J’insiste.
— Ni demain ni jamais, ma fille. Après ma
sieste, j’ai d’autres préoccupations. Va rejoindre tes sœurs, et merci pour le
bouquet.
— Père, me dit-elle d’un air grave, ne
vous fâchez pas si je vous dis que j’aimerais dormir dans votre barbe. Elle est
douce, soyeuse, parfumée. J’y ferais de beaux rêves.
— Quelle idée saugrenue, petite
sotte ! Tu y serais à l’étroit et en mauvaise compagnie. Il te faudrait
l’épouiller, la friser, et tu y serais moins à l’aise que sur ton grabat.
L’occasion est propice de rompre avec une
légende. Je n’ai décidé de laisser pousser ma
Weitere Kostenlose Bücher