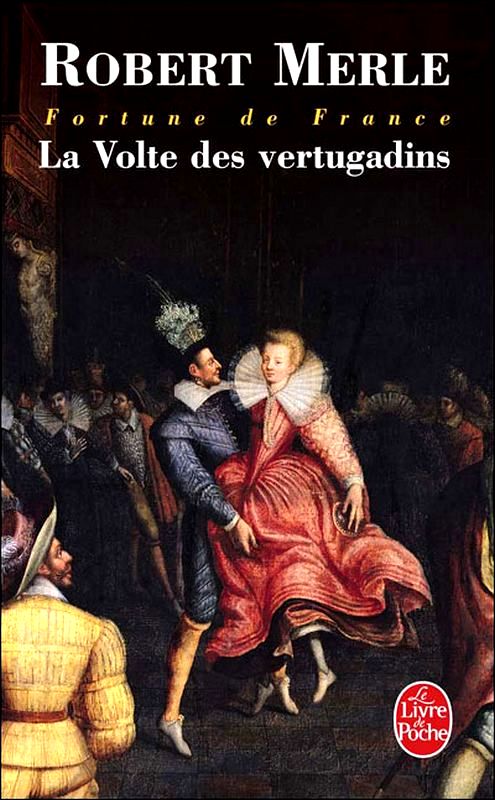![La Volte Des Vertugadins]()
La Volte Des Vertugadins
ces paroles, je me jetai à genoux et appuyai ma tête sur
le lit, car je me sentais prêt à pâmer. Et je pâmai peut-être quelques secondes
car, relevant la tête, tout me parut flou. Mais peu à peu, ma vue se
précisa ; je vis Monsieur de Bellegarde à genoux dans la ruelle, tenant
une main d’Henri dans la sienne et la baisant. C’est le deuxième roi de France
que Bellegarde voyait assassiné, ayant été présent quand Jacques Clément donna
de son couteau dans le ventre d’Henri III. Bassompierre, à genoux au bout
du lit, tenait étroitement embrassés les pieds du Roi dans ses mains. Monsieur
de Guise était à ses côtés, pleurant aussi.
Je demeurai là un moment, tâchant de prier sans y réussir
tout à plein et apercevant le Duc de La Force et Castelnau dans une embrasure
de fenêtre, père et fils sanglotant dans les bras l’un de l’autre, je me levai,
les genoux tremblants et, le pas incertain, me dirigeai vers eux. Ils furent un
moment avant de me reconnaître, tant les larmes obscurcissaient leurs yeux.
Mais m’étant nommé, Monsieur de La Force me donna une forte brassée et me dit à
l’oreille : « Ah ! Si le Roi m’avait permis de serrer en geôle
ce misérable ! – Quoi ? dis-je, est-ce ce même Ravaillac ?… »
La Force me conta alors, à paroles basses et entrecoupées, ce qui s’était passé
rue de la Ferronnerie, rembarras de charrois qui avait immobilisé le carrosse
du Roi, et ce misérable, le pied sur une borne, l’autre sur le rayon d’une
roue, et le couteau dans la main gauche, « donnant dans le corps du Roi
comme dans une botte de foin ». La Force était dans le carrosse du Roi
avec Montbazon, Roquelaure, Liancourt et d’Épernon. L’attentat fut si prompt
que personne, sauf d’Épernon, ne vit les coups de couteau, mais seulement le
sang qui jaillissait de la bouche du Roi.
Monsieur de La Force n’en dit pas plus, sa voix lui
manquant. Et Castelnau, me jetant le bras autour du cou, me serra à lui et me
dit à l’oreille : « Après ce coup-là, que peuvent-ils faire de pis,
sinon révoquer l’édit [71] et
recommencer contre nous les persécutions ? »
Je refis tout le chemin des appartements du Roi à celui du
Dauphin, lequel, à mon entrant, leva la tête. Son visage ne me parut pas tant
triste que fermé et c’est seulement quand il parla qu’il se trahit. Sa voix
était plus enfantine qu’à l’accoutumée et il bégayait beaucoup :
« Siorac, dit-il, vous plaît-il de dire bonjour à mon chien ? »
Je me vins mettre à genoux à côté de son tabouret et je caressai Vaillant en
même temps que lui. Louis me parut trouver quelque soulagement en ma présence,
comme s’il se fût senti plus proche de moi en raison de mon âge. Le docteur
Héroard et Monsieur de Souvré avaient dû se mettre d’accord pour ne rien lui
dire de plus que ce qui avait été dit dans le carrosse et se tenaient debout,
muets à côté de lui, sans qu’il osât les envisager ni leur poser question.
La Duchesse douairière de Montpensier troubla ce silence.
Elle entra en trombe dans la pièce et cria, tout à l’étourdie et d’une voix
aigre :
— Où est le Dauphin ? Où est le Dauphin ? Or
sus ! La Reine le veut voir sur l’heure !
Le Dauphin ne leva pas la tête, ne la regarda pas et, le
visage penché sur son chien, continua à le caresser. La Duchesse, ne sachant
que faire, s’approcha de Monsieur de Souvré qui lui parla assez longuement à
l’oreille.
— Monsieur, reprit-elle, en s’adressant au Dauphin d’un
ton plus doux et en lui faisant une grande révérence, plaise à vous de venir
voir Sa Majesté la Reine. Le Chevalier de Siorac peut vous accompagner, si tel
est votre plaisir.
— Siorac, vous plaît-il de venir ? dit Louis.
— Assurément, Monsieur.
J’articulai ce « Monsieur » avec la certitude,
faite de regrets poignants, mais aussi d’amour et d’allégeance, que je lui
devrai dire « Sire » la prochaine fois que je m’adresserai à lui.
La Reine, qui n’était encore ni coiffée ni habillée, jouait
dans sa chambre une tragédie à l’italienne, avec pleurs, cris, exclamations,
torsions pathétiques de mains et de bras, mais, à observer ses yeux, il me
parut qu’elle n’était ni aussi surprise ni aussi effrayée qu’elle aurait dû
l’être.
À l’entrant de Louis, elle s’écria :
— L’hanno ammazzato [72] !
À y songer plus tard, ce pluriel me surprit, la fiction
Weitere Kostenlose Bücher