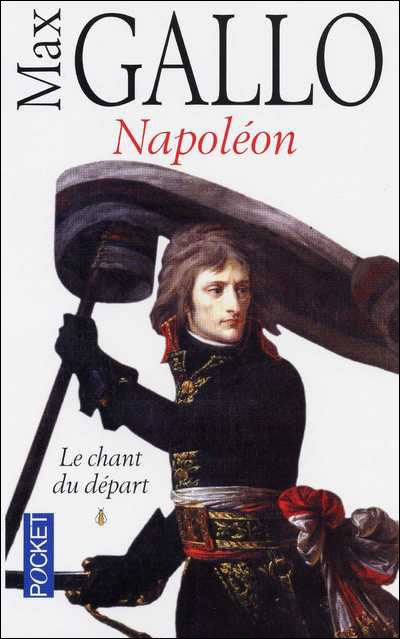![Le chant du départ]()
Le chant du départ
par les officiers de charger les fusils. Le calme est rétabli. Les compagnies entrent dans les casernes. Bonaparte rejoint sa chambre. Aussitôt il prend la plume, encore imprégné par l’atmosphère de ces affrontements. Il veut raconter à son frère Joseph ce qu’il a vécu :
« Au milieu du bruit des tambours, des armes, du sang, je t’écris cette lettre. La populace de cette ville, renforcée d’un tas de brigands étrangers qui sont venus pour piller, se sont mis dimanche au soir à renverser les corps de bâtiments où logent les commis de ferme, ont pillé la douane et plusieurs maisons. Le général a soixante et quinze ans. Il s’est trouvé fatigué. Il a appelé le chef de la bourgeoisie et lui a ordonné de prendre l’ordre de moi. Après bien des manoeuvres nous en avons arrêté trente-trois et nous les avons mis au cachot. L’on va, je crois, en pendre deux ou trois prévôtalement. »
Pas d’interrogation. L’ordre doit régner, même si Bonaparte ajoute, condamnant les privilégiés : « Par toute la France le sang a coulé mais presque partout cela a été le sang impur des ennemis de la Liberté, de la Nation et qui depuis longtemps s’engraissent à ses dépens. »
Même si les mots qu’il utilise sont ceux des « patriotes français », il réagit d’abord en officier qui déteste la « populace ». Et surtout, il pense à la Corse. De ce qu’elle deviendra dépend son destin personnel.
Le 9 août, il demande officiellement un nouveau congé pour se rendre en Corse. Mais il lui faut attendre, et il tourne dans sa chambre, il marche dans la campagne comme s’il était enfermé dans ce pays.
Écrire ne le calme pas. Mais c’est la seule activité qui lui donne l’impression d’agir.
Il écrit à M. Giubega, qui, greffier en chef des états de Corse, est aussi son parrain.
Les privilèges viennent d’être abolis dans un grand élan unanime au cours de la nuit du 4 août.
« Cette année s’annonce par des commencements bien flatteurs pour les gens de bien, écrit Bonaparte, et après tant de siècles de barbarie féodale et d’esclavage politique, l’on est toujours surpris de voir le mot Liberté enflammer les coeurs que le luxe, la mollesse et les arts semblaient voir désorganisés. »
C’est vrai, la France l’étonne. Il songe, dans cette journée orageuse d’août, à Paris, à ce centre des plaisirs qui paraît être devenu un volcan. Mais ce moment historique ne vaut pour Bonaparte que si la Corse en tire parti.
Il est si nerveux à l’idée qu’il pourrait être absent de l’île qu’il se rend une nouvelle fois auprès du maréchal du camp Du Teil, qui enfin lui annonce que son congé est en bonne voie. Mais il faut encore attendre. Il reprend la lettre à son parrain Giubega.
« Tandis que la France renaît, dit-il, que deviendrons-nous, nous autres infortunés Corses ? Toujours vils, continuerons-nous à baiser la main insolente qui nous opprime ? Continuerons-nous à voir tous les emplois que le droit naturel nous destinait occupés par des étrangers aussi méprisables par leurs moeurs et leur conduite que leur naissance est abjecte ? »
Il est bien d’une autre race. À cet instant, il méprise ce peuple français.
Il a vu, le 16 août, le régiment de La Fère se mutiner.
Les soldats se sont rendus en colonne serrée à la maison du colonel, exigeant qu’on leur donne la masse noire contenue dans la caisse du régiment. Devant leur détermination et leur nombre, leurs cris et leurs menaces, le colonel a cédé.
Les soldats se sont partagé l’argent puis ils se sont enivrés, forçant les officiers à boire, à chanter et à danser avec eux.
Bonaparte assiste de loin à ces scènes. Il voit l’un de ses camarades, le lieutenant Bourbers, entouré de furieux qui l’accusent d’avoir frappé l’un d’eux. On veut l’égorger. Deux sergents-majors se précipitent, l’enlèvent. Mais le lieutenant est contraint le soir même de quitter Auxonne déguisé en femme ! Il aurait fallu, dit Bonaparte à Des Mazis, faire tirer au canon sur les mutins, cette canaille abjecte qui bafoue tous les principes de la discipline.
Ce désordre le révolte, même si la nouvelle politique lui paraît être « un pas vers le Bien ». Mais là n’est pas l’essentiel. C’est à la Corse que Bonaparte pense obsessionnellement.
Il voudrait que son parrain Giubega agisse.
« Jusqu’ici la prudence a indiqué de se taire, lui écrit-il
Weitere Kostenlose Bücher