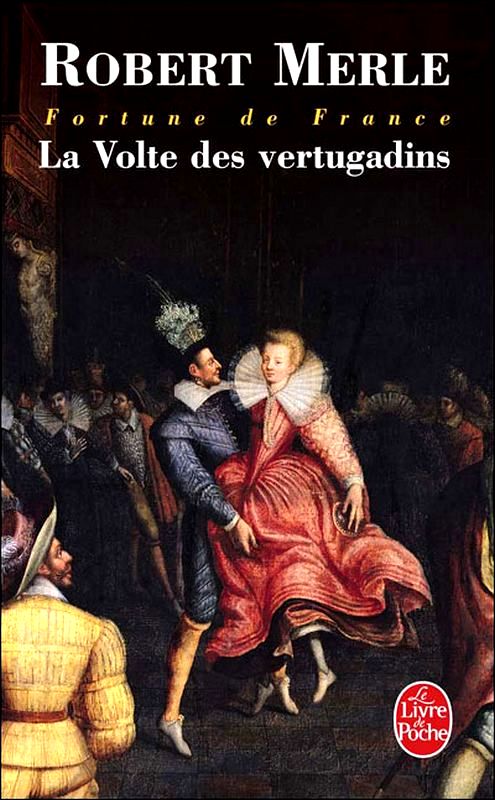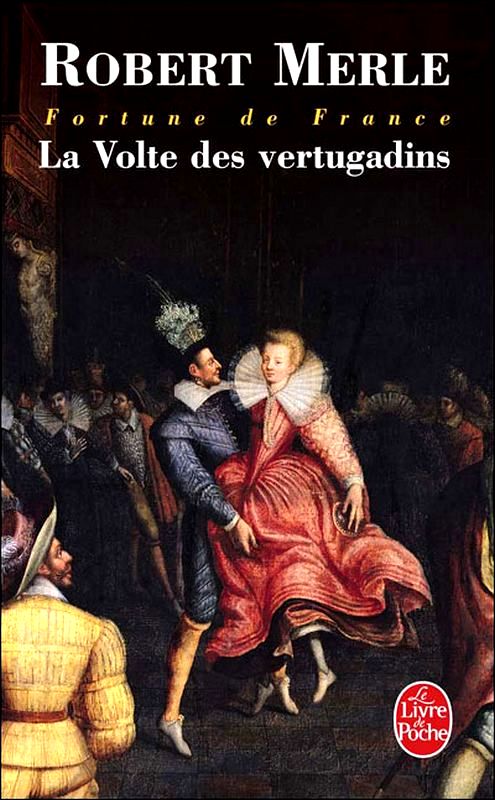
La Volte Des Vertugadins
incessante de mes pensées, pendant laquelle mon corps, se tournant
et se retournant sans cesse, rendait impossible tout ensommeillement.
Cette sieste-là était la cinquième que je passais sans
Toinon. Je les avais comptées, comme le prisonnier compte les jours sur les
murs de sa cellule, et je pris ce jour-là la résolution de mettre un terme à
une comptabilité d’autant plus stupide qu’elle ne débouchait sur aucun espoir.
Toinon, dans la maison, était devenue invisible. Et m’en
étant étonné auprès de La Surie, j’appris de lui qu’elle travaillait dans la
journée à remettre en ordre les affaires de Maître Mérilhou, mais que par
décence elle revenait chez nous à la nuit tombée pour y dormir, son mariage ne
se devant célébrer qu’à la fin du mois.
Cela me causa une petite peine supplémentaire de ne plus
même la voir, je le confiai à La Surie et toute la consolation que j’en eus fut
un proverbe périgourdin qu’il me cita : « Un renard prend plaisir
à voir passer une poule, même quand il ne peut pas l’attraper. » Cette
sagesse paysanne ne me fut d’aucun secours et je le lui dis. « Mais
qu’avez-vous à penser à Toinon ? reprit-il. Pensez plutôt à votre
maîtresse d’allemand ! » Il va sans dire que je pensais aussi à elle,
mais je ne laissais pas d’apercevoir qu’il y avait une différence entre le
souvenir que la chair garde des enchériments qu’elle a vécus, et une aspiration
qui se nourrit de regards, de sourires et de quelques mots caressants. Cette
espérance, certes, m’occupait l’âme davantage, mais elle n’était point si
concrète.
Je me gardai bien de confier ce sentiment à La Surie, il
m’eût répondu par un autre proverbe qu’il affectionnait : « Certes,
certes ! mon beau neveu ! Et n’est-ce pas bien naturel ! “ Un
homme ne mange pas son rôt à la fumée !” » Ce qui voulait dire,
j’imagine, que la fumée du rôt ne remplace pas le rôt.
La Surie m’appelait « mon neveu » et non plus
« mon mignon », et cela à ma demande. Car bien que le mot
« mignon », depuis la mort d’Henri III, eût perdu son acception
péjorative, je le trouvais minimisant pour la sorte de grand homme que j’étais
en train de devenir : truchement secret de Sa Majesté, et cavalier
servente d’une haute dame.
La mésaise et la mélancolie dont je pâtissais n’étaient rien
encore : le mercredi, la foudre me frappa. Ce matin-là, révisant la leçon
d’allemand que j’avais si mal apprise le vendredi de la semaine précédente, je
fus interrompu par un petit vas-y dire qui m’apporta, non pas un mot, mais une
lettre de ma Gräfin. La voici :
« Monsieur,
« Quand vous recevrez cette lettre-missive, je serai
partie depuis quelques heures pour Heidelberg, étant rappelée dans le Palatinat
par la santé de mon père, lequel est vieil et mal allant. Je reviendrai à coup
sûr en Paris, ville à laquelle m’attachent les liens que vous n’êtes pas sans
connaître, mais ne saurais, hélas, dire quand. On me laisse craindre une issue
malheureuse à l’intempérie de mon père, et si ces craintes se réalisent,
j’aurai à faire face à des difficultés familiales qui me retiendront dans le
Palatinat tout le temps qui sera nécessaire pour les résoudre. Cela risque
d’être long, bien trop long à mon goût, la raison en étant que j’ai acquis la
conviction que je ne saurais jamais être heureuse ailleurs qu’en Paris.
Continuez, je vous prie, à étudier l’allemand pour la beauté de la langue, mais
aussi pour l’amour de moi, qui penserai souvent à vous dans ma docte et austère
Heidelberg.
« Je suis, Monsieur, votre affectionnée servante,
Ulrike von
Lichtenberg. »
Mon père entra comme j’achevai de lire cette lettre, et me
vit dans les larmes.
— Mais qu’est cela ? Qu’est cela ? dit-il,
fort étonné.
Je lui tendis la lettre, qu’il lut, relut et relut encore,
s’attachant quasiment à chaque mot.
— J’entends bien, dit-il, que vous puissiez vous sentir
fort dépit de cette longue absence, juste au moment où vous pensiez aborder
heureusement aux rivages que vous convoitiez. Mais il y a des expressions qui,
pour prudentes qu’elles soient, devraient vous ravir. Ulrike parle de Paris
comme d’une ville à laquelle l’attachent « des liens que vous n’êtes
pas sans connaître ». Ou encore : « J’ai acquis la
conviction que je ne saurais jamais
Weitere Kostenlose Bücher