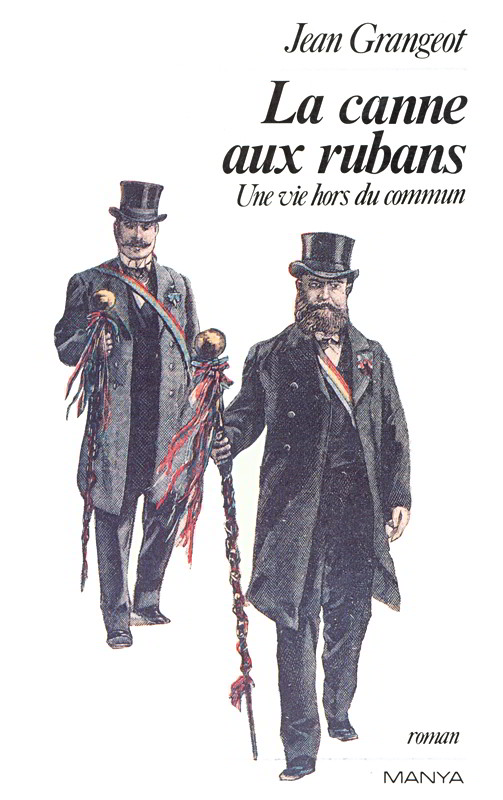![La canne aux rubans]()
La canne aux rubans
travaux
intéressants et rémunérateurs.
Julienne, le 2 août 1872 ; Georgette, le 26 septembre
1875 et Georges, le 3 décembre 1876 complétèrent la famille Bernardeau où sans
luxe, ni abondance, chacun mangeait à sa faim.
I
Pour moi, Adolphe Bernardeau fils, la vie a donc vraiment
commencé lors de mon entrée sur les bancs de la classe. Ce tournant m’a marqué.
Dans notre ville il y a deux écoles. L’une tenue par les
Frères, l’autre laïque dirigée par Monsieur Bouzy. Celui-ci reste fidèle à
l’Empire. Ce distinguo n’empêche pas que le vicaire vienne nous surveiller au
moins trois fois par semaine.
Dès qu’il franchit la porte je ressens son regard pénétrant,
incisif, comme un jugement rendu qui me condamne d’avance. Je travaille bien et
suis, paraît-il, soigneux. Je devrais être le premier ; mais une punition
du vicaire me relègue à chaque fois en queue de la classe.
Je constate l’injustice, mais je la supporte en serrant les
poings. Pour me venger, quelques copains et moi allons attendre à la sortie de
leur école les gosses des Frères. Alors nous leur tombons dessus, la rage au
cœur.
On prévient mon père ; on lui relate ma conduite. Pour
la forme, il m’engueule ; mais je sens bien qu’il n’est pas sincère.
J’ai une passion : le dessin. Mon ami, Alexandre Gigot,
et moi nous glissons dans l’église et, armés de papier et crayon, nous tentons
de reproduire les volutes, les angles, les courbes des pierres et les parties
d’architecture des bois.
J’y goûte les meilleurs moments de la journée. Dès que nous
entendons la canne du rastichon taper sur le sol, nous nous cachons, puis
disparaissons par la petite porte du côté qui donne sur la rue.
Cette église immense est un joyau architectural. Comment ne
pas tomber en admiration devant les sculptures des chapiteaux, la lancée des
arcades, le fini des frisures ?
À l’extérieur, je contemple les diables à longues cornes
chassant des personnages que je prends pour des prêtres. Je commence à
comprendre que tous les auteurs ont peut-être écrit à leur façon ce qu’ils
ressentaient intimement.
Les mains de mon père pourraient sûrement en faire
autant ; mais je confonds encore à ce moment de ma vie, la sculpture et la
taille des pierres.
Un jour le vicaire me surprend à dessiner à l’intérieur de
son église. Je ne l’ai pas entendu. Plongé dans mes reproductions, je restais
sourd aux bruits de pas et de canne.
— Que fais-tu là, garnement ? me dit-il de sa voix
nasillarde.
— Mais Monsieur le curé, vous voyez, je dessine.
— Montre-moi ce que tu fais.
J’allais lui tendre mon travail quand il me l’arracha.
— Attention ! Monsieur le curé ce n’est pas fini.
Sa colère éclate.
— Petit démon, tu oses comparer ces merveilles à tes
dessins obscènes. Le diable est en toi. C’est forcé avec un père comme tu as.
Fiche le camp, je garde ces pourritures.
Que faire devant tant de méchanceté et d’injustice ?
Je rentre chez moi et raconte l’affaire.
— Ah ! il t’a dit ça ce noiraud ! Je vais
aller le trouver. Ça suffit à la fin.
Mon père remet sa veste et va droit à la sacristie. Avec
beaucoup de prudence je le suis et observe la scène par l’entrebâillement de la
porte. Le vicaire retire sa chasuble avec des gestes lents.
— Vous entrez sans frapper ! Ce n’est pas un
moulin ici. Veuillez sortir.
Blois pâlit, ses yeux noirs fixent le prêtre comme s’ils
voulaient le transpercer. D’une voix ferme il dit :
— Je ne suis pas de ceux que vous commandez et qui
plient les genoux. Montrez-moi les dessins que vous avez pris à mon fils… allez
vite… j’attends.
Le vicaire ouvre un tiroir et sort les papiers.
— Les voici ; vous jugerez par vous-même de
l’obscénité de ces torchons.
Blois les prend calmement, les examine et les repose en
déclarant de sa voix forte :
— C’est vous la bête obscène, stupide, analphabète. Ces
dessins représentent des coupes de pierres et leur entrelacement. Je pourrais
même vous dire où elles se trouvent dans votre église. Quant à ces croquis ils
montrent l’enchevêtrement des contre-fiches et des pannes. Mais, pour un borné
comme vous, ce sont des obscénités parce que vous imaginez des choses sales et
puantes. Je travaille moi, pour embellir, réparer ou construire. Tandis que
vous, vous faites peur, vous rabaissez les gens… et cela ne doit pas vous
fatiguer
Weitere Kostenlose Bücher