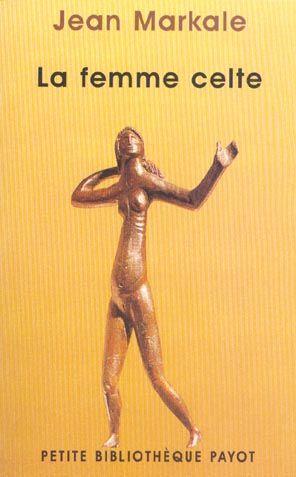![La Femme Celte]()
La Femme Celte
la jambe droite et de se laver tout le corps avec son sang. C’est ainsi que
Prudent demeure trois jours et trois nuits dans le four sans subir aucun
dommage. Le roi est de plus en plus furieux et la Princesse de plus en plus
amoureuse. Prudent se précipite vers la Jument et s’aperçoit qu’elle est
devenue une belle jeune fille. Sommé de choisir entre la Princesse et
l’ex-Jument, il se décide pour l’ex-Jument (L. F. Sauvé, Le Folklore des Hautes-Vosges , p. 322 sq ).
Il ne fait pas de doute que ce conte soit d’origine
celtique : un détail nous le prouve, celui du four chauffé dans lequel on
place le jeune héros. C’est une référence à un rituel archaïque dont nous ne
savons pas grand-chose mais qui est lié à la fête de Samain : c’est
généralement un roi qui est sacrifié ainsi, dans une maison de fer chauffée à
blanc [106] . En dehors de ce
détail, le thème de Rhiannon est bien reconnaissable, avec à l’arrière-plan, le
retour à la Mère. En effet, pour conserver la vie de Prudent, la jument le
couvre de son propre sang, c’est-à-dire qu’elle cache son fils (Prudent) dans
sa propre matrice, le nourrissant et le protégeant de son sang contre la
sécheresse (= la catastrophe de la naissance) représentée par le four chauffé.
Il s’agit ici d’une illustration parfaite des théories émises par Ferenczi dans Thalassa , concernant l’analogie entre la
catastrophe de la naissance et la catastrophe survenue il y a des millions
d’années au détriment de l’espèce, l’assèchement des grandes mers et
l’adaptation à une vie nouvelle terrestre, le tout symbolisé dans les
traditions par le déluge (en réalité bénéfique) et l’embrasement de l’univers
(mythe de Phaeton). Il s’agit aussi, sur le plan social, de la même révolte du
jeune fils contre le vieux roi (son père), avec la complicité active de la Mère
(la Jument) et, ce qui est très significatif, l’aide
du roi des Poissons , c’est-à-dire les fidèles de l’ancien ordre
gynécocratique, le poisson étant le symbole du retour à la Mère. Et la
conclusion de ce conte, le choix de l’ancienne jument, marque indiscutablement
ce retour à la mère que d’aucuns pourront considérer comme une
régression : c’en est une, bien entendu, mais personne ne saurait dire a priori dans quelle direction l’être humain doit
s’engager.
Jusqu’à présent, nous avons retrouvé Notre-Dame de la Nuit
sous l’aspect d’une Jument, ou tout au moins liée au cheval, c’est-à-dire au symbolisme
du cheval. Car il faut certainement abandonner toute idée de totémisme à propos
des Celtes, celui-ci se réduisant à la classification de certaines tribus sous
un vocable particulier emprunté parfois à un nom d’animal, parfois à un nom
d’arbre [107] . L’animal, chez les
Celtes, comme chez les autres Indo-Européens, n’a guère qu’une signification
symbolique, et les quelques rares traces de totémisme qu’on a pu relever sont
d’origine pré-indo-européenne, provenant des traditions autochtones maintenues
après la conquête. Il n’en reste pas moins vrai que le cheval est un animal fréquemment
utilisé dans la symbolique religieuse des Celtes, et par conséquent dans
l’iconographie et même dans la décoration, ce qui d’ailleurs est parfaitement
normal chez un peuple qui a toujours pratiqué l’élevage des chevaux, et dont la
cavalerie était, même à l’époque de César, aussi bien chez les Bretons que chez
les Gaulois, une arme d’élite très efficace. Les monnaies gauloises et
bretonnes nous en ont laissé des traces mémorables : que l’on songe aux
monnaies des Redones, des Vénètes, des Curiosolites, des Osismi, des
Baiocasses ; elles magnifient toutes le cheval et en font un animal
fantastique, parfois surmonté d’un aurige fantomatique, parfois lui-même à tête
d’oiseau ou à tête d’homme, signe évident de l’importance donnée par ces
peuples, et par d’autres d’ailleurs, à cette figuration dont la beauté
plastique est absolument remarquable.
Mais ce serait une erreur de croire que la Déesse est seulement
représentée sous les traits d’une jument. Les autres animaux avaient eux aussi
leur signification particulière. Il existe dans la statuaire gallo-romaine une
déesse à l’Ours, celle conservée au musée de Berne, ville dont le nom
germanique et les armes rappellent l’ours. Cette déesse, Artio, dont le nom provient
du mot gaulois
Weitere Kostenlose Bücher