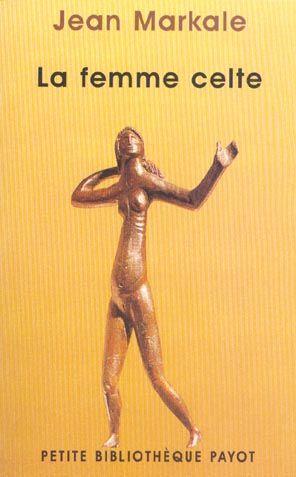![La Femme Celte]()
La Femme Celte
grâce à ses prières, un
fils leur naquit. Mais du moment où elle conçut, elle devint folle et fuit
toute habitation. Quand arriva le temps de la délivrance, le bon sens lui
revint. Or il arriva qu’à l’endroit où le porcher gardait un troupeau de porcs,
par peur de ces animaux, elle accoucha. Le porcher prit l’enfant et le porta à
la cour. On le baptisa et on lui donna le nom de Kulhwch parce qu’on l’avait
trouvé dans la bauge d’une truie » ( Kulhwch et
Olwen , J. Loth, Mabinogion , I,
244-245).
Le nom de Kulhwch, selon l’auteur du récit, proviendrait
donc de cul, étroit (prononcer kil ), ou de cil , cachette, retraite, coin (prononcer également kil ), à rapprocher du mot gaélique cill , église (voir Kildare ,
l’église des Chênes, primitivement « la cachette aux chênes »), et de Hwch , porc (mais « truie » seulement
en gallois moderne ; houc’h , porc en
bret. arm.). Joseph Loth affirme que c’est une étymologie fantaisiste analogue
à toutes celles qu’on rencontre dans les textes du Moyen Âge, aussi bien les
textes français et anglais que les textes irlandais ou gallois. La chose ne
doit pas être jugée aussi péremptoirement, et il y a de fortes chances pour que
l’auteur anonyme de ce texte, qui est le premier roman arthurien, et dont
certaines parties remontent au IX e sinon au
VII e siècle, ait suivi là une tradition
parfaitement authentique.
En effet, quel étrange récit que celui de cette
naissance : cette femme qui s’appelle « Jour Brillant », qui est
folle, qui vit loin des habitations humaines mais près des cochons, reprend sa
raison au moment de l’accouchement. Mais là le texte est clair : c’est
parce qu’elle reprend sa raison et qu’elle s’aperçoit qu’elle est au milieu des
cochons qu’elle accouche brusquement dans la bauge
d’une truie . En somme, cette femme, c’est la Mère-Truie, la
Déesse-Truie, et Kulhwch, c’est le jeune pourceau, celui qu’elle a porté dans
sa cachette de truie, c’est-à-dire sa matrice. Toute cette histoire est
analogue à celle de Rhiannon dont le fils est trouvé dans une écurie au moment où
la jument vient de mettre bas un poulain, analogue aussi à l’histoire de
Dechtire et à celle de Macha. On trouvera également des rapports certains entre
cette histoire et la légende gaélique du cycle de Leinster (cycle de Finn),
répandue aussi bien en Irlande qu’en Écosse, à propos du héros Diarmaid.
Histoire de Diarmaid (Irlande-Écosse) : Diarmaid est élevé chez le roi des fées Oengus, et il a
pour frère de lait le fils du sénéchal d’Oengus. Un jour que le père de
Diarmaid est allé chez Oengus visiter son fils, il tue par accident le fils du
sénéchal et est obligé de donner une compensation à celui-ci. Après un
arbitrage de Finn, le sénéchal transforme son fils mort en sanglier privé de
soies, d’oreilles et de queues et prononce ces paroles : « Je te
place sous un lien magique, à savoir de mener Diarmaid à sa mort et ta propre
vie ne durera pas un jour de plus après la sienne. » Le sanglier se lève
et disparaît. C’est lui qui sera appelé le Sanglier de Ben Culbainn (R. Chauviré, Contes ossianiques , p. 164-166).
Il n’est pas question d’une femme dans cette curieuse histoire,
mais on peut supposer que l’épouse du sénéchal a quelque chose à voir avec la
truie.
Le sort de Diarmaid est donc lié à celui du Sanglier de Ben
Culbainn : celui-ci est son double, sa projection magique. Diarmaid est en
quelque sorte le jeune sanglier, le jeune pourceau, et si l’histoire, telle
qu’elle nous est rapportée, est tronquée et arrangée, elle n’en contient pas
moins les éléments du mythe : une femme inconnue qui est liée à la truie,
donne naissance à un fils qui est, lui aussi, assimilé à un sanglier.
Le porc ou le sanglier joue un grand rôle chez les Celtes.
D’abord dans la vie courante, car les Celtes sont grands chasseurs et grands
amateurs de sangliers, gibier particulièrement abondant dans les forêts de la
Gaule, de l’île de Bretagne et de l’Irlande. Les Celtes élèvent d’ailleurs de
grands troupeaux de porcs, et la fonction de porcher est un office des plus
importants dans la hiérarchie sociale. D’après les Triades galloises, deux des plus grands porchers étaient Pryderi et Tristan. Un récit
gaélique intitulé Les Deux Porchers [109] décrit les prouesses magiques respectives du porcher de
Weitere Kostenlose Bücher