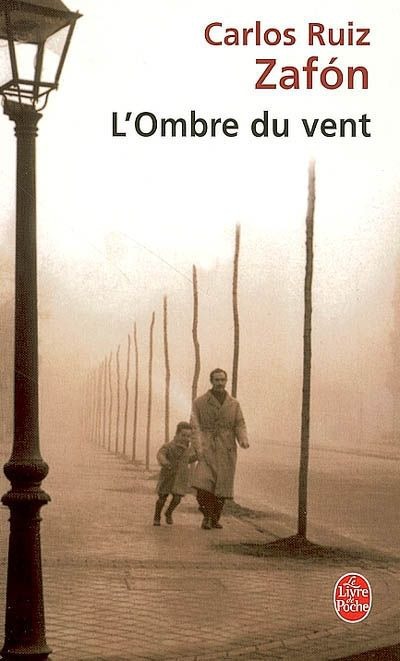![L'ombre du vent]()
L'ombre du vent
malade, il ne vivait plus que de souvenirs et de
remords. C'était l'homme le plus généreux et le plus fragile que j'aie jamais
connu, mon unique ami. Nous nous sommes mariés un matin de février, à la
mairie. Notre voyage de noces se limita à prendre le funiculaire du Tibidabo
pour contempler Barcelone du haut des terrasses du parc, ville miniature dans
le brouillard. Nous ne fimes part de notre union à personne, ni à Cabestany, ni
à mon père, ni à sa famille qui le donnait pour mort. Je finis par écrire une
lettre à Julián pour le lui annoncer, mais je ne l'envoyai pas. Notre mariage
resta secret. Plusieurs mois après la cérémonie, un individu sonna à la porte.
Il dit s'appeler Jorge Aldaya. C'était un homme détruit, le visage ruisselant
de sueur – et pourtant il gelait à pierre fendre. En retrouvant Miquel au bout
de plus de dix ans, Aldaya eut un sourire amer et dit : « Nous sommes
tous maudits. Toi, Julián, Fumero et moi. » Il prétendit être venu se
réconcilier avec son vieil ami Miquel, en espérant que celui-ci lui ferait
assez confiance pour lui donner le moyen d'entrer en relation avec Julián
Carax, car il avait un message très important pour lui de la part de son défunt
père, M. Ricardo Aldaya. Miquel déclara ignorer où se trouvait Carax.
– Cela fait des années que
nous nous sommes perdus de vue. La dernière fois que j'ai entendu parler de
lui, il vivait en Italie.
Aldaya s'attendait à cette
réponse.
– Tu me déçois, Miquel.
J'espérais que le temps et tes malheurs t'avaient rendu plus sage.
– Il est des déceptions qui
honorent celui qui les inspire.
Aldaya, minuscule, rachitique
et prêt à se liquéfier en fiel, rit.
– Fumero vous envoie ses plus
sincères félicitations pour votre mariage, dit-il en regagnant la porte.
Ces mots me glacèrent le cœur.
Miquel ne dit rien, mais, cette nuit-là, tandis que nous nous tenions enlacés
en faisant semblant de chercher un sommeil impossible, je sus qu'Aldaya avait
raison. Nous étions maudits.
Plusieurs mois passèrent sans
nouvelles de Julián ou d'Aldaya. Miquel continuait d'assurer quelques
collaborations avec des journaux de Barcelone et de Madrid. Il travaillait sans
arrêt devant sa machine à écrire, rédigeant des choses qu'il qualifiait de
niaiseries tout juste bonnes à être lues dans le tramway. J'avais toujours mon
emploi aux éditions Cabestany, peut-être parce que c'était la seule manière de
me sentir plus près de Julián. Celui-ci m'avait envoyé une brève missive pour
m'annoncer qu'il travaillait à un nouveau roman intitulé L'Ombre du Vent et qu'il espérait le terminer
dans quelques mois. La lettre ne faisait aucune allusion à ce que nous avions
vécu. Le ton était plus froid et plus distant que jamais. Mes tentatives de le
détester furent vaines. Je commençais à croire que Julián n'était pas un homme,
mais une maladie.
Miquel ne se faisait pas
d'illusions sur mes sentiments. Il me donnait son affection et sa ferveur sans
rien demander d'autre en échange que ma compagnie et, peut-être, ma discrétion.
Jamais je n'entendais de lui un reproche ou un regret. Avec le temps, je finis
par éprouver à son égard une infime tendresse, bien au-delà de l'amitié qui
nous avait unis et de la pitié qui nous avait ensuite accablés. Miquel avait
ouvert un livret de caisse d'épargne à mon nom, sur lequel il déposait presque
tout ce qu'il gagnait. Il ne disait jamais non à une collaboration, une
critique ou un écho. Quand je lui demandais pourquoi il travaillait tant, il se
bornait à sourire, ou me répondait qu'il s'ennuierait trop à ne rien faire. Il
n'y eut jamais de mensonge entre nous, même dans nos silences. Miquel savait
qu'il allait bientôt mourir, que la maladie lui comptait les mois avec avarice.
– Tu dois me promettre que
s'il m'arrive quelque chose, tu prendras cet argent et te remarieras, que tu
auras des enfants et que tu nous oublieras tous, moi le premier.
– Et avec qui veux-tu que je
me marie, Miquel ? Ne dis pas de bêtises.
Parfois, il me regardait avec
un doux sourire, comme si la simple contemplation de ma présence était plus
grand trésor. Tous les soirs, il venait me chercher à la sortie de la maison
d'édition, son unique moment de délassement de la journée. Je le voyais
cheminé, courbé, toussant, et feignant une force qui n'était plus qu'une ombre.
Il m'emmenait manger ou faire du lèche-vitrines dans la rue Fernando, puis
Weitere Kostenlose Bücher