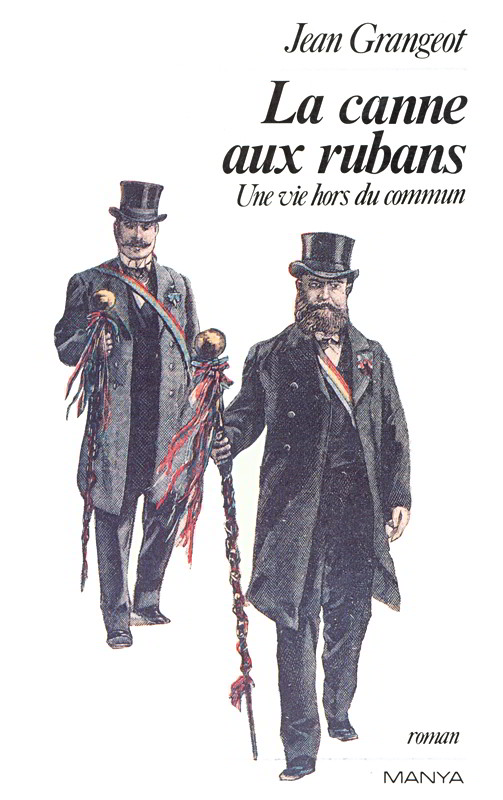![La canne aux rubans]()
La canne aux rubans
banc dans la cour espérant
percevoir le bruit de ses petits pas, son rire ou le son de sa voix. Une
vieille vient me préparer les repas et nettoyer ma tanière. Je veux partir,
quitter cette propriété, vendre tout. Un grossiste me fait une proposition.
Sans discuter, je l’accepte. Ma valise dans une main, ma canne de compagnon
dans l’autre, je marche droit devant moi et ne me retourne pas. J’emporte dans
mon cœur le plus beau, le plus intime des secrets : la richesse du bonheur
que j’ai vécu.
Je passe par Buzau et arrive quatre jours après à Bucarest.
Je me dirige tout droit à la librairie où Ionna me reçoit comme un ami. Nous
pleurons ensemble et nous rappelons tout un passé fait de petits mots, d’images
et de silences. Blanchon, prévenu de mon arrivée, m’héberge. Tous les amis
viennent me voir et veulent faire des tas de choses pour moi. Mais je ne peux
rester chez mon ami, nous y sommes venus trop souvent Julie et moi. J’emménage
dans une petite chambre avec cuisine que m’indique Ionna. Là, les souvenirs me
harcèleront moins.
L’Union des Français devient mon refuge pour la journée. Des
personnes dévouées y œuvrent pour le renom de la France. Je les considère comme
les membres de ma dernière famille dans ce Bucarest en folie. Je m’installe à
la bibliothèque dans un fauteuil pour lire des récits de voyage. À midi je
grignote dans un petit restaurant grec et le soir je me contente d’un bol de
lait et d’un morceau de pain. Du pain ! si l’on peut appeler ainsi cette
immonde boule grise, marron, noire, fabriquée avec toutes les raclures et
poussières de céréales indéfinies. Acheté comme un produit rare, il durcit
immédiatement et craque sous mes mauvaises dents. Chacun a droit à deux cents
grammes par jour. J’ai appris qu’en France la situation était la même.
Décidément pour être satisfait, ce peuple de barbares ne peut se passer d’un
Attila à sa tête. Finis les apéritifs chez Mircea ou Tripco, les vins blancs
secs, les rouges généreux ! Tout s’envole, dilapidé. Oh ! bien sûr,
une sorte de marché noir existe pour les riches, ceux qui évoluent à l’ombre du
pouvoir. En ville, la misère touche chacun. Monsieur Thevenin, un brave homme
membre de notre communauté, me donne un petit verre de Tuica le lundi. Je lui
trouve un goût un tantinet frelaté, mais cela me rappelle tout de même le bon
temps. Les Tziganes ont été à peu près tous exterminés. Je pense souvent à ces
hommes gais, musiciens, qui respectent la Kalderash ou la loi basée sur le code
de l’honneur. Trois des leurs travaillaient dans notre ferme, mais ne restaient
pas au-delà d’une saison. Le goût de la liberté ressemble à celui du miel
sauvage, il a les senteurs des arbrisseaux, des fleurs, des fruits, du hasard
et du vent. Le maréchal Antonescu a pris le titre de Conducator. Quelle
prétention de malade ! Il a entraîné la Roumanie dans les sillons tracés
par Hitler à travers la campagne de Russie. Ses divisions parties hors du pays
ne reviendront jamais. Le Roumain reste avant tout un latin et ce mariage
forcé, contre nature, qu’il subit, se terminera par un divorce sanglant puisque
six cent mille des leurs périront. J’observe, écoute et prends des notes
simplement parce que je suis un témoin de mon temps. Après le décès de Julie,
j’ai éprouvé le désir de rentrer en France, chez moi. Ce rêve ne peut se
réaliser, car les étrangers n’ont pas le droit de voyager librement et je n’ai
aucune envie de me retrouver dans un camp, condamné à une mort lente.
Ma sœur Marie est décédée. Je l’ai appris par une carte de
la Croix-Rouge qui a mis des mois à me parvenir. Ainsi celle avec laquelle je
me sentais le plus proche a rejoint mon père et ma mère.
De temps à autre, le sommeil me prend et m’arrache à la
lecture. Des photos de ma jeunesse et de ma vie d’homme chevauchent mes rêves.
Je me réveille en larmes. Attendre, attendre ! L’homme serait-il, depuis
sa naissance, condamné à ce verbe qu’il occulte et remplace par celui de vivre.
Quelle illusion ! Quelle comédie !
Nous apprenons, sous le manteau, que les boches viennent
d’être encerclés à Stalingrad. Von Paulus s’est rendu. Quelle victoire !
Quelle boucherie ! Les vents tournent, nous le sentons tous. L’espoir
pointe le bout de son nez.
Le sucre manque toujours à Bucarest. J’en achète un peu à
prix d’or chez un Turc qui trafique.
Weitere Kostenlose Bücher