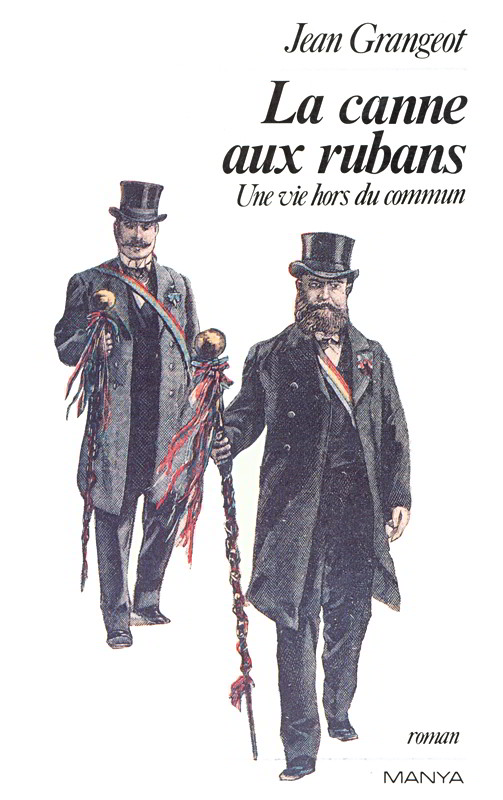![La canne aux rubans]()
La canne aux rubans
Foscani. Ma santé se maintient
tant bien que mal. On me donne le titre honorifique de doyen des Français, mais
en moi-même je préférerais laisser la place au suivant.
Les saisons font tourner la roue du temps. La mort ne m’a pas
encore choisi. Un jour on m’annonce que, vu mon âge, les autorités veulent bien
me laisser partir. J’entame la millième démarche administrative. Tout va bien,
mais rien ne se passe et on ne me précisera jamais la date de mon départ.
Alors, une nuit, il me vient l’idée d’écrire à Jean-Paul Boncour, le fils du
médecin de Saint-Aignan, qui fait carrière dans la politique. Je me présente à
lui en quelques mots, et lui demande d’aider un vieux compatriote ami de sa
famille. Environ deux mois après, l’ambassade de France m’apprend qu’on me
réserve une place dans un avion d’Air France qui transporte le courrier et
quelques rares voyageurs officiels entre Bucarest et Paris. Je lis et relis
l’autorisation des Russes relative à mon transfert. Sur le moment je n’y crois
pas mais, tout heureux, je me rends à l’évidence. L’Union des Français organise
une petite fête à l’occasion de mon départ. Un grand jour ce 4 octobre
1949 ! Je les remercie tous par quelques mots qui me viennent des tripes.
Un secrétaire de l’ambassade me prend à bord d’une voiture jusqu’à l’aéroport
d’Otopenie.
— C’est un DC 3, monsieur Bernardeau, m’explique
le secrétaire. Dans quelques heures vous serez au Bourget. Bon voyage !
— Merci Monsieur, merci de vous être dérangé.
L’avion vibre de partout. Je suis secoué comme un vieux
prunier. Dans la carlingue, à mes côtés, se trouve un général français tout
jeune qui a fière allure. Son ordonnance est assis derrière lui. Mes bagages ne
pèsent pas lourd, une valise contenant quelques vêtements, mes carnets de
notes, dont plusieurs ont disparu ou que j’ai oubliés, et une photo de Julie en
compagnie d’Ionna. Je tiens entre mes jambes, des deux mains, ma canne de
compagnon.
Au Bourget, on me met dans une pièce toute neuve, mais très
triste. Deux infirmières me prennent en voiture pour m’amener à Vitry-sur-Seine
qui est, paraît-il, un centre de triage. Triage ! Ce nom m’agace ! Je
me souviens de ma mère qui triait les lentilles dans une assiette et évacuait
les petites pierres ou les déchets. Qui suis-je ? Un déchet ou un vieux
légume tout sec ? Je passe devant un médecin énergique et pressé, puis
devant des fonctionnaires mollassons. Voilà ! On me donne mes papiers. Je
suis affecté à l’hospice de Château-Gontier. La géographie française me revient
en mémoire. Je pars en Mayenne. Cette rivière se jette dans la Maine et la
Loire. Ah ! la Loire et le Cher. Le retour, le presque retour aux sources.
Ma vie a commencé là et j’y reviens pour fermer les yeux. Ici tout le monde est
gentil avec moi. Je mange peu et dors beaucoup. La fin d’automne, en Mayenne,
dégage un charme particulier fait de touches de douceur angevine mêlées à des
relents de terre légèrement sablonneuse. Dans ce beau pays aux petits reliefs
d’un vert cru, les troupeaux de vaches paissent avec tranquillité. Venu en
train depuis Paris, que je n’ai fait que traverser, j’ai aperçu Laval. Ma canne
ne me quitte pas. À table avec les autres vieux et vieilles, je la pose
derrière moi, contre le mur, près de la fenêtre et la surveille d’un œil
jaloux. Les pensionnaires se moquent un peu de moi et de mes rubans flottants,
mais je ne prête aucune attention aux réflexions. Le dimanche suivant mon
arrivée, on veut absolument que j’assiste à la messe dans la chapelle voisine.
Je refuse d’abord aimablement, puis avec rudesse. L’après-midi même, le
ratichon de service vient bavarder avec moi. Il désire des explications.
Poliment, mais avec fermeté, je lui déclare que je suis et reste un homme libre
et de bonnes mœurs qui réclame simplement des autres la tolérance qui est la
mienne.
— Mais pensez à votre âme, il faut la sauver !
— En avez-vous déjà rencontré une ?
Ma réponse interrogative le surprend. Il rit pour gagner du
temps.
— L’âme existe. Il n’est pas nécessaire de la voir.
C’est une certitude.
— Je ne vous empêche nullement d’en être certain, car
elle fait partie de votre fonds de commerce mais nous n’emploierons jamais le
même vocabulaire. Gardons chacun nos conceptions sur la vie.
— Je ne vous parle pas de la
Weitere Kostenlose Bücher