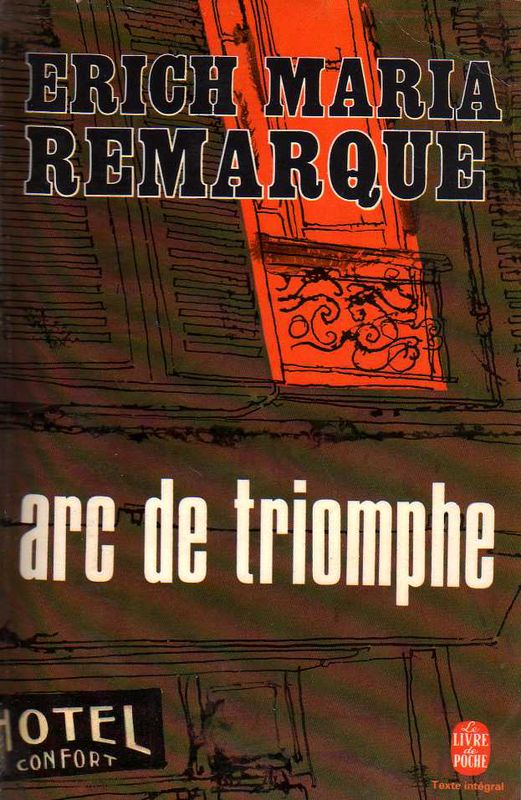![L'arc de triomphe]()
L'arc de triomphe
le tuer à Belfort, lorsqu’il portait le nom de Guenther… Et maintenant, dans un soir doux comme le sein d’une femme, il était revenu. Rien de tout cela ne lui causait plus de surprise. Il avait appris à tout accepter avec un calme fataliste, la seule arme efficace contre l’impuissance. Le ciel était partout le même… il était aussi bleu au-dessus du meurtre et de la haine qu’au-dessus du sacrifice et de l’amour. Chaque jour le soleil se noyait dans l’océan sombre du crépuscule sans souci des passeports, des trahisons et du désespoir. Il faisait bon être à Paris. Quel plaisir de marcher, de marcher lentement, sans penser, au milieu de cette lumière argentée et mourante. Quel bonheur d’avoir encore cette heure, remplie d’un doux repos, cette heure où une douleur déjà lointaine et la joie d’être tout simplement vivant et libre se confondaient comme des horizons. L’heure de répit, avant d’être de nouveau percé de lames et de flèches. Cette sensation vraiment animale, cette respiration qui venait de si loin et qui pénétrait si profondément, cette brise qui balayait sans soulever d’émotion les avenues du cœur, dépassant à la fois les petites flammes mornes des réalités, la croix pleine de clous qui était le passé, et les crochets acérés de l’avenir ; cette césure, ce silence au point mort de l’oscillation, cette seconde de pause, ce battement d’éternité qui tombait tout simplement, sans emphase, au milieu du monde essentiellement transitoire…
Morosow était assis dans le salon des Palmes à l’International, il buvait une bouteille de vouvray.
« Bonjour, mon vieux Boris, dit Ravic. Il paraît que je tombe à pic. C’est bien du vouvray que tu bois ?
– Oui, toujours. Du 34 cette fois. Il est légèrement moins sec, et un peu plus fort. Je suis heureux que tu sois revenu. Il y a trois mois, n’est-ce pas ?
– Oui. J’ai mis plus de temps que les autres fois. »
Morosow agita une clochette qui se trouvait sur la table. Elle tinta comme la cloche du sacristain dans une église de village. La Catacombe avait la lumière électrique, mais les sonnettes n’étaient pas modernisées. Ce n’était du reste pas la peine. Les réfugiés osaient rarement sonner.
« Comment t’appelles-tu maintenant ? demanda Morosow.
– Toujours Ravic. Je n’ai pas mentionné ce nom au poste de police. Je me suis appelé Wozzeck, Neumann et Guenther. Un pur caprice. Je n’ai pas voulu abandonner Ravic. Je crois que je m’y suis attaché.
– On n’a pas découvert que tu habitais ici ?
– Bien sûr que non.
– Évidemment. Sans quoi il y aurait eu tout de suite une descente de police. Tu peux donc de nouveau t’installer ici. Ta chambre est libre.
– La patronne sait-elle ce qui s’est passé ?
– Non. Personne ne le sait. J’ai dit que tu étais allé à Rouen. Tes effets sont chez moi. »
La servante entrait, portant un plateau.
« Clarisse, apportez un verre pour M. Ravic, dit Morosow.
– Ah ! Monsieur Ravic, s’exclama la servante en montrant ses dents jaunies. Vous voilà revenu ? Voilà plus de six mois que vous êtes absent !
– Non, trois seulement, Clarisse.
– Pas possible ! Je croyais que ça faisait six mois. »
La servante sortit ; et une seconde plus tard le garçon de l’International arrivait de son pas traînant, portant un verre à vin. Il ne s’était pas préoccupé de prendre un plateau. Mais, comme il était depuis très longtemps à l’International, il se permettait d’être familier. On pouvait lire sur sa figure ce qu’il allait dire. Morosow le devança :
« Jean, dites-moi depuis combien de temps M. Ravic est parti. Le savez-vous exactement ?
– Mais naturellement, que je le sais, monsieur Morosow. Je me souviens du jour. Il y a exactement quatre semaines et demie !
– Tout juste, dit Ravic, avant que Morosow n’ait eu le temps de parler.
– Tout juste, ajouta philosophiquement Morosow.
– Oh ! C’est que je ne me trompe jamais, monsieur ! fit Jean en s’en allant.
– Je ne voulais pas le chagriner, Boris.
– Moi non plus. Je voulais tout simplement te démontrer combien le temps compte peu, une fois qu’il est devenu le passé. Il y a de quoi se réjouir, s’effrayer, ou n’avoir aucune réaction. En 1917, à Moscou, j’ai perdu de vue le lieutenant Belski du régiment des Gardes de Neo-brashenk. Nous étions amis. Il a
Weitere Kostenlose Bücher