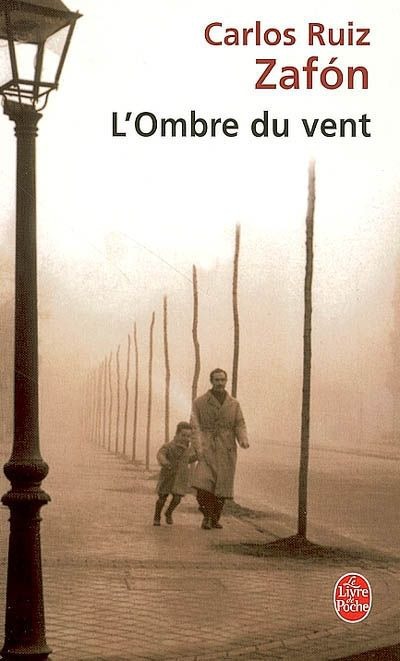![L'ombre du vent]()
L'ombre du vent
tôt. Telle était du moins la rumeur circulant dans
l'escalier. Il essaya alors de parler au chapelier, qui passait toutes ses jour nées enfermé dans son magasin,
rongé par la rage et l'humiliation. Miquel lui expliqua qu’il était venu
chercher une lettre qui avait dû arriver au nom de son fils Julián. La seule
réponse de Fortuny fut :
– Je n'ai pas de fils.
Miquel Moliner repartit sans
savoir que la lettre avait échoué dans les mains de la concierge de l'immeuble
et que, des années plus tard, toi, Daniel, tu la trouverais et lirais les mots
que Penélope avait adressés, cette fois du fond du cœur, à Julián et qu'il
n'avait jamais reçus.
Au moment où il sortait de la
chapellerie, une voisine d'escalier qui dit s'appeler Viçenteta l'aborda en lui
demandant s'il cherchait Sophie. Il répondit par l'affirmative.
– Je suis un ami de Julián.
Viçenteta l'informa que Sophie
habitait une pension située dans une ruelle derrière l'immeuble de la Poste, en
attendant le départ du bateau qui devait la mener Amérique. Miquel se rendit à
cette adresse et gravit un escalier étroit et misérable, privé de la lumière du
jour. Au quatrième étage de cette spirale crasseuse aux marches de guingois, il
trouva Sophie Carax dans une chambre sombre et humide. La mère de Julián était
assise face à la fenêtre sur un sommier où deux valises, qu'elle n'avait même
pas défaites, gisaient comme des cercueils scellant ses vingt-deux années
barcelonaises.
En lisant la lettre signée par
Penélope que Jorge Aldaya avait remise à Julián, Sophie versa des larmes de
rage.
– Elle sait, murmura-t-elle.
Pauvre petite, elle sait...
– Elle sait quoi ?
demanda Miquel.
– Tout est ma faute, dit
Sophie. Tout est ma faute.
Miquel lui tenait les mains,
sans comprendre. Sophie n'eut pas le courage d'affronter son regard.
– Julián et Penélope sont
frère et sœur, murmura-t-elle.
3
Bien des années avant de
devenir l'esclave d'Antoni Fortuny, Sophie Carax était une jeune fille qui
devait subvenir à ses besoins par elle-même. Elle avait à peine dix-neuf ans
quand elle était arrivée à Barcelone où l'attendait un emploi qu'elle ne put
garder. Avant de mourir, son père lui avait procuré des références pour qu'elle
puisse entrer au service des Benarens, une famille prospère de commerçants
alsaciens établis à Barcelone.
– A ma mort, lui avait-il
recommandé, va les voir, et ils t'accueilleront comme leur enfant.
L'accueil, en effet, avait été
chaleureux. Trop chaleureux, hélas. Car M. Benarens avait décidé de la recevoir
à bras et gonades ouverts. Mme Benarens, non sans s'apitoyer sur elle et sur sa
mauvaise fortune, lui avait donné cent pesetas avant de la mettre à la rue.
– Tu as la vie devant toi, et
moi je n'ai que ce mari misérable et lubrique.
Une école de musique de la rue
Diputación s'arrangea pour lui procurer du travail comme professeur particulier
de piano et de solfège. Il était alors de bon ton que les filles de bonne
famille soient instruites dans les arts de société et possèdent quelques
notions de la musique pratiquée dans les salons, où la polonaise était réputée
moins dangereuse que les conversations ou les lectures osées. Sophie Carax
commença donc à visiter régulièrement des hôtels particuliers où des femmes de
chambre amidonnées et muettes la conduisaient aux salles de musique retrouver
la progéniture hargneuse de l'aristocratie industrielle, qui se moquait de son
accent, de sa timidité ou de sa condition de domestique tout juste bonne à
servir de métronome. Avec le temps, elle apprit à se concentrer sur la mince part
des élèves, pas plus de dix pour cent, qui s'élevaient au-dessus de leur
condition de petits animaux parfumés, et à oublier les autres.
Sur ces entrefaites, elle fit
la connaissance d’un jeune chapelier (puisque, tout fier de sa profession,
c’est ainsi qu'il se présentait). Antoni Fortuny, pour qui elle ressentait une
chaude sympathie et rien de plus, ne tarda pas à lui proposer le mariage, offre
que Sophie déclinait une douzaine de fois par mois. Chaque fois qu'ils se
quittaient, Sophie décidait de ne plus le revoir, car elle ne souhaitait pas le
blesser. Le chapelier, imperméable à ses refus, revenait à l'assaut en
l'invitant à un bal, une promenade ou à un chocolat avec des meringues rue
Canuda. Seule à Barcelone, Sophie résistait difficilement à son
Weitere Kostenlose Bücher