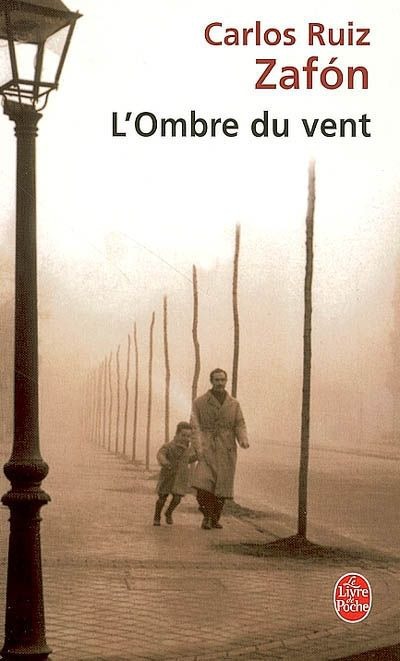![L'ombre du vent]()
L'ombre du vent
été. Les temps étaient difficiles, ils avaient besoin de la chambre.
Ils me conseillèrent de faire admettre Julián dans une institution telle que
l'asile de Santa Lucia, mais je refusai. En octobre 1937, je l'installai chez
moi. Il n'avait pas prononcé un mot depuis ce « Laisse-moi ».
Chaque jour, je lui répétais
que je l'aimais. Il était assis dans un fauteuil face à la fenêtre, sous des
épaisseurs de couvertures. Je le nourrissais de jus de fruits, de pain de mie
grillé et, quand il y en avait, de lait. Je lui faisais deux heures de lecture
par jour. Balzac, Zola, Dickens... Son corps commençait à reprendre du volume.
Peu après son retour à la maison, il put bouger les mains et les bras. Son cou
redevenait mobile. Parfois, en rentrant, je trouvais les couvertures rejetées,
des objets épars sur le sol. Une fois, je le découvris en train de ramper par
terre. Un an et demi après l'incendie, par une nuit de tempête, je me réveillai
à minuit. Quelqu'un était assis sur mon lit et me caressait les cheveux. Je lui
souris, en dissimulant mes larmes. J'avais caché mes miroirs, mais il avait
réussi à en trouver un. D'une voix cassée, il me dit qu'il avait été transformé
en monstre : celui qui, dans ses romans, s'appelait Laín Coubert. Je
voulus l'embrasser, lui montrer que son aspect ne me répugnait pas, mais il
m'en empêcha. Bientôt, il ne me permit même plus de le toucher. Il reprenait
des forces de jour en jour. Il tournait en rond dans la maison pendant que je
faisais les courses. Les économies laissées par Miquel nous mettaient de survivre, mais je dus
bientôt vendre mes bijoux et mes meubles anciens. Quand je
fus au bout, je pris le stylo de Victor Hugo,
décidée à en tirer le meilleur prix possible. Je
trouvai derrière le Gouvernent Militaire une boutique qui faisait commerce d'objets
de ce
genre. Le gérant ne sembla pas impressionné quand je lui jurai que ce stylo
avait appartenu au grand poète, mais reconnut qu'il s'agissait, d'une pièce exceptionnelle et m'en donna
un bon prix, compte tenu des circonstances, en ces temps de pénurie et de misère.
Quand j'annonçai à Julián que je
l’avais vendu, j'eus peur qu'il ne se mette en colère.
Il se contenta de me répondre que j'avais bien fait, qu'il
ne l'avait jamais mérité. Un jour où j'étais partie encore un fois à la
recherche d 'un travail, je ne le trouvai pas à mon retour. Il ne
rentra qu’à l’aube. Quand je lui demandai où il était allé, il se borna à vider
les poches de son imperméable (qui avait appartenu à Miquel) et à poser une
poignée d'argent sur la table. Dès lors, il se mit à sortir tous les soirs.
Dans l'obscurité, masqué par un chapeau et une écharpe, avec ses gants et sa
gabardine, il n'était qu’une ombre parmi d'autres. Il ne me disait jamais où il
allait. Il rapportait presque toujours de l’argent ou des bijoux.
Il dormait le matin, assis dans son fauteuil, le corps et
les yeux ouverts. Une fois, je trouvai un couteau dans sa poche. Un couteau à
ressort avec une lame à double tranchant. La lame était maculée de taches
sombres.
C'est alors que je commençai à
entendre parler dans la rue d 'un individu qui brisait les
vitrines des librairies la nuit et brûlait des livres. Parfois, le vandale se
glissait dans une bibliothèque ou dans le salon d’un collectionneur. Il
emportait toujours deux ou trois volumes, qu’il réduisait en cendres. En
février 1938, je demandai dans une librairie d'occasion s'il était possible de
se procurer un livre de Julián Carax. Le libraire me dit que non :
quelqu'un les avait tous fait disparaître. Lui-même en avait eu deux ou trois
et les avait vendus à un personnage très étrange, qui cachait son visage et
dont la voix était difficilement audible.
– Jusqu'à ces derniers temps,
il en restait encore quelques exemplaires dans des bibliothèques privées, ici
ou en France, mais beaucoup de collectionneurs préfèrent s'en défaire. Ils ont
peur, disait-il, et je ne leur donne pas tort.
Il arrivait que Julián
disparaisse des jours entiers. Bientôt ce furent des semaines. Il partait et
revenait de nuit. Il rapportait toujours de l'argent. Il ne donnait jamais
d'explications, ou alors se limitait à des détails insignifiants. Il me dit
qu'il s'était rendu en France. Paris, Lyon, Nice. Parfois arrivaient au nom de
Laín Coubert des lettres de là-bas. Elles étaient adressées par des libraires
d'occasion, des
Weitere Kostenlose Bücher