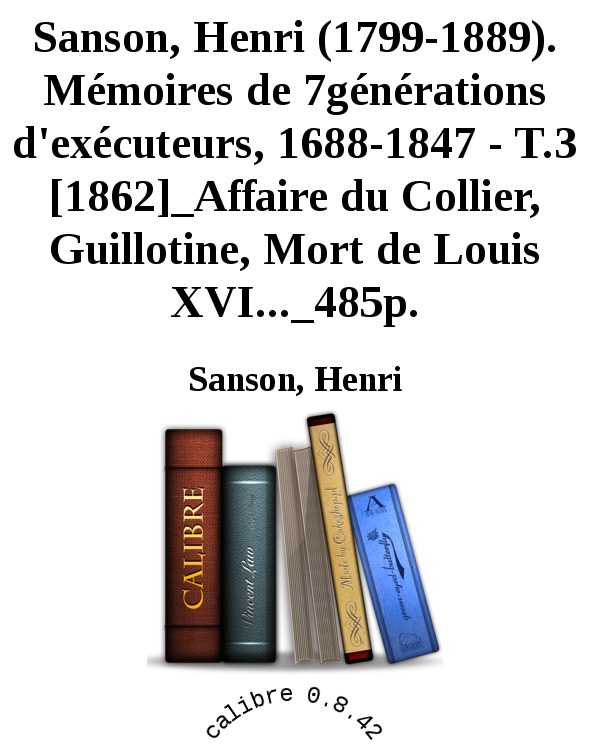![Mémoires de 7 générations d'exécuteurs]()
Mémoires de 7 générations d'exécuteurs
s’arracher de ses bras. Elle avait la triste conviction de ne plus les revoir, tant les rapports qui lui avaient été faits l’avaient alarmée et tant elle était persuadée que, de quelque manière que cette horrible journée se terminât, elle allait mettre en péril les existences qui lui étaient chères.
Mon père prit congé du sien et de ses oncles pour aller rejoindre son bataillon posté sur la place de la Révolution à sept ou huit mètres de la guillotine, que les aides commençaient à dresser. La place était littéralement encombrée de troupes de toutes armes, parmi lesquelles on remarquait surtout le bataillon des Marseillais qui avait pris position sur le terrain à droite en venant des boulevarts ; ce bataillon avait avec lui ses canons qui étaient braqués sur l’échafaud.
Je laisse pour la suite de cette relation la parole à Charles-Henry Sanson. ;
« Le sacrifice est consommé !… Je suis parti ce matin à huit heures, après avoir embrassé ma pauvre femme et mon fils que je n’espérais plus revoir, je suis monté dans un fiacre avec mes deux frères Charlemagne et Louis-Martin. La foule était si grande dans les rues qu’il était déjà près de neuf heures lorsque nous arrivâmes sur la place de la Révolution. Gros et Barré, mes aides, avaient fait monter la machine et c’est à peine si je l’ai examinée tant je pensais qu’elle ne servirait point. Mes frères et moi nous étions solidement armés, nous avions sous nos houppelandes outre nos épées, des couteaux-poignards, quatre pistolets passés dans notre ceinture, une boîte à poudre et nos poches pleines de balles. Nous pensions bien qu’on ferait une tentative pour délivrer ce malheureux prince, et que nous ne saurions être munis de trop de moyens pour lui frayer un passage.
Aussitôt arrivé sur la place, j’ai cherché des yeux mon fils et je l’ai aperçu à peu de distance de moi avec son bataillon. Il me regardait d’un air d’intelligence et paraissait m’encourager en me flattant de l’espoir que cette fois je ne boirais pas le calice jusqu’à la lie. Je prêtais une oreille inquiète pour savoir si je n’entendrais point quelque bruit qui fut l’indice d’une de ces tentatives de délivrance qu’on m’avait annoncées hier. Je me réjouissais à la pensée qu’à cette heure le roi venait peut-être d’être arraché à son escorte et fuyait sous la sauvegarde d’amis dévoués, à moins que ce peuple inconstant et mobile, dont il est si aisé de changer les sentiments, ne l’ait pris sous sa protection toute puissante et n’ait fait tourner en ovation, le supplice qu’on lui avait préparé.
Pendant que je me berçais ainsi de chimères, que je me laissais aller à ce rêve, quel réveil m’attendait !
De temps à autre mes yeux plongeaient avec anxiété du côté de la Madeleine. Tout à coup je vois déboucher un corps de cavalerie, et, peu après, une berline attelée de deux chevaux, entourée aussi d’une double haie de cavaliers et escortée d’un nouveau détachement de la même arme. Plus de doute possible, plus d’illusion, c’est le martyr qui s’avance. Ma vue se trouble, un frémissement universel s’empare de moi ; je jette les yeux sur mon fils : je vois aussi une pâleur livide couvrir son visage.
Pendant ce temps, la berline arrive. Le roi était assis dans le fond, à droite, ayant à côté de lui un prêtre, son confesseur, et sur la banquette de devant il y avait deux maréchaux-des-logis de la gendarmerie. La voiture s’arrête, la portière s’ouvre : les deux gendarmes descendent les premiers, ensuite ce vénérable prêtre vêtu du costume proscrit que j’avais cessé de voir depuis quelque temps et enfin le roi, plus digne, plus calme, plus majestueux que je ne l’avais vu à Versailles et aux Tuileries.
En le voyant approcher de l’escalier, je jette un regard désespéré autour de moi ; partout je n’aperçois que de la troupe. Le peuple, relégué derrière cette soldatesque, semble frappé de stupeur et garde un morne silence. Le roulement des tambours, qui ne cessent de battre, étoufferait d’ailleurs ses cris, s’il en poussait qui fussent un appel à la pitié. Où sont donc ces sauveurs tant annoncés ? Charlemagne et moi, nous sommes consternés ; Martin, plus jeune et plus ferme, s’avance, et, se découvrant respectueusement, fait observer au roi qu’il faudrait qu’on lui ôtât son habit.
— C’est
Weitere Kostenlose Bücher