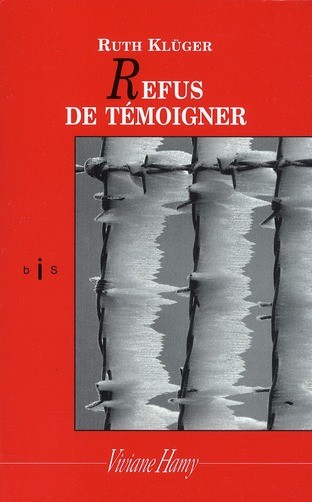![Refus de témoigner]()
Refus de témoigner
l’engagement de ma mère qui lui avait permis d’émigrer.
Mais ensuite, pour nous, elle ne put réunir l’argent nécessaire, car les biens
immobiliers avaient été confisqués et les comptes en banque bloqués. De sorte
que nous restâmes coincées, alors qu’il put s’enfuir. Et cependant, c’est nous
qui avons survécu, et lui pas. Cette histoire tourne en rond et plus on la
poursuit, plus elle devient absurde.
Donc, mon père sortit d’abord de prison et revint à la
maison. Entre-temps, nous avions déménagé, nous habitions dans le 13 ème arrondissement, à Hietzing, l’immeuble qui avait appartenu à mes grands-parents
défunts, et nous partagions l’appartement avec la tante et l’oncle de ma mère. C’était
en 1940, on était déjà en guerre. Je ne me rappelle d’ailleurs pas le début des
hostilités. En revanche, je me souviens très précisément du jour de l’invasion
de la Tchécoslovaquie, presque un an jour pour jour après l’ Anschluss :
un cousin se précipita pour l’apprendre à ma mère, avec cette excitation
joyeuse des enfants quand ils peuvent apporter des mauvaises nouvelles où ils
ne sont pour rien. Les grandes personnes évoquèrent la menace d’une guerre imminente,
et à un moment je dis : « Quand ce sera la guerre… » On me fit
remarquer qu’on était déjà en guerre, et j’eus honte d’avoir été si bécasse. Il
faut croire qu’un événement en occulte un autre car le mot guerre n’évoquait
pour moi rien de précis, sinon des combats : or, dans ma Vienne, il n’y en
avait pas. En revanche, j’imaginais fort bien que les Allemands étaient
désormais là où était Schorschi. On m’avait raconté que papa était parti en
voyage, mais ce n’était pas croyable, je n’étais pas sourde, et donc je
retournais cette énigme, avec inquiétude. On ne pouvait pas faire confiance aux
grandes personnes. Elles exigeaient qu’on dît la vérité, même sur des petites
choses, et elles mentaient elles-mêmes impudemment, même dans des cas critiques
comme celui-là. Le mensonge officiel m’interdisait de m’informer en posant des
questions, jusqu’au jour où le retour de mon père annula le mensonge sans qu’on
s’en excusât.
Il y eut un grand déjeuner, avec beaucoup de famille, et j’avais
invité ma meilleure amie afin de lui montrer mon père sorti de prison. Il
parlait aux grandes personnes, tout le monde l’écoutait, et moi je voulais
attirer son attention. Je voulais être présente, être perçue, qu’il y ait un
contact entre nous. Je finis par l’importuner et, sous les yeux de mon amie
atterrée, il me flanqua une raclée et m’enferma. À moins qu’il ne m’ait
seulement mise à la porte de la salle à manger. L’amie ne savait que dire ni où
regarder, moi non plus. C’est la dernière impression forte que mon père m’ait
laissée : la frayeur, la violence, un sentiment d’injustice et d’humiliation.
Les sentiments ainsi nourris de souvenirs sont impossibles à corriger. Est-ce
que, peut-être, je lui en veux de sa mort parce que l’enfant battue n’eut plus
l’occasion de se réconcilier avec lui ? Comme si sa vie inachevée n’avait
eu d’autre sens que d’écouter mes pleurnicheries d’enfant de huit ans, ou de
recevoir mes excuses et mes explications ultérieures.
En prison, il avait appris la Chanson de Buchenwald :
« Ô Buchenwald, je ne puis t’oublier, / Car tu es mon destin. / Entrés
ici, on sait / La merveille qu’est la liberté. » Dans les camps de
concentration, on n’a pas écrit de grande poésie. Autrement, on pourrait
prétendre que ces camps ont tout de même été bons à quelque chose, à quelque
mortification purifiante d’où serait sorti du grand art. Mais ils n’ont été
bons à rien du tout. Je retins aussitôt par cœur les paroles de la chanson.
Mon père a encore repoussé son départ de plusieurs jours. Puis
il est venu me dire au revoir dans mon lit, avant que je m’endorme. J’étais
encore sous l’impression du châtiment récent. Je n’arrivais pas à imaginer qu’il
me quittait à contrecœur, et j’avais peur de lui. C’est la deuxième photo qui
me reste de mon père. Elle le montre comme ce dernier soir, grave, le cheveu
déjà plus très fourni, avec aux tempes le début d’une calvitie qu’il n’aurait
jamais. Je ne l’ai plus revu.
Ma mère l’a accompagné à la gare. Elle dit : « Il
s’est penché à la portière et il a crié :
Weitere Kostenlose Bücher