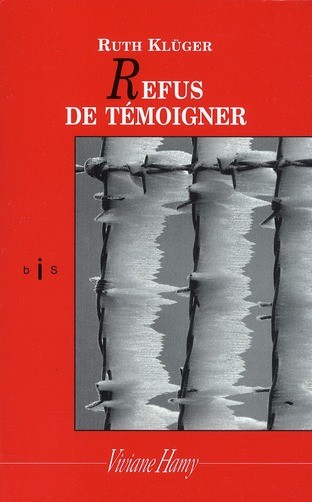![Refus de témoigner]()
Refus de témoigner
d’usine fortuné. D’ailleurs,
ce père la maria d’abord à un autre, qui était un meilleur parti. Les livres d’Arthur
Schnitzler, mort à Vienne dix jours avant ma naissance (c’est important pour
moi, il est un ancêtre, je pense qu’il m’a légué sa Vienne), m’en apprennent
presque plus sur mes parents que mes souvenirs. L’autre était un raseur,
un pédant et un avare, d’après la tradition familiale. Mes parents, des jeunes
gens à la Schnitzler, l’étudiant et la femme du pédant avare, eurent une
liaison, qui se déroula entre Vienne et Prague, deux villes entre lesquelles on
pouvait à l’époque faire aisément la navette – ensuite ça n’a plus été possible,
et ça ne l’est redevenu quasiment qu’avant-hier. Prague me parut une ville
inaccessible, quelques années plus tard, connue seulement par les descriptions
de ma mère, lorsqu’il fut question d’aller y chercher son fils, mon demi-frère
Jiri, en allemand Georg, en autrichien Schorschi. Ce qui fut impossible.
Ma mère divorça – fait peu banal –, son père lui pardonna et
la dota pour ce second mariage. Mon frère, l’enfant de cette nouvelle de
Schnitzler avec un zeste de Werfel ou de Zweig, arriva donc de Prague à Vienne
avec notre mère, qui, ainsi, put enfin avoir pour quelques années ce qu’elle
avait désiré, le fringant étudiant en médecine de famille pauvre, laquelle
penchait plutôt du côté de Joseph Roth : neuf enfants, la mère veuve. Mon
père était le septième, et le seul qui eût fait des études ; il était
entre-temps devenu médecin, et voilà qu’il avait une femme avec une dot, et qu’au
bout d’un an ils avaient un enfant. Une fille, certes, mais tout de même. Tout
allait bien pour eux.
Là commence ma mémoire. Mon demi-frère, qui avait six ans de
plus que moi, possédait une lampe de poche qu’on pouvait allumer sous les
couvertures, de cette manière on y voyait très clair bien que la lumière fût
éteinte dans la chambre (un jeu interdit, sans doute parce que, dans la ville
de Freud, il était mal vu que frère et sœur se serrent de trop près) ; il
lisait Jules Verne aux cabinets au lieu d’aller à l’école, ça provoquait des
scènes ; il jouait avec ses amis à Winnetou et Old Shatterhand, et moi j’avais
tout juste le droit d’être la sœur de Winnetou, Fleur de Prairie, assise devant
la tente (pas très satisfaisant, mais c’était mieux que rien) ; il se
battait, dans le jardin de grand-père, en patriote tchèque défendant Masaryk
contre ses contemporains autrichiens qui prétendaient que Schuschnigg était
mieux ; il avait un vélo, moi pas ; il avait des livres pour enfants
en tchèque, et il était effectivement capable de les lire (quand il a été parti,
je les ai feuilletés quelquefois, surprise par tous ces petits accents, et
étonnée de la science secrète de Schorschi) ; il se mettait plus d’une
fois en colère contre moi et, à l’occasion, jouait avec moi.
Et puis c’est tout. Le reste m’a été raconté. Il fut mon
premier modèle, et sans doute le seul à l’être sans restriction. Je voulais
devenir comme lui, autant que c’était possible pour une fille. Un jour, il
disparut.
Ma mère errait, les yeux rouges, en pestant contre son ex,
« le Mendel », qui n’avait pas laissé revenir le garçon à la fin des
vacances. Un tribunal de Prague avait retiré la garde de Schorschi à sa mère et
l’avait attribuée au père. Motif : l’éducation allemande que ce petit Juif
tchèque subissait prétendument à Vienne. Ma mère : « Après 1918, les
Juifs sont devenus plus tchèques que le roi Venceslas en personne. » Le
nationalisme s’abattit sur le petit garçon et son petit pays comme une des
plaies de l’Égypte. Je me réjouis rétrospectivement que, dans le jardin de grand-père,
Schorschi ait choisi le bon héros, en la personne de Masaryk, contre
Schuschnigg, le contesté chancelier de l’Anschluss : mais c’est pur
hasard. Ce qui comptait exclusivement pour les garçons, quand ils prenaient
ainsi parti, c’étaient les racines qu’ils croyaient avoir.
Ce fut ma première grande perte. J’étais désemparée. Je ne
perdais pas seulement un proche que j’aimais, je perdais aussi un rôle : celui
de petite sœur. « Il reviendra », disaient mes parents pour me
consoler. « Il faut savoir attendre. »
Quand on attend assez longtemps, c’est la mort qui arrive. Il
faut savoir s’enfuir. Un
Weitere Kostenlose Bücher