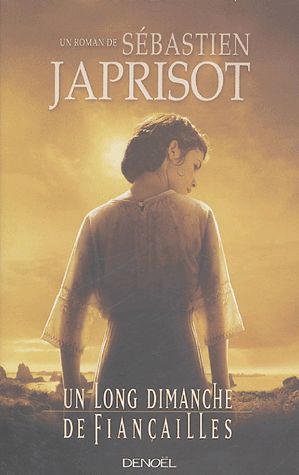![Un long dimanche de fiancailles]()
Un long dimanche de fiancailles
n'avions pas eu le cœur de nous moquer de nos misères,
nous n'aurions pu survivre - car la dérision, en toutes
choses, est l'ultime défi au malheur, je vous demande pardon,
il faut me comprendre, elle comprend.
Mais
de grâce, qu'il continue.
Les
cinq condamnés venaient à pied, les bras liés
dans le dos, poursuit l'ancien sergent après un accès
de toux, et sa toux est une suite de sifflements acérés
comme des coups de rasoir. Ils étaient encadrés par des
dragons à cheval, en bleu horizon comme nous tous. Celui qui
commandait ce peloton, un adjudant de petite taille, n'avait pas
envie de s'attarder. Il avait croisé les Sénégalais,
qui s'étaient rangés de mauvais poil sur les bas-côtés
pour libérer la route. Il s'était senti mal à
l'aise, et ses hommes aussi, de passer entre deux haies de regards
peu amènes. Il m'a dit : “Ces bamboulas devaient
nous prendre pour des gendarmes, encore heureux qu'on nous ait pas
fait un mauvais parti."
Nous
avons comparé nos listes de prisonniers. Il tenait à ce
que je vérifie l'identité de chacun et que tout soit en
règle. Après quoi, il m'a demandé d'écrire
la date, au quart d'heure près, et d'apposer ma signature au
bas de sa propre liste, en manière de décharge. La
guerre m'a appris à me méfier de tout, en particulier
de signer des papiers dont on ne sait pas sur quel bureau ils vont
atterrir, mais il était mon supérieur, le
lieutenant-médecin m'a dit d'emblée être là
pour soigner des blessures et rien d'autre, j'ai obéi.
Satisfait, l'adjudant est remonté en selle, m'a souhaité
bon courage, et tous les dragons s'en sont allés, dans un
grand nuage d'haleine blême.
J' ai
fait délier les prisonniers. Ils se sont assis, de çà,
de là, sur une vieille poutre ou un pan de mur effondré.
On leur a donné à boire et des biscuits. Ils étaient
seuls en eux-mêmes, pas lavés depuis plusieurs jours,
ils avaient froid.
La
liste dactylographiée que m'avait donnée mon
commandant, je l'ai encore, elle est là, dans une poche de mon
peignoir, avec d'autres choses que je vous remettrai tout à
l'heure. Vous y trouverez leurs noms et leurs prénoms, mais
j'ai pris le pli des tranchées, il m'est plus facile de les
appeler comme on les appelait à la guerre.
Le
plus âgé des cinq, trente-sept ans, était un
menuisier parisien du quartier de la Bastille. On l'appelait
Bastoche, mais plus souvent l'Eskimo, parce qu'il avait couru le
Grand Nord dans sa jeunesse. Je ne lui ai pas beaucoup parlé à
ce moment-là, dans ce village en ruine, mais il avait à
ses pieds des bottes allemandes et je me suis étonné
qu'on les lui ait laissées. Il m'a dit : “On m'a pris comme ça. J ' ai réclamé
des godillots mais on me les a refusés." Je me suis
étonné aussi qu'il n'ait pas été mobilisé
dans la territoriale. Il m'a dit qu'il était rentré
d'Amérique, pour son service, avec trois ans de retard. De
toute manière, on bouchait maintenant les trous, dans les
bataillons, avec plus vieux que lui. Je lui ai dit : “Eh bien, c'est malin ce que tu as fait." Il m'a répliqué
qu'il n'avait rien fait du tout, que c'était un accident, et
une belle saloperie de l'avoir condamné. Il me regardait droit
dans les yeux.
Un
deuxième, trente et un ans, était un caporal dégradé
qu'on appelait Six-Sous, j'ignore pourquoi.
Lui,
il affirmait hautement s'être tiré un coup de fusil
exprès, que si c'était à refaire, il
recommencerait. Il m'a traité, sauf mon respect, de
traîne-savates des assassins. Il était soudeur en
banlieue de Paris et syndicaliste écarlate. Il avait la
fièvre. La douleur l'empêchait de dormir depuis
plusieurs jours. Je suivais le lieutenant-médecin tandis qu'il
allait de l'un à l'autre pour nettoyer les blessures et
refaire les pansements.
De
tous, Six-Sous était le plus salement touché. Le
lieutenant m'a dit, après l'avoir soigné : “C'est
une chance pour lui, cette neige. On serait en été, la
gangrène l'emporte plus vite que ce qui l'attend. ”
Un
autre était un Marseillais de vingt-six ans, récupéré
dans les prisons, qu'on appelait Droit Commun. Il était pâle
et exténué. Comme ce n'était pas indiqué
sur ma liste, je lui ai demandé son métier dans le
civil. Il m'a dit : “ J'en ai pas. Je suis un pauvre fils
d'étranger, c'est marqué noir sur blanc dans mon livret
militaire. Alors, si je suis pas vraiment français, pourquoi
on me tue ? ” Il a pris la
cigarette que je lui offrais en me
Weitere Kostenlose Bücher