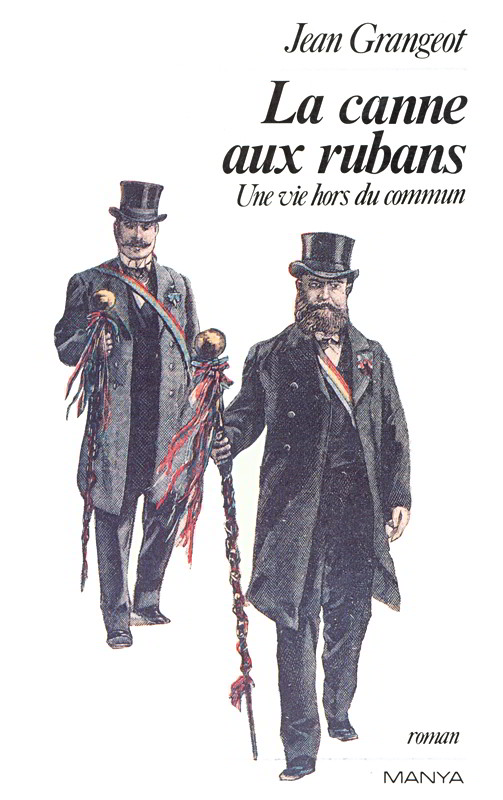![La canne aux rubans]()
La canne aux rubans
trente-neuvième année lors de la bataille victorieuse de la
Malmaison. Frédéric, qui écrit peu, semble bénéficier d’une chance
incommensurable. Il a été décoré plusieurs fois pour son attitude qui frise
l’héroïsme permanent. Je le rencontre, par le plus grand des hasards, dans un
village où il est au repos. Il a gardé un petit sourire narquois, mais son
esprit a changé. Il lui aura fallu cette guerre, grande mangeuse d’hommes, pour
qu’il devienne adulte.
Mars 1917. Il fait très froid. Après une mauvaise nuit, de
mon bureau, j’admire les branches givrées des arbres qui bordent les routes
impraticables en voiture. J’en profite pour remettre un peu d’ordre dans mes
papiers, quand, Marie, brusquement ouvre la porte. Sa pâleur m’inquiète.
— Viens tout de suite Adolphe !… Maman te demande.
Je bondis dans sa chambre au premier étage. Elle git dans
son lit, les yeux grands ouverts, son petit bonnet de dentelle sur la tête. De
la main, elle me demande d’approcher et me murmure :
— Je vais rejoindre ton père. Il m’attend. Veille sur
ta famille. Adieu mon grand.
Sa tête tombe sur le côté, ses doigts serrent un pli du drap
et un dernier souffle sort de sa poitrine. Nous nous regardons Marie et moi, ne
réalisant pas immédiatement ce qui vient de se produire. Ma sœur prend un petit
miroir sur la table de nuit et le colle presque devant le nez et la bouche de
notre mère. Aucune buée n’apparaît. C’est fini, nous sommes tous orphelins. À
genoux, de chaque côté du lit, nous pleurons. J’ai l’impression qu’une partie
de moi-même s’endort pour ne plus jamais revivre. Je n’entendrai plus sa voix
douce ignorant la colère ou les mots blessants. « La Nanette », comme
l’appelait mon père avec respect et amour, n’est plus. Elle fait partie de nos
morts, c’est-à-dire de ceux que l’on ne regarde qu’avec les yeux clos du
souvenir. Je m’arrêterai souvent de travailler pour penser à elle,
m’interrogeant sur mes devoirs de fils durant son vivant, me ressassant des
bricoles qui prennent maintenant une importance sans doute démesurée. Mais, il
y a beaucoup plus grave, ne m’avait-elle pas demandé de me marier et de lui
donner des petits-enfants ? Dans mon égoïsme et mon orgueil farouche, je
ne lui ai apporté qu’un certain confort matériel et expédié que des lettres, du
papier noirci de mon écriture hachée, souvent illisible. Tout est trop tard, et
je me sens mal à l’intérieur de ma sale carcasse.
— Marie va prévenir le curé et la mairie. Elle sera
enterrée à côté de notre père dans l’intimité de la terre, là ou les morts se
comprennent et se chuchotent leurs secrets.
Nous retournons à Saint-Aignan pour les obsèques. Nous
trouvons, à notre arrivée, un courrier de Frédéric qui, n’ayant pas droit à une
permission, demande pardon à sa mère en mettant à jour sa conscience. Cette
vérité, crachée toute nue et toute crue, témoigne de son éventuel rachat.
La guerre se poursuit, atroce, stupidement menée par des
généraux imbus de leur pouvoir et pour qui la chair à canon est quantité
négligeable. Quelques rebellions éclatent ça et là. Le Canada, les États-Unis,
le Portugal, la Roumanie, la Grèce et bien d’autres entrent dans la bataille à
nos côtés. Les besoins en matériel et en matériaux se font de plus en plus
sentir. Je tente de répondre à toutes les demandes qui me sont faites.
À Neufchâteau, j’entreprends la construction d’un hôpital de
mille cinq cents lits. Je dois monter des scieries à Gex et exploiter des
forêts dans tous les coins de France. En Normandie, j’achète des terrains
plantés de réserves de sapins de belle essence. J’y monte également quelques
usines de ferrailles et des serrureries. Je place à chaque fois un homme de
confiance à la direction. Mon choix se fait sur un coup de cœur ou un
pressentiment.
On me réclame à Corfou pour des hangars d’aviation, à
Saint-Cyr-l’École pour des ateliers et des baraquements. Je vais même jusqu’à
démonter un hangar de dirigeable dans la zone des armées pour le réinstaller à
Paimbœuf. En contrepartie, je subis de grosses pertes. Le déplacement des
fronts, les reculs de notre armée, les lieux des combats extrêmement violents
me font perdre des propriétés, comme celle d’Estrées-Saint-Denis comprenant une
forêt de cent quarante hectares et une ferme de deux cents. À côté
Weitere Kostenlose Bücher