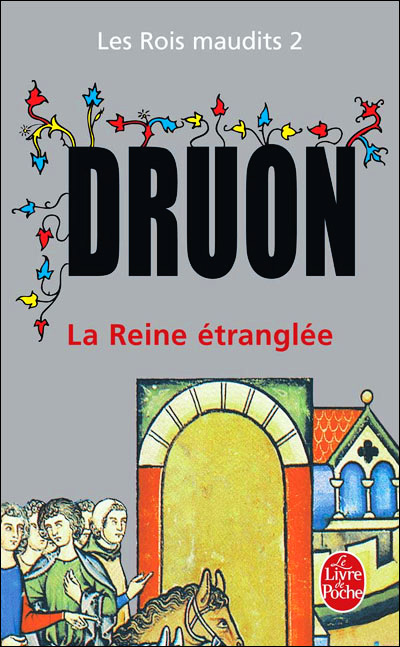![La Reine étranglée]()
La Reine étranglée
il me semblait bien… Vous
voici donc…
Des larmes étaient venues aux yeux
de dame Eliabel, et elle prit appui sur un meuble, comme si la surprise la
faisait vaciller. Elle avait maigri de vingt livres, et vieilli de dix ans.
Elle flottait dans sa robe qui naguère se tendait bien fort sur ses hanches et
sa poitrine ; elle montrait une mine grise, et des joues affaissées sous
sa guimpe de veuve.
Guccio, pour dissimuler sa surprise
à la voir si changée, regarda la grand-salle autour de lui. Auparavant on y
percevait une certaine dignité de vie seigneuriale maintenue malgré de petits
moyens ; aujourd’hui, tout y disait la misère sans défense, le dénuement
désordonné et poussiéreux.
— Nous ne sommes point dans
notre meilleur pour accueillir un hôte, dit tristement dame Eliabel.
— Où sont vos fils ?
— À la chasse, comme chaque
jour.
— Et mademoiselle Marie ?
demanda Guccio.
— Hélas ! fit dame Eliabel
en baissant les yeux.
— Qu’est-il arrivé ?
Dame Eliabel haussa les épaules,
d’un geste de désolation.
— Elle est si bas, dit-elle, si
faible que je n’espère plus qu’elle se relève jamais, ni même qu’elle atteigne
Pâques.
— Quel mal a-t-elle ? dit
Guccio avec une impatience anxieuse.
— Mais le mal dont nous
souffrons tous et dont on meurt à foison par ici ! La faim, signor Guccio.
Pensez donc, si de gros corps comme l’était le mien sont tout épuisés, pensez
au ravage que la faim peut faire sur des filles encore à grandir ;
— Mais, par Dieu, dame Eliabel,
s’écria Guccio, je croyais que la disette ne frappait que les pauvres
gens !
— Et qui croyez-vous que nous
sommes, sinon de pauvres gens ? Ce n’est point parce que nous avons la
chevalerie et un manoir qui croule que nous sommes mieux lotis. Tout notre
bien, à nous petits seigneurs, est dans nos serfs et dans le labeur que nous en
tirons. Comment pourrions-nous attendre qu’ils nous nourrissent, quand ils
n’ont pas à manger pour eux-mêmes et viennent mourir devant notre porte en nous
tendant la main ? Nous avons dû tuer notre bétail pour le partager avec
eux. Ajoutez à cela que le prévôt nous a obligés de lui fournir des vivres,
d’ordre du roi a-t-il dit, sans doute pour nourrir ses sergents, car ceux-là
sont toujours bien gras… Quand tous nos paysans seront morts, que nous restera-t-il,
sinon que d’en faire autant ? La terre ne vaut rien ; elle ne vaut
qu’autant qu’on la travaille, et ce ne sont point les cadavres qu’on y enfouit
qui la feront produire… Nous n’avons plus ni valets ni servantes. Notre pauvre
boiteux…
— Celui que vous appeliez votre
écuyer tranchant ?
— Oui, notre écuyer tranchant…
dit-elle avec un sourire triste. Eh bien, il est parti pour le cimetière
l’autre semaine. Et tout à l’avenant.
Guccio hocha la tête, d’un air de
compassion. Mais une seule personne, dans tout ce drame, lui importait.
— Où est Marie ?
demanda-t-il.
— Là-haut, dans sa chambre.
— Puis-je la voir ?
— Venez.
Guccio la suivit dans l’escalier
qu’elle gravit d’un pas lent, marche à marche, en s’aidant de la corde de
chanvre qui pendait le long du pivot de la vis.
Marie de Cressay reposait sur un lit
étroit, à l’ancienne mode, où les couvertures n’étaient pas bordées et où les
matelas et les coussins étaient très élevés sous le buste, en sorte que la
personne allongée semblait sur un plan incliné, les pieds piquant vers le sol.
— Messire Guccio… messire
Guccio… murmura Marie.
Ses yeux étaient agrandis d’un cerne
bleu ; ses longs cheveux châtains et or étaient épars sur un oreiller de
velours râpé jusqu’à la trame. Ses joues amincies, son cou fragile,
présentaient une transparence inquiétante. L’impression de rayonnement solaire
qu’elle donnait auparavant s’était effacée, comme si un grand nuage blanc fût
passé au-dessus d’elle.
Dame Eliabel se retira, pour éviter
de montrer ses larmes.
— Marie, ma belle Marie, dit
Guccio en s’approchant du lit.
— Enfin, vous voilà ;
enfin vous êtes de retour. J’ai eu si peur, oh ! si peur de mourir sans
vous revoir.
Elle regardait intensément Guccio,
et ses yeux contenaient une grande question inquiète. Inclinée comme elle se
trouvait par l’étrange entassement des matelas, elle ne semblait pas absolument
réelle, mais découpée dans quelque fresque, ou plutôt dans un vitrail
Weitere Kostenlose Bücher