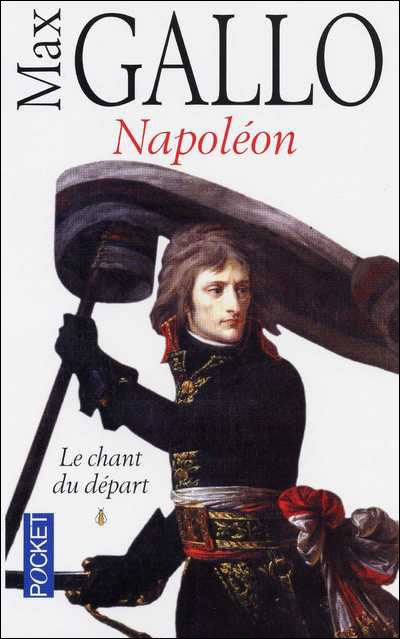![Le chant du départ]()
Le chant du départ
choisi. Mais il dit à Berthollet : « Une puissance supérieure me pousse à un but que j’ignore ; tant qu’il ne sera pas atteint, je serai invulnérable, inébranlable : dès que je ne lui serai plus nécessaire, une mouche suffira pour me renverser. »
Mais pourquoi évoquer cela avec Berthollet ou Monge ? Ces savants éprouvent-ils comme lui cette sensation qu’une force les soutient, ont-ils comme lui des pressentiments, des certitudes que rien n’explique ?
Il sait, lui, que les Anglais ne l’intercepteront pas. Il sait que la France est lasse des guerres entre Jacobins et émigrés, qu’elle veut la paix intérieure, qu’elle attend l’homme qui la lui apportera.
Peut-être cet homme est-il déjà en place ?
C’est sa seule inquiétude.
Le 30 septembre, il contemple les reliefs de la côte corse dans le soleil couchant, puis ce sont les parfums du maquis, et bientôt apparaissent la citadelle et les maisons d’Ajaccio.
Le 1 er octobre, la Muiron jette l’ancre et aussitôt surgissent de toutes parts des embarcations.
Comment ont-ils su ?
Ils crient, ils acclament. Personne ne prête attention à l’obligation de la quarantaine. On veut voir Napoléon, le toucher. On l’embrasse. Il distingue, dans la foule qui maintenant se presse sur le quai, sa nourrice, Camille Ilari, vieille femme qui bientôt le serre contre lui. C’est son enfance, si proche et si lointaine, qu’il embrasse. Il apprend que Louis, qu’il avait envoyé en France en 1798, est passé par Ajaccio puis a gagné le continent avec leur mère.
Napoléon se rend à la maison de campagne de Melilli. Il retrouve dans sa mémoire chaque détail, et cependant il n’éprouve pas d’émotion. Cet univers est enfoui en lui comme un décor dont il est sorti et qui ne le concerne plus, alors qu’on l’entoure de prévenances intéressées. « Quel ennui, murmure-t-il. Il me pleut des parents. »
Il demande les derniers journaux qui sont arrivés de France. Il lit avec avidité les nouvelles, mesure que la situation militaire s’est redressée, que Masséna – « son » Masséna – a remporté des victoires en Italie, que le général Brune résiste dans la République batave, mais que la crise politique couve à Paris, où Sieyès mène le jeu.
Il faut quitter la Corse, arriver à temps.
Enfin, le 7 octobre, le vent se lève, on peut appareiller.
Napoléon se tient à la proue jusqu’à ce que la côte française soit en vue.
C’est le moment le plus périlleux de la traversée. L’escadre anglaise croise le long des côtes. Au large de Toulon, on aperçoit des voiles, qui heureusement s’éloignent.
Le 9 octobre au matin, on entre dans le golfe de Saint-Raphaël.
La citadelle de Fréjus ouvre le feu devant l’arrivée de cette division navale inconnue.
De la proue, Napoléon voit la foule qui se précipite sur les quais puis se jette dans les embarcations, rame vers les frégates, crie : « Bonaparte ! »
L’amiral Ganteaume s’approche au moment où la Muiron est envahie.
— Je vous ai conduits où vos destins vous appellent, dit l’amiral.
Des bras soulèvent Napoléon, le portent en triomphe.
— Il est là ! Il est là ! crie-t-on.
Il descend de la frégate. Sur le quai, un cortège se forme.
Qui pense à la quarantaine, au risque de la peste ?
On prépare une voiture.
Puisqu’il est là, c’est bien que la Fortune l’a protégé.
Qui pourrait m’arrêter ?
Neuvième partie
Oui, suivez-moi.
Je suis le dieu du jour.
9 octobre 1799 – 11 novembre 1799
(20 Brumaire An VIII)
36.
Dix-sept mois qu’il a quitté la France ! C’était le printemps, le mois de mai 1798, et c’est l’automne. Le lit de la Durance est envahi de flots boueux. Le temps est à l’orage, et les averses obligent parfois à retenir les chevaux.
À l’époque, il roulait vers Toulon. Joséphine était près de lui, lui donnant tous les signes de l’attachement. Prête, avait-elle dit, à le suivre en Égypte.
Il sait maintenant ce qu’il en est d’elle, du capitaine Charles, de ses amants.
La fureur et l’amertume envahissent Napoléon dès que les rumeurs de la foule, qui, à chaque village, entoure les voitures, crie : « Vive la République ! Vive Bonaparte ! », se sont estompées et qu’il reste seul avec ses pensées.
Voudrait-il oublier, qu’il lui suffit de regarder Eugène de Beauharnais, assis en face de lui, pour se souvenir.
À Avignon, le peuple arrête les voitures. On
Weitere Kostenlose Bücher