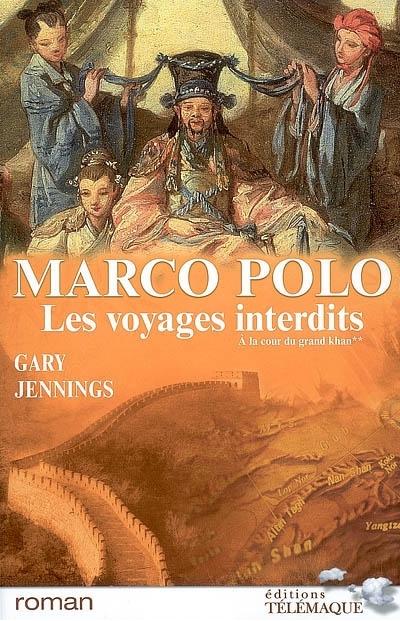![Marco Polo]()
Marco Polo
appelé poulet mao-tai, je
m’attendis à ressentir une certaine ivresse après l’avoir dégusté ; mais
s’il n’était pas arrosé de spiritueux, sa saveur n’en était pas moins d’une
rare et exquise délicatesse. Le majordome m’expliqua que le poulet n’avait pas
été cuit dans le vin, mais tué avec lui. Enivrer un poulet au mao-tai, selon
lui, l’avachissait comme il l’aurait fait d’un homme et lui détendait les
muscles, ce qui le faisait mourir dans une félicité absolue et conférait à sa
chair une tendreté toute particulière.
Il y eut un plat un peu acide et salé, à base de choux
qu’on avait fait fermenter jusqu’à obtenir une bouillie très fine, douce au
goût, que je prisai fort (après m’en être moqué) et que mes compagnons de table
me décrivirent comme un plat de paysan. La première fois qu’il avait été concocté,
en effet, c’était, il y avait fort longtemps, pour les travailleurs affectés à
la construction de la Grande Muraille : cette provende à la fois
économique et facile à transporter avait chez eux fait merveille. Un autre mets
portait, lui, un vrai nom paysan : le riz du mendiant. Pourtant, en dépit
de cette appellation, il y avait fort à parier que bien peu de paysans auraient
pu s’en délecter. Ce qualificatif provenait, selon le majordome, de ce qu’il
s’agissait d’un mélange de restes culinaires. Quoi qu’il en fût, à la table du
palais, ce plat ressemblait au plus riche et varié risotto qui se puisse
concevoir : le riz était accommodé de toutes sortes de coquillages, de
morceaux de porc et de bœuf, d’herbes aromatiques, de germes de haricots, de
jeunes pousses de bambou et de légumes divers, le tout teinté de jaune, non pas
grâce au safran (la Compagnie n’ayant pas encore essaimé à Manzi) mais aux
pétales du gardénia.
Il y avait de croustillants rouleaux de printemps
faits d’omelette et de brins de trèfle cuits à la vapeur, et de la friture de
petits poissons zu-jin qui se dégustaient en entier d’une seule bouchée,
du vermicelle préparé de différentes façons et des cubes de pâte de petits
pois, très doux au goût. La table était également garnie de plateaux de
spécialités locales ; je goûtai presque chacune d’entre elles, les
dégustant d’abord et ne me renseignant qu’ensuite sur leur composition,
de peur que leur nom ne me rebutât a priori. Il y avait là des langues
de coq au miel, de la viande de serpent et de singe accompagnée d’une sauce
savoureuse, des limaces de mer fumées, des œufs de pigeon cuits dans une sorte
de pâte argentée qui n’était autre qu’une bouillie de tendons d’ailerons de
requins. En guise de dessert, on nous servit des coings parfumés, des poires
dorées grosses comme des œufs d’oiseau rukh, quelques-uns de ces
incomparables melons hami et une composition glacée, duveteuse, faite
d’après le majordome « de flocons de neige et de fleurs d’abricots ».
Nous arrosâmes le tout d’un vin kaoliang couleur d’ambre, d’un rosé très
fin et dont la robe était parfaitement assortie aux lèvres de Hui-sheng, et du cha le plus prisé de Manzi, variété appelée le « thé du précieux
tonnerre ».
Ayant achevé notre repas par la traditionnelle soupe,
un clair bouillon de viande et de légumes aromatisé aux dattes et aux prunes,
et après l’apparition très applaudie du cuisinier qui l’avait concoctée, nous
nous rendîmes dans une autre salle pour discuter des affaires qui m’amenaient.
Nous étions une douzaine tout au plus, en comptant le wang et son équipe
ministérielle, tous des Han, dont seuls quelques-uns étaient des Song de
l’ancienne administration ; beaucoup s’étaient déjà rendus à Kithai et
pouvaient donc converser en mongol. Tous, Agayachi compris, arboraient la
longue robe droite élégamment brodée et traînant au sol spécifique aux Han,
dont les manches sont suffisamment amples pour y glisser l’un sur l’autre les
deux bras croisés et y transporter des objets. Le wang débuta cette
discussion d’affaires en me faisant remarquer que j’étais libre de m’habiller
comme bon me semblerait. J’étais alors vêtu à la mode qui était depuis
longtemps ma tenue favorite : un costume persan composé d’un turban, d’un
sarrau dont les manches étaient serrées aux poignets et d’une cape pour
l’extérieur. Il suggéra seulement que je remplace le turban, lors des réunions
officielles, par le
Weitere Kostenlose Bücher