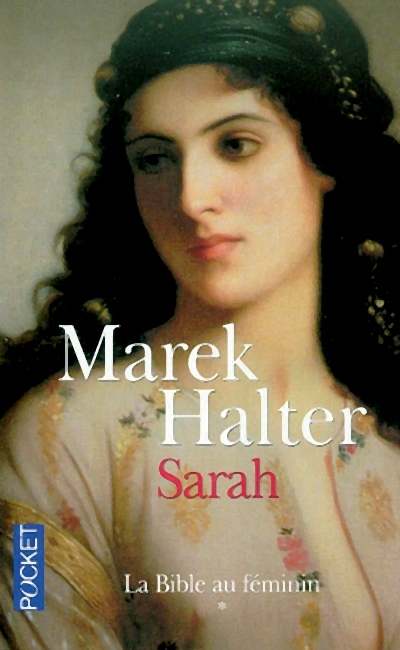![Sarah]()
Sarah
peu d’étonnement.
La procession franchit le pont de bois qui
traversait le canal. Les gardes s’alignèrent sur les côtés de la porte ainsi
qu’ils le devaient. Saraï retint son souffle en s’engouffrant dans la fraîcheur
du mur. Celui-ci était si épais qu’on semblait avancer dans un tunnel. Elle
n’entendit ni cri ni appel.
De l’autre côté s’étendaient des jardins et
des chicanes de marches taillées dans une ancienne muraille. Soudain, Saraï
découvrit l’immense ville basse. Des centaines de rues enchevêtrées se
perdaient au loin sur des dizaines d’us. On en devinait les toits tout
au long de la courbure du fleuve.
Hors les murs de la ville royale, le
désordre saisit la procession. De jeunes garçons s’échappèrent du cortège en se
chamaillant. Des habitants se pressèrent en bordure des rues pour chanter,
danser et frapper dans leurs mains en accompagnant les musiciens. Certains
s’agglutinèrent autour des porteurs de civières. On jeta des pétales, des bols
de parfum ou de bière sur les statuettes. Les cris, les rires et les saluts
noyèrent les chants. Saraï profita de la confusion pour s’engager dans la
première rue venue.
*
* *
Un long moment, elle avança au hasard. Elle
ne reconnaissait rien de ce qui l’entourait. Ici, les maisons n’étaient que des
cubes imbriqués les uns sur les autres. Les portes étaient de simples battants
de bois ou des tentures, les murs recouverts d’un torchis blanc.
Beaucoup de monde allait et venait. Des
gens du commun, vêtus de tuniques ou de pagnes, chaussés de semelles d’osier,
les mollets gris de poussière. Ils bavardaient, riaient, se hélaient, portaient
des paniers ou des sacs, aiguillonnaient des baudets ou poussaient des
charrettes chargées de roseaux ou de melons d’eau. Quelques-uns, femmes ou
hommes, posaient sur Saraï des regards étonnés, mais sans véritable curiosité.
Pour elle, tout était étrange et stupéfiant.
De toute sa jeune vie, elle n’était sortie
de la ville royale qu’une demi-douzaine de fois, toujours pour se rendre dans
les grands temples d’Eridou. Elle traversait alors avec son père le fleuve en
bateau, en direction de l’ouest. La ville basse, la ville du nord, les Puissants
ne s’y rendaient pas. Ils n’avaient pour elle que mépris et défiance. Les
servantes racontaient que les rues, la nuit, pullulaient de démons à peau
noire, d’animaux aux corps multiples, aux mâchoires et aux griffes féroces, et
autres horreurs surgies des cavernes infernales de dessous la terre.
Ici, dans la ville basse, les hommes et les
femmes étaient soumis au pouvoir des Puissants d’Ur, sans jamais voir leur
visage. Si Ichbi Sum-Usur avait besoin des artisans ou des marchands qui
relevaient de ses domaines, il s’adressait pour cela à ses scribes, ses
contremaîtres ou ses régents.
Il suffisait à Saraï de regarder autour
d’elle pour comprendre qu’elle ne trouverait ni aide ni asile. Qui
accueillerait une fille de ville royale, fuyarde de surcroît, sans craindre les
foudres des Puissants ? Cela se saurait, et vite. Il n’y avait aucun
secret possible dans la ville basse. Les gens y vivaient tout autant hors de
leurs maisons que dedans. Les portes étaient le plus souvent ouvertes et les
cours intérieures à la vue des passants. Les enfants, les oies, les chiens et
même les cochons allaient et venaient comme ils l’entendaient, encombrant les
rues et les ruelles. À chaque pas il fallait éviter les immondices. Mais nul
n’en paraissait incommodé. Chacun vaquait à ses affaires, la bouche grande
ouverte, se pressant comme si de rien n’était autour des étals où l’on vendait
et échangeait de la nourriture comme des cordes, des plis de tissu, des sacs de
grain ou même des ânes. L’odeur des légumes suris, de la viande et des poissons
exposés à la chaleur, se mêlait à celles du crottin d’ânes et des déjections
des enfants que la terre poussiéreuse n’avait pas encore absorbées. Une
puanteur si asphyxiante que Saraï devait plaquer son voile contre sa bouche
pour respirer. Elle était bien la seule, mais chacun était si occupé qu’on ne
lui accordait aucune attention. Jusqu’à ce qu’un appel la fasse
sursauter :
— Ma fille, ma fille !
Assise sur le seuil d’une maison, une
vieille lui souriait. Ou grimaçait. Son visage n’était plus que rides où
disparaissaient les yeux. Sa bouche, édentée, laissait voir une langue d’un
rose
Weitere Kostenlose Bücher