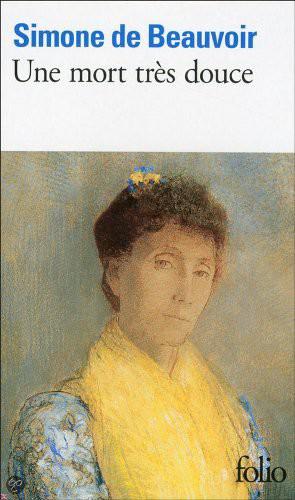![Une mort très douce]()
Une mort très douce
semblaient pas s'en soucier. « L'important c'est qu'ils aient fonctionné : ça prouve qu'ils ne sont pas paralysés. Les docteurs sont très contents. — S'ils sont contents, clest le principal. »
Le samedi soir, avant de dormir, nous avons causé. « C'est curieux», m'a-t-elle dit d'un air rêveur, « quand je pense à mademoiselle Leblon, je la vois dans mon appartement : c'est une espèce de mannequin, gonflé, sans bras, comme il y en a dans les pressings. Le docteur P., c'est une bande de papier noir sur mon ventre. Alors, quand je le vois en chair et en os, ça me semble bizarre. » Je lui ai dit : « Tu vois, tu t'es habituée à moi : je ne te fais plus peur. — Mais non. — Tu m'as dit que je te faisais peur. — J'ai dit ça ? On dit de drôles de choses. »
Moi aussi, je m'étais accoutumée à cette existence. J'arrivais à huit heures du soir ; Poupette me donnait des nouvelles de la journée ; le docteur N. passait. Mademoiselle Cournot arrivait et je lisais dans le vestibule pendant qu'elle changeait le pansement. Quatre fois par jour on amenait dans la chambre une table roulante chargée de bandages, de gazes, de linge, de ouate, de sparadrap, de boîtes en fer, de cuvettes, de ciseaux ; je détournais soigneusement les yeux quand elle ressortait de la pièce. Mademoiselle Cournot, aidée par une garde de ses amies, faisait la toilette de maman et l'installait pour la nuit. Je me couchais. Elle administrait à maman diverses piqûres, puis elle allait boire une tasse de café pendant que je lisais, à la lueur de la lampe de chevet. Elle revenait, elle s'asseyait près de la porte qu'elle laissait entrouverte sur le boyau d'entrée, pour avoir un peu de lumière ; elle lisait et tricotait. On entendait la légère rumeur de l'appareil électrique qui faisait vibrer le matelas. Je m'endormais. A sept heures, réveil. Pendant le pansement, je tournais mon visage vers le mur, me félicitant qu'un rhume me bouchât le nez : Poupette souffrait des odeurs ; moi, je ne sentais à peu près rien, sauf le parfum de cette eau de Cologne que souvent je passais sur le front et les joues de maman, et qui me paraissait douceâtre et écœurant : plus jamais je ne pourrai me servir de cette marque.
Mademoiselle Cournot partait, je m'habillais, je déjeunais. Je préparais pour maman une drogue blanchâtre, très désagréable disait-elle, mais qui l'aidait à digérer. Puis, cuiller par cuiller, je lui donnais du thé dans lequel j'avais émietté un biscuit. La femme de chambre faisait le ménage. J'arrosais, j'arrangeais les fleurs. Souvent retentissait la sonnerie du téléphone ; je me précipitais dans le vestibule ; je refermais les portes derrière moi, mais je n'étais pas sûre que maman ne m'entendît pas et je parlais avec prudence. Elle riait quand je lui racontais : « Madame Raymond m'a demandé comment va ton fémur. — Elles ne doivent rien y comprendre ! » Souvent aussi une infirmière m'appelait : des amies de maman, des parents venaient prendre de ses nouvelles. En général, elle n'avait pas la force de les recevoir mais elle était très contente qu'on se souciât d'elle. Je sortais pendant le pansement. Puis je la faisais déjeuner : incapable de mâcher, elle mangeait des purées, des bouillies, des hachis très fins, des compotes, des crèmes ; elle s'obligeait à vider son assiette : « Je dois me nourrir. » Entre les repas, elle buvait à petites gorgées un mélange de jus de fruits frais : « Ce sont des vitamines. C'est bon pour moi. » Vers deux heures Poupette arrivait : « J'aime beaucoup cette routine », disait maman. Un jour elle nous a dit avec regret : « C'est bête ! pour une fois que je vous ai toutes les deux à ma disposition, je suis malade ! »
J'étais plus calme qu'avant Prague. Le passage s'était définitivement opéré de ma mère à un cadavre vivant. Le monde s'était réduit aux dimensions de sa chambre : quand je traversais Paris en taxi, je n'y voyais plus qu'un décor où circulaient des figurants. Ma vraie vie se déroulait auprès d'elle et n'avait qu'un but : la protéger. La nuit, le moindre bruit me paraissait énorme : le froissement du journal feuilleté par mademoiselle Cournot, le ronronnement d'un moteur électrique. Le jour, je marchais sur mes bas. Les allées et venues, dans l'escalier et au-dessus de nos têtes, me brisaient les tympans. Je trouvais scandaleux, entre onze heures et midi, le fracas des tables roulantes qui passaient
Weitere Kostenlose Bücher