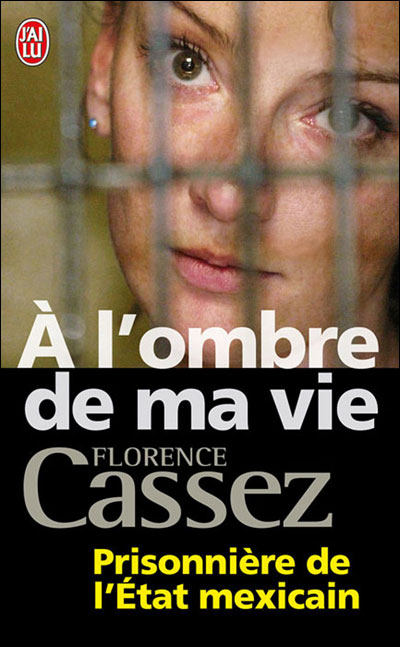![A l'ombre de ma vie]()
A l'ombre de ma vie
le
moins froid possible, et je suis paralysée, incapable de bouger ou même de
penser.
Au petit matin, quand la prison s’éveille, les bruits et les
cris ne sont pas plus rassurants. Je les entends à peine, j’essaie de m’en
extraire, comme si je pouvais échapper à mon sort, comme si je pouvais nier que
je suis là, dans l’un des pires endroits de ce pays et que je ne sais pas ce
qui m’attend.
— Tu vas au tribunal.
Je ne m’attendais pas à cela mais, sans que je sache
exactement pourquoi, cette phrase me fait du bien. Je suis tellement positive,
même dans ces moments-là. Je m’imagine qu’on va venir me chercher gentiment,
quelques policiers de l’AFI dans une voiture, qu’on va me présenter devant un
tribunal et que, là, quelqu’un va me dire : « Excusez-nous,
mademoiselle, finalement nous n’avons rien à vous reprocher », et que tout
cela va se régler dans la journée. Je ne vais tout de même pas rester dans cet
endroit épouvantable, au risque d’y mourir de peur ! Je ne suis pas
taillée pour cela, c’est au-dessus de mes forces. Et puis, j’ai la mentalité
française. Chez moi, un endroit comme ça n’existe pas !
Mais on m’emmène vers un camion garé dans la cour, déjà
chargé de près de trente filles, assises sur les banquettes fixées aux parois,
ou debout au milieu, serrées, pressées, si mal installées qu’elles en sont
agressives et s’insultent en hurlant, c’est incroyable. Quand je monte, il
reste une place assise juste au bord, alors je m’installe là et je prends un
grand coup de bâton dans les côtes parce que c’est la place du gardien – je n’avais
pas compris ! Je n’ai pas d’autre choix que d’aller me coller à celles qui
sont le plus au bord, de pousser comme font toutes les autres, pour que les
gardiens puissent fermer la grille du camion cellulaire.
Cela ne dure pas longtemps. Deux autres gardiens arrivent en
courant. Ils viennent chercher quelqu’un, et justement c’est moi qu’ils
veulent. Les autres me regardent partir d’un air mauvais. On m’emmène vers les
bureaux où on me prend en photo, où on me pose un tas de questions sur ce que
je suis, ce que j’ai fait les dernières semaines, d’où je viens et toutes
sortes de choses qu’ils écrivent dans un dossier. Cela dure une heure, au
moins, et je crois naïvement que le fourgon est parti, que ce sera pour une
autre fois, mais pas du tout ! Quand tout cela est terminé, on me ramène
au camion cellulaire, qui est toujours là. Les trente filles ont attendu
pendant tout ce temps, serrées, debout ou assises. Elles sont furieuses, et
bien sûr, s’en prennent à moi. À peine montée, je reçois des coups de coude, des
coups de poing, des coups de pied qui me viennent d’un peu partout. Bravache,
je rends coup pour coup, je me débats et je garde la tête droite, les yeux dans
ceux de mes voisines, espérant leur faire croire que je n’ai pas peur, que je
ne me laisse pas impressionner. Et on dirait que ça marche. Non pas que les
regards s’adoucissent, mais la pluie de coups cesse peu à peu et je me fais une
place près de la barre verticale à laquelle je m’agrippe pendant que le fourgon
roule et que nous sommes ballottées, cognées les unes contre les autres – ce
qui ne diminue pas l’agressivité ambiante. Deux ou trois fois, mon regard
croise celui d’une femme assise au fond, qui me fusille, ne me lâche pas, un
regard que je n’arrive pas à soutenir, dur, méchant, qui vient d’un visage
aussi masculin que celui de la Mataviejitas elle-même ; c’est une
autre catcheuse, on dirait, elle semble m’en vouloir mais je ne sais pas
pourquoi.
Une fois à l’arrêt, ma peur me fait bondir du camion. Mais
où sommes-nous arrivées ? C’est un endroit encore pire que le pénitencier,
ici. Je ne croyais même pas que c’était possible. Je vais de cauchemar en
cauchemar, en descendant toujours plus au fond de l’horreur et en me demandant
combien de temps je vais tenir dans ce monde infernal et violent. C’est une
suite de longs couloirs répugnants – il semble qu’on ait encore franchi un
palier dans l’abject –, un peu comme les boyaux d’un métro qu’on n’aurait
jamais entretenu. Il y a des gens partout, mais uniquement des détenus, pas de
gardiens. Il faut comprendre : ils n’étaient que quatre, dans le fourgon,
pour une trentaine de détenues, alors ils nous poussent là-dedans et ferment
les portes. À présent je
Weitere Kostenlose Bücher