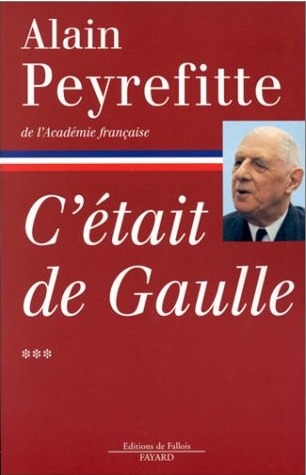![C'était de Gaulle, tome 3]()
C'était de Gaulle, tome 3
vendredi 3 mai 9 heures et jusqu'à nouvel ordre, les cours et travaux pratiques sont suspendus à la faculté de lettres de Nanterre. Ils seront progressivement rétablis, discipline par discipline. »
Je donne mon accord en faisant rajouter : « Toutes mesures seront prises pour que, lors des examens prochains, il soit tenu compte de l'interruption momentanée des enseignements. »
Dans l'après-midi, dans mon bureau, nouvelle réunion de travail sur Nanterre. Nous arrêtons les dispositions qui permettront aux six cents étudiants de sciences humaines, dispersés entre six salles extérieures, de passer leurs examens malgré le boycott annoncé. Les perturbateurs éventuels seront inculpés en flagrant délit et exclus de l'Université. Les absents seront considérés comme refusés à l'examen. De nouveaux « appariteurs », pour lesquels nous avons enfin obtenu des crédits, sont en cours de recrutement.
Nous croyons encore que Nanterre restera Nanterre. Nous n'imaginons pas qu'il n'en sera plus question. Car le calendrier judiciaire et la fermeture administrative donnent à l'agitation nanterroise et parisienne rendez-vous au Quartier latin.
Vendredi 3 mai 1968.
Le coup de téléphone de Pompidou, avant-hier, s'éclaire : il connaissait d'avance la philippique de Georges Marchais dans L'Humanité de ce matin, « De faux révolutionnaires à démasquer ». Elle dénonce « les groupuscules » dirigés par « l'anarchiste allemand Cohn-Bendit ».
« Ces pseudo-révolutionnaires doivent être énergiquement combattus... Le maître à penser de ces gauchistes est le philosophe allemand Marcuse, qui vit aux États-Unis ; pour lui, la jeunesse universitaire doit s'organiser pour la lutte violente... On ne peut pas sous-estimer leur malfaisante besogne, qui tente de semer le trouble parmi les jeunes. »
À 15 heures 30, Narbonne, qui entre au Conseil d'État après sept années passées auprès du Général, vient me faire ses adieux. Il est soulagé : les décisions prises à l'Elysée le mois dernier pour lasélection couronnent les efforts qu'il avait si opiniâtrement déployés auprès du Général. Je lui explique qu'à mes yeux, plus que la sélection, c'est la compétition entre les universités qui peut changer les choses.
Il est encore dans mon bureau, quand Pelletier entre, vers 16 heures, assez ému : « Roche me prévient qu'il a demandé au commissaire de police d'évacuer la cour de la Sorbonne. Trois ou quatre cents énergumènes, qui semblent venus de Nanterre, l'ont envahie. Un certain nombre d'entre eux brandissent des gourdins et des manches de pioches. »
Comment blâmer un acte de fermeté, le premier accompli spontanément par les autorités universitaires depuis des mois que la situation se dégrade ?
Narbonne parti, je rappelle néanmoins le recteur Roche pour lui demander des détails. Il est très calme : « Sous toutes les Républiques, d'innombrables opérations de police ont été faites dans les bâtiments universitaires de Paris pour mettre fin à des désordres.
AP. —Avez-vous l'accord de vos deux doyens ?
Le recteur. — Absolument. »
Nous apprenons bientôt que les cars dans lesquels la police fait monter les expulsés, sans violence ni résistance, sont subitement attaqués par des jeunes qui se trouvaient à l'extérieur. Une longue soirée de violence s'ensuit — la première de ce beau mois de mai.
Il y a un mystère de cette première nuit. Cette violence subite, ni la police, ni les chefs gauchistes ne l'ont vraiment comprise. La seule explication qu'ils aient imaginée et qu'ils ont accréditée consiste dans la solidarité soudaine qui avait transformé les jeunes, les badauds du Quartier latin, étudiants ou non, en « casseurs de flics ». L'agressivité de cette mobilisation spontanée n'en a paru que plus impressionnante. Elle a convaincu l'opinion publique que le peuple du Quartier latin s'était soulevé comme un seul homme contre l'intrusion de la police dans l'enceinte sacrée de l'université.
Or il y avait une explication simple et je ne l'ai apprise que trente ans plus tard. Les enragés qui occupaient la cour de la Sorbonne avaient une armée de secours, et ils ne le savaient pas. C'étaient les lycéens des CAL ! Romain Goupil, l'un de leurs chefs, raconte dans son film-souvenir, Mourir à trente ans 3 : « Les étudiants, nos dirigeants, y sont [à la "journée anti-impérialiste"] dès 10 heures du matin, avec leurs barres de bois.Nous,
Weitere Kostenlose Bücher