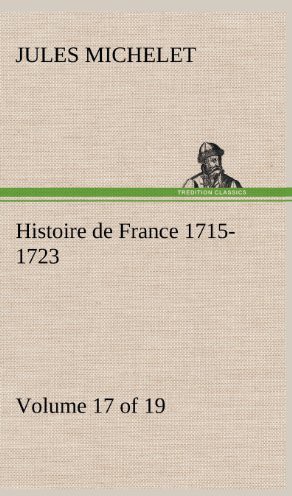![Histoire De France 1715-1723 Volume 17]()
Histoire De France 1715-1723 Volume 17
l'exemple du désintéressement dans le personnage d'Ésope. Ses ennemis l'accusèrent d'avoir des trésors dans un coffre qu'il visitait souvent. Ils n'y trouvèrent que l'habit qu'il avait avant d'être ministre. Moi, je suis sorti nu; je n'ai pas sauvé mon habit.»
Cela est beau, pourtant ne suffit pas. Sortir nu, ce n'est pas assez. L'essentiel est de sortir net. Ésope retrouva mieux que l'habit: l' honneur . Law a-t-il retrouvé le sien?
Ne devait-il pas expliquer les circonstances qui lerendirent complice (désintéressé, il est vrai, mais complice, après tout) du pillage honteux qui se fit? N'eût-il pas mieux valu avouer franchement, ce qui lui donnerait devant l'avenir des circonstances atténuantes, sa faiblesse de caractère, sa servitude domestique, l'entraînement surtout de l'utopiste mené par un mirage à travers les marais fangeux? « Un petit mal pour un grand bien. Une heure de brigandage, et demain le salut du monde. » Selon toute apparence, il se paya de cette raison.
Il est mort sans parler, a abandonné sa mémoire. Il nous reste une énigme. Pourquoi? Il n'eût pu se laver que par le déshonneur des autres, et de ceux qui restaient puissants.
Il est mort à Venise, en 1729, triste solliciteur, tremblant apologiste, qui justement s'adresse aux coupables, aux auteurs de sa ruine. La faute en est à sa grande faiblesse, disons-le, à ses deux amours. D'une part, cette fière Anglaise qu'il avait enlevée, ne veut pas rester pauvre; elle le fait écrire, elle écrit elle-même au grand voleur, M. le Duc, pour recouvrer le bien de ses enfants. Lui-même, d'autre part, le pauvre homme est le même, joueur obstiné, chimérique, amoureux de sa grande idée, et si follement amoureux qu'il s'imagine que les voleurs, qui ont tant d'intérêt à le tenir loin, vont le rappeler, l'essayer de nouveau, lui donner sa revanche!
Voilà ce que c'est que la France. Il n'était pas né fou, mais ici le devint. Un certain vin nouveau cuvait. Le sage Catinat, Vauban, Boisguilbert, le bon abbé de Saint-Pierre, chacun à sa manière rêvait, quoi? laRévolution. Le meilleur ne se disait pas, et ne s'imprimait pas, circulait sourdement.
Qui réaliserait? Qui se compromettrait dans les essais trop souvent avortés? Un héros existait, l'homme d'exécution, et martyr au besoin, l'intrépide et savant Renaut. Il s'était adressé au favori de la fortune, ce brillant Law, qui par lui, ce semble, aspira l'âme de la France. De là le mémoire du 13 juin sur l'égalité de l'impôt. De là l'essai trop court où Renaut mourut à la peine. Mais Law lui fut fidèle, et, dans son apogée, presque roi, ambitionna d'être successeur de Renaut à l'Académie des sciences.
En Law fut, si je ne me trompe, bien moins l'invention que la concentration des idées capitales du temps. Quelles sont ces idées? J'y distingue ce que j'appellerai le plan et l' arrière-plan , une révolution financière, une révolution territoriale.
Le plan , c'était: 1 o L'extinction de la Maltôte, la destruction de l'épouvantable machine qui triturait la France. Peu, très-peu d'employés. Quarante mille préposés de moins. Plus de pachas de la finance, plus de Fermiers généraux, plus de Receveurs à gros profits, qui faisaient des affaires avec l'argent des caisses. Trente petits directeurs (à 6,000 francs) remplaçaient tout cela;
2 o L'extinction de la dette, la libération de l'État. Law se substituait aux créanciers en prêtant 1,500 millions à 3 pour 100, remboursait le créancier en espèces ou en actions. On était sûr qu'il préférerait ces actions en hausse, qui, revendues au bout d'un mois, donnaient un bénéfice énorme.
Ce que j'appelle l' arrière-plan , c'était non-seulement l'égalité de l'impôt territorial, mais une vente des terres du clergé. À peine contrôleur général, il fit examiner au Conseil un projet pour forcer le clergé de vendre tout ce qu'il avait acquis depuis cent vingt ans . (Ms. Buvat, Journal de la Régence , janvier 1720, t. II, p. 133; et dans la copie, t. III, p. 1134.)
Cette dernière proposition était tout un 89. Des quatre ou cinq milliards de biens que le clergé avait en France, une moitié au moins avait été acquise dans le XVII e siècle. Cette masse de deux milliards de biens, tout à coup mise en vente, donnait la terre à vil prix, la rendait accessible. De plus, une bonne part des gains de bourse se seraient tournés là. Beaucoup de fortunes récentes, ou moyennes,
Weitere Kostenlose Bücher