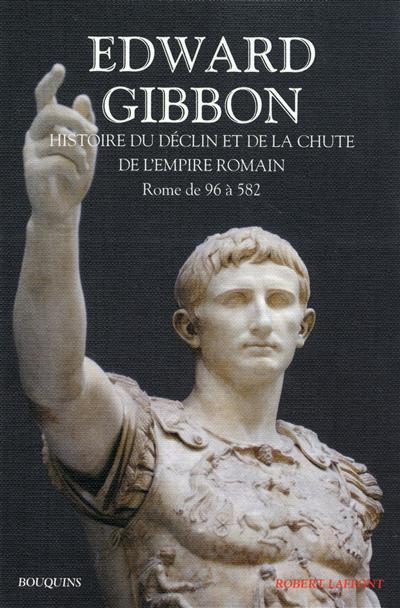![Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain]()
Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
dans le pœmerium de Rome, et à un mille aux
environs (Dion, LIII, p. 679, LIV, p. 735). Ces divinités furent assez en
vogues dans son règne (Ovide, dé Arteamandi , l. I) et sous celui de son
successeur, jusqu’à ce que la justice de Tibère eût obligé ce prince à quelques
actes de sévérité. Voyez Tacite, Annal. , II, 85 ; Josèphe, Antiquités ,
l. XVIII, c. 3.
Gibbon fait ici un seul événement,
de deux événements éloignés l’un de l’autre de cent soixante-six ans. Ce fut
l’an de Rome 535 que le sénat ayant ordonné la destruction des temples d’Isis
et de Sérapis, aucun ouvrier ne voulut y mettre la main, et que le consul L.
Æmilius-Paulus prit lui-même une hache pour porter le premier coup
(Valère-Maxime, I, 3). Gibbon attribue cette circonstance à la secondé démolition,
qui eut lieu en 701, et qu’il regarde comme la première ( Note de l’Éditeur ).
[120] Tertullien, Apolog. , c. 6, p. 74, édit.
Havere. Il me semble que l’on peut attribuer cet établissement à la dévotion de
la famille Flavienne.
[121] Voyez Tite-Live, IX et XXXIX.
[122] Macrobe, Saturnales , cet auteur nous donne une
formule d’évocation.
[123] Minutius-Félix, in Octavio , page 54 ; Arnobe,
l. VI, page 115.
[124] Tacite, Annal. , XI, 24. L’ Orbis romanus du savant Spanheim est une histoire complète de l’admission progressive du Latium,
de l’Italie et des provinces, à la liberté de Rome.
[125] Hérodote, V, 97. Ce nombre paraît considérable ; on
serait tenté de croire que l’auteur s’en est rapporté à des bruits, populaires.
[126] Athénée, Deipnosophist. , l. VI, p. 272, édit.
de Casaubon ; Meursius, de Fortunâ atticâ , c. 4.
[127] Voyez dans M. de Beaufort, Rep. rom. , l. IV,
c. 4, un recueil fait avec soin des résultats de chaque cens.
[128] Appien, de Bell. civil. , I ; Velleius
Paterculus , II, c. 15, 16, 17.
[129] Mécène lui avait conseillé, dit-on, de donner, par un
édit, à tous ses sujets le titre de citoyens ; mais nous soupçonnons, à juste
titre, Dion d’être l’auteur d’un conseil si bien adapté à l’esprit de son
siècle, et si peu à celui du temps d’Auguste.
[130] Les sénateurs étaient obligés d’avoir le tiers de
leurs biens en Italie (voyez Pline, IV, ep. 19) ; Marc-Aurèle leur permit de
n’en avoir que le quart. Depuis le règne de Trajan, l’Italie commença à n’être
plus distinguée des autres provinces.
[131] La première partie de la Verona illustrata du
marquis de Maffei, donne la description la plus claire et la plus étendue de
l’état de l’Italie sous les Césars.
[132] Voyez Pausanias, l. VII. Lorsque ces assemblées ne
furent plus dangereuses, les Romains consentirent à en rétablir les noms.
[133] César en fait souvent mention. L’abbé Dubos n’a pu
réussir à prouver que les Gaulois aient continué, sous les empereurs, à tenir
des assemblées. Histoire de l’Établissement de la Monarchie française ,
l. I, c. 4.
[134] Sénèque, in Consol. ad Helviam , c. 6.
[135] Memnon, apud Photium , c. 33 ; Valère Maxime,
IX, 2. Plutarque et Dion-Cassius font monter le massacre à cent cinquante mille
citoyens ; mais je pensé que le moindre de ces deux nombres est plus que
suffisant.
[136] Vingt-cinq colonies furent établies en Espagne (voyez
Pline, Hist. nat. , III, 3, 4 ; IV, 35), et neuf en Bretagne, parmi
lesquelles Londres, Colchester, Lincoln, Chester, Gloucester et Bath, sont
encore des villes considérables. Voyez Richard de Cirencester, p. 36 ; et l’ Histoire
de Manchester par Whitaker, l. I, c. 3.
[137] Aulu-Gelle, Noctes atticæ , XVI, 13. L’empereur
Adrien était étonné que les villes d’Utique, de Cadix et d’Italica, qui
jouissaient déjà des privilèges attachés aux villes municipales ,
sollicitassent le titre de colonie : leur exemple fut cependant bientôt
suivi, et l’empire se trouva rempli de colonies honoraires. Voyez Spanheim, de
Usu numismat. , dissert. XIII.
[138] Spanheim, Orb. rom. , c. 8, p. 62.
[139] Aristide, in Romœ Encomio , tome I, page 218,
édit. Jebb.
[140] Alésia, était près de Semur en Auxois, en Bourgogne.
Il est resté une trace de ce nom dans celui de l’Auxois, nom de la contrée. La
victoire de César à Alésia peut servir d’époque, dit d’Anville, à
l’asservissement de la Gaule un pouvoir de Rome ( Note de l’Éditeur ).
[141] Tacite, Annal. , XI, 23, 24 ; Hist. , IV,
74.
[142] Pline, Hist. nat. , III, 5 ; saint Augustin,
Weitere Kostenlose Bücher