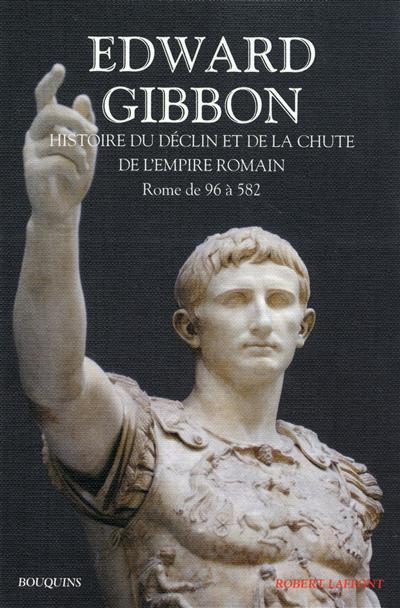![Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain]()
Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
satisfait de cette distinction, vint en effet se
présenter au préteur, espérant sans doute une récompense et des
applaudissements ; mais Domitius, en apprenant qu’il ne lui avait fallu qu’un
épieu pour vaincre et tuer le sanglier, ordonna qu’il fût crucifié sur le
champ, sous le barbare prétexte que la loi interdisait aux esclaves l’usage de
cette arme, ainsi que de toutes les autres. Peut-être la cruauté de Domitius
est-elle encore moins étonnante que l’indifférence avec laquelle l’orateur
romain raconte ce trait, qui l’affecte si peu, que voici ce qu’il en dit : Durum
hoc fortasse videatur, neque ego in ullam partem disputo . « Cela
paraîtra peut-être dur ; quant à moi, je ne prends aucun parti . » Cicéron,
in Verr., act. a, 5, 3. — Et c’est le même orateur qui dit dans la même
harangue : Facinus est vincire civem romanum ; scelus verberare ; .propè
parricidium necare : quid dicam in crucem tollere ? « C’est un délit de
jeter dans les fers un citoyen romain, c’est un crime de le frapper, presque un
parricide de le tuer : que dirai-je de l’action de le mettre en croix ? »
En général, ce morceau de Gibbon, sur l’esclavage est
plein non seulement d’une indifférence blâmable, mais encore d’une exagération
d’impartialité, qui ressemble à de la mauvaise foi. Il s’applique à atténuer
ce qu’il y avait d’affreux dans la condition des esclaves et dans les
traitements qu’ils- essuyaient ; il fait considérer ces traitements cruels
comme pouvant être justifiés par la nécessité. Il relève ensuite, avec une
exactitude minutieuse, les plus légers adoucissements d’une condition si
déplorable ; il attribue à la vertu ou à la politique des souverains
l’amélioration progressive du sort des esclaves, et il passe entièrement sous
silence la cause la plus efficace, celle qui, après avoir rendu les esclaves
moins malheureux, a contribué à les affranchir ensuite tout à fait de leurs
souffrances et de leurs chaînes, le christianisme. Il serait aisé d’accumuler
ici les détails les plus effrayants, les plus déchirants sur la manière dont
les anciens Romains traitaient leurs esclaves ; des ouvrages entiers ont été
consacrés à la peindre ; je me borne à l’indiquer quelques réflexions de
Robertson, tirées du discours que j’ai déjà cité, feront sentir que Gibbon, en
faisant remonter l’adoucissement de la destinée des esclaves à une époque peu
postérieure à celle qui vit le christianisme, s’établir dans le monde, n’eût pu
se dispenser de reconnaître L’influence de cette cause bienfaisante, s’il
n’avait pris d’avance le parti de n’en point parler.
« A peine , dit Robertson, une souveraineté
illimitée se fut introduite dans l’empire romain, que la tyrannie domestique
fut portée à son comble : sur ce sol fangeux crûrent et prospérèrent tous les
vices que nourrit chez les grands l’habitude du pouvoir, et que fait naître
chez les faibles celle de l’oppression… Ce n’est pas le respect inspiré par un
précepte particulier de l’Évangile, c’est l’esprit général de la religion
chrétienne, qui, plus puissant que toutes les lois écrites, a banni l’esclavage
de la terre. Les sentiments que dictait le christianisme étaient bienveillants
et doux ; ses préceptes donnaient à la nature humaine une telle dignité, un tel
éclat, qu’ils l’arrachèrent à l’esclavage déshonorant où elle était plongée .
»
C’est donc vainement que Gibbon prétend attribuer
uniquement au désir d’entretenir toujours le nombre des esclaves la conduite
plus douce que les Romains commencèrent à adopter à leur égard du temps des
empereurs. Cette cause avait agi jusque-là en sens contraire : par quelle
raison aurait-elle eu tout à coup une influence opposée ? « Les maîtres ,
dit-il, favorisèrent les mariages entre leurs esclaves ; … et les sentiments
de la nature, les habitudes de l’éducation, contribuèrent à adoucir les peines
de la servitude. Les enfants des esclaves étaient la propriété du maître, qui
pouvait en disposer et les aliéner comme ses autres biens : est-ce dans une
pareille situation, sous une telle dépendance, que les sentiments de la nature
peuvent se développer, que les habitudes de l’éducation deviennent douces et
fortes ? Il ne faut pas attribuer des causes plu efficaces ou mêmes sans
énergie, des effets qui ont besoin, pour s’expliquer,
Weitere Kostenlose Bücher