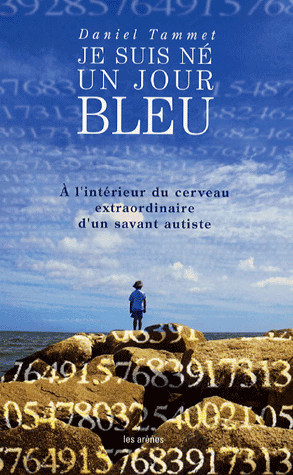![Je suis né un jour bleu]()
Je suis né un jour bleu
semblait
incomplète sans lui et que je voulais qu’il revienne.
On nous dit que mon père avait besoin de
temps pour se reposer et qu’il avait été emmené dans un hôpital pour se soigner.
Il fut absent plusieurs semaines pendant lesquelles nous, les enfants, nous ne
fûmes pas autorisés à le voir, alors que ma mère prenait le bus tous les jours
pour lui rendre visite. L’hôpital était une institution psychiatrique qui accueillait
des patients pour de longs séjours, mais à l’époque nous étions trop jeunes
pour savoir de quelle maladie mon père souffrait. Ma mère ne discutait pas de l’état
de mon père avec nous et se contentait de nous dire qu’il allait mieux et qu’il
rentrerait bientôt. Pendant ce temps, avec sept enfants (dont cinq de quatre
ans ou moins), ma mère s’en remit à ses parents, aux amis de la famille et aux
assistants que les services sociaux mirent à sa disposition. Mon frère et moi
nous devions aider le plus possible en faisant la vaisselle ou en portant les
courses.
On ne célébra pas le retour de mon père
de l’hôpital. Au contraire, on tenta une sorte de retour à la normale. Il
essayait de faire ce qu’il avait toujours fait tous les jours avant que la maladie
ne le frappe : changer les couches et préparer le dîner. Mais les choses
étaient différentes et je pense qu’il savait lui-même qu’elles ne seraient plus
jamais comme avant. L’homme qui m’avait auparavant protégé et avait veillé sur
moi était parti et il avait été remplacé par un homme qui avait besoin d’être
protégé et soigné. On lui prescrivit un traitement et on lui conseilla d’aller
régulièrement se faire examiner par les médecins de l’hôpital. Chaque jour, après
le déjeuner, il montait dans sa chambre et dormait plusieurs heures. Ma mère
demanda à mes frères et sœurs de jouer en silence, aussi silencieusement que
moi, pour ne pas déranger le repos de mon père. Quand l’un ou l’autre bébé
commençait à pleurer, ma mère se précipitait pour l’emmener dans le jardin.
La relation de mes parents changea aussi.
Avant, ma mère s’était beaucoup reposée sur mon père, émotionnellement comme
dans la vie de tous les jours. Maintenant, elle devait reconsidérer leur vie ensemble
et « de zéro ». Leurs conversations se firent plus brèves et ces deux
personnes qui avaient auparavant parfaitement fonctionné ensemble semblaient ne
plus savoir comment faire. Ils se disputaient de plus en plus, leurs voix
devenaient fortes et sombres. Je n’aimais pas les entendre se disputer et je me
bouchais les oreilles. Souvent, après une dispute particulièrement intense, ma
mère montait dans ma chambre pour s’asseoir au calme. Dans ces moments-là, j’aurais
voulu l’envelopper dans un doux silence comme dans une couverture.
L’état de mon père fluctuait d’un jour à
l’autre, et d’une semaine à l’autre. Il y avait de longues périodes pendant lesquelles
il pouvait parler et agir comme autrefois, seulement interrompues par de
soudains accès de bavardage incohérent, répétitif, confus, qui l’isolaient du
reste de la famille. Il fut hospitalisé un certain nombre de fois, les années
suivantes, pendant plusieurs semaines. Puis, aussi soudainement qu’elle était venue,
la maladie de mon père disparut : il recommença à manger et à dormir mieux,
retrouva sa force physique et émotionnelle, son assurance et son sens de l’initiative.
La relation de mes parents s’améliora et un huitième enfant, ma sœur Anna-Marie,
naquit à l’été 1990. Dix-sept mois plus tard naissait
le dernier enfant de mes parents, Shelley, quatre jours avant mon treizième anniversaire.
Ces améliorations, ainsi que l’agrandissement
continu de la famille entraînèrent un nouveau déménagement, en 19 91, dans une maison de quatre chambres, dans Marston Avenue, située
près des boutiques et d’un parc, avec un grand jardin derrière. Comme les
maisons précédentes, elle n’avait qu’une seule salle de bain pour onze
personnes. Les files d’attente devant la porte étaient fréquentes. Le salon et
la salle à manger étaient séparés par une double porte, qui demeurait souvent ouverte
et les pièces du rez-de-chaussée n’en étaient plus qu’une seule. Quand j’avais
une pensée ou une idée soudaine, je passais d’une pièce à l’autre, du salon à
la salle à manger, à la cuisine, au couloir – et retour au salon – dans
un mouvement
Weitere Kostenlose Bücher