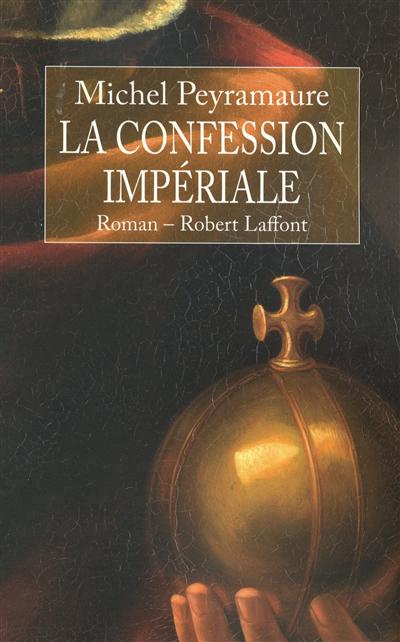![La confession impériale]()
La confession impériale
impériale, constellée de pierres précieuses, qui n’avait jamais autant
pesé à ma tête chenue. Comme j’éprouvais quelque difficulté à marcher, Louis me
soutint par le bras en évitant que je me prenne les pieds dans le tapis, si
bien que je fis assez bonne figure, du porche de l’entrée à l’octogone.
Je m’agenouillai sur un coussinet devant
l’autel du Seigneur où, dans une gerbe de soleil, étincelait une autre
couronne : celle que je destinais à mon fils. Il s’agenouilla à mon côté
et nous avons confondu nos prières.
Louis m’aida à me relever, ce qui me fut
pénible. Au moindre mouvement, je sentais mes os craquer de toutes parts, comme
si j’allais m’effriter.
D’une voix que je me forçai à rendre
perceptible pour la foule qui avait envahi les moindres recoins de la
basilique, je rappelai à Louis les devoirs qui attendaient le futur empereur
d’Occident : continuer à aimer et craindre le Seigneur, honorer et
protéger l’Église, se montrer clément envers sa famille, ses proches et ses
vassaux, aimer ses peuples comme un père ses fils, ne faire la guerre qu’en
toute extrémité…
Je l’invitai à me faire connaître de vive voix
son intention de respecter mes préceptes. Quand il m’eut d’une voix
retentissante donné son assentiment, je me saisis de sa couronne et, après
qu’il se fut agenouillé, la plaçai sur sa tête.
Des clameurs de joie montèrent de
l’assistance, avec, répétée à trois reprises, l’acclamation « Vive l’empereur ! »,
à l’adresse du père comme du fils.
Brisé d’émotion, de fatigue et pris d’un léger
vertige, je peinais à conserver mon équilibre au moment de descendre les
marches de l’autel. Sans le soutien de mon fils, je me serais effondré sur
place.
Côte à côte, moi assis et lui debout, nous
avons assisté à l’office solennel. Avant de nous retirer, après avoir retrouvé
quelque force, j’ai repris la parole pour lancer à l’assistance :
— Seigneur Dieu, toi qui m’as donné
aujourd’hui de voir ce prince né de mon sang s’asseoir sur mon trône, sois
béni, et que tes grâces…
Le reste de mon propos s’est perdu dans les
vivats et les murmures montant de la foule qui se pressait sur le parvis.
Je n’avais rien
négligé pour faire de ces agapes un moment de convivialité inoubliable.
Aucune salle du palais n’étant assez vaste
pour abriter cette foule, c’est dans mes jardins qu’eut lieu ce repas, sous des
tentes multicolores prévues en cas de pluie. Épuisé par la chaleur de cette fin
d’été, je me retirai après les libations propitiatoires et les premières
venaisons pour me livrer à ma sieste quotidienne. J’étais si las qu’elle dura
jusqu’à la nuit, malgré le tumulte joyeux et les musiques montant des jardins.
Avant de m’endormir, j’imaginais les enfants jetant des os aux animaux de la
ménagerie, les dames s’apprêtant pour la danse, les vieilles moustaches
racontant leurs exploits ou entonnant les chants guerriers écrits par Alcuin…
Quand je me suis
réveillé, il faisait presque nuit, avec la grande aile rouge d’un nuage suspendue
au-dessus de la ville. L’air encore tiède me venait par bouffées légères. Dans
les jardins, la fête battait son plein. On avait allumé sur les pelouses ou
accroché aux branches flambeaux et pots à feu, dont l’odeur âcre me venait par
la fenêtre ouverte. Des musiciens jouaient des airs allègres d’Aquitaine et de
Provence. Je maudissais ma fatigue et mes douleurs de m’avoir privé de ce
festin et de cette fête.
Je me fis servir par Adaline une écuelle de
lait chaud sucré au miel, des beignets aux pommes, et lui ordonnai de faire
l’obscurité pour me replonger aussitôt dans le sommeil.
Afin de jouir de la
présence de mon fils, de ses enfants et de son épouse, je leur demandai de
retarder de quelques jours leur retour à Toulouse. Judith, qu’il avait épousée suivant
le rite des Francs germaniques, m’avait plu d’emblée. J’appréciais sa beauté un
peu sévère de Bavaroise, mais moins l’ascendant qu’elle avait pris sur Louis.
Ils paraissaient néanmoins s’accorder en perfection.
Nous avons eu, mon fils et moi, la veille de
son départ, sous une charmille, une longue discussion relevant de la politique,
de l’économie, de notre famille et de la foi que nous partagions sans réserve.
Je lui fis promettre de ne rien changer, après
ma mort, aux institutions de
Weitere Kostenlose Bücher