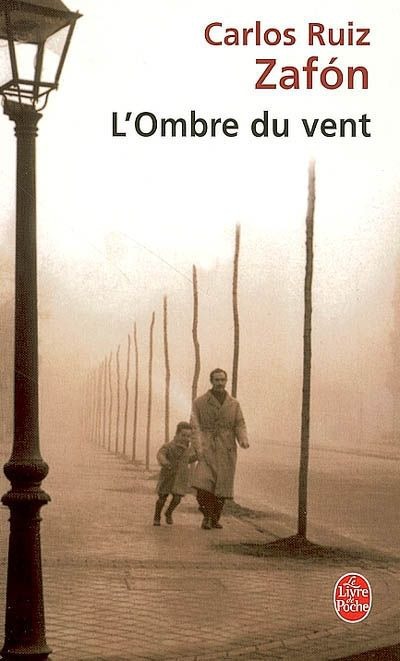![L'ombre du vent]()
L'ombre du vent
double. Je préférais le savoir prisonnier plutôt
que mort.
Personne ne revint me poser de
questions sur mon mari, mais je m'appliquai à répandre dans le quartier la
rumeur qu'il vivait en France. J'écrivis plusieurs lettres au consulat
d'Espagne à Paris, en expliquant que, ayant appris que le citoyen espagnol
Julián Carax se trouvait dans cette ville, je demandais son aide pour le
localiser. Je supposais que, tôt ou tard, ces lettres tomberaient entre les mains
qu'il fallait. Je pris toutes les précautions, mais je savais que je jouais
contre le temps. Les gens comme Fumero ne cessent jamais de haïr. Leur
haine n'a ni sens ni raison. ils haïssent comme ils respirent.
L'appartement du boulevard San
Antonio était situé au dernier étage. Je découvris qu'il existait, sur
l'escalier, une porte d'accès au toit. Les toits de tout le pâté de maisons
formaient un réseau de terrasses séparées par des murs de moins d'un mètre de
haut, entre lesquels les voisins étendaient leur linge. Je ne tardai pas à
découvrir, de l'autre côté, un immeuble dont la façade donnait sur la rue
Joaquin Costa : je pouvais accéder à sa terrasse et, de là, sauter le
muret pour parvenir à celle de l'immeuble du boulevard San Antonio, sans que personne
puisse me voir entrer ou sortir de l'appartement. Un jour, je reçus une lettre
de l'administrateur de biens m'avertissant que des voisins avaient entendu des
bruits chez les Fortuny. Je l'informai, au nom de Me Requejo, qu'un membre du cabinet d'avocats venait
parfois y chercher des papiers ou des documents, et qu'il n'y avait aucune
raison de s'alarmer, même si les bruits étaient nocturnes. Par quelques
tournures appropriées, je laissai entendre qu'entre hommes du même monde,
avocats et gérants de société, une garçonnière discrète était plus sacrée que
le dimanche des Rameaux. L'administrateur, faisant preuve de solidarité
masculine et d'esprit de corps, me répondit de ne pas m'inquiéter : il en
faisait son affaire.
Toutes ces années, jouer le
rôle de Me Requejo fut ma seule distraction. Une fois par mois, j'allais rendre
visite à mon père au Cimetière des Livres Oubliés. Il ne montra jamais aucun intérêt
pour ce mari invisible, et je ne proposai jamais de le lui présenter. Dans nos
conversations, nous contournions le sujet comme des navigateurs expérimentés esquivent un
écueil qui affleure, en évitant de nous
regarder. Parfois, il me contemplait sans rien dire puis me demandait si
j'avais besoin d'aide, s'il pouvait quelque chose. Certains samedis, à l'aube,
j'emmenais Julián voir la mer. Nous montions sur la terrasse et passions par
les toits pour gagner l'immeuble voisin et sortir dans la rue Joaquím Costa. De
là, nous descendions vers le port à travers les ruelles du Raval. Nous ne
croisions personne. Julián faisait peur aux gens, même de loin. Il nous
arrivait d'aller jusqu'au brise-lames. Julián aimait s'asseoir sur les rochers
et regarder la ville. Nous passions des heures ainsi, sans échanger un mot. Un
soir, nous nous glissâmes dans un cinéma alors que la séance avait déjà
commencé. Dans le noir, personne ne remarquait Julián. Nous vivions la nuit et
en silence. A mesure que les mois passaient, j'appris à confondre cette routine
avec la vie normale et, le temps aidant, j'en vins à croire que mon plan était
parfait. Pauvre niaise.
12
1945, année de cendres. Six ans après la fin de la
guerre, on en sentait encore les cicatrices à chaque pas mais presque personne
n'en parlait ouvertement. Ce dont on parlait désormais, c'était l'autre :
la guerre mondiale qui répandait sur le monde une puanteur de charogne et de
lâcheté dont il ne devait jamais se défaire. C'étaient des années de pénurie et
de misère où régnait cette étrange paix qu'inspirent les muets et les infirmes,
entre pitié et dégoût. Après avoir longtemps cherché du travail comme
traductrice, je trouvait finalement un emploi de
correctrice d'épreuves dans une maison d'édition fondée par un patron de la
nouvelle génération qui s'appelait Pedro Sanmarti. Ce patron avait édifié son affaire avec la
fortune de son beau-père, qu'il avait placé ensuite dans un asile au bord du lac de
Bañolas, en attendant de recevoir par la poste son certificat de décès. Sanmarti, qui aimait courtiser
des filles deux fois plus jeunes que lui,
était l'incarnation, en voie de béatification, du self-made man si en
Weitere Kostenlose Bücher