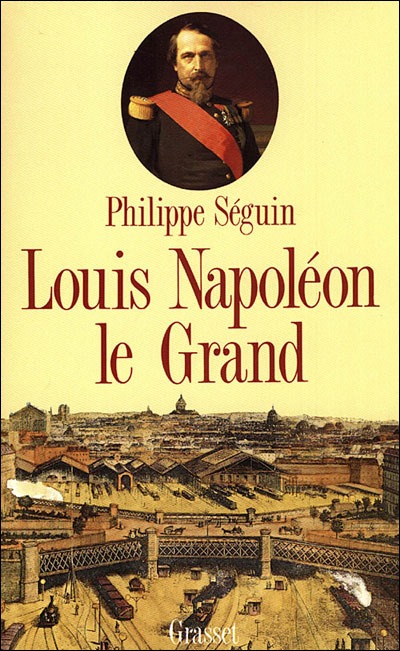![Louis Napoléon le Grand]()
Louis Napoléon le Grand
égard. On croirait, au lendemain des législatives de 1968, assister aux prémices de la pénible suspicion réciproque qui va si malheureusement affecter, pour un temps, les relations du général de Gaulle et de Georges Pompidou. L'impératrice désigne Ollivier: « Regardez-le! Ne dirait-on pas qu'il croit nous avoir sauvés? »
Une grande cérémonie est organisée pour proclamer les résultats. Louis Napoléon y prend la parole. Non sans habileté, il note que si les résultats du plébiscite ont une portée autrement plus large que la simple acceptation de son dispositif, cela n'a pas été de son fait: « Le plébiscite n'avait pour objet que la ratification par le peuple d'une réforme constitutionnelle. Dans l'entraînement de la lutte, le débat a porté plus haut. Ne le regrettons pas. »
Il tire, solennellement, la leçon du scrutin:
« Les adversaires de nos institutions ont posé la question entre la Révolution et l'Empire.
« Le pays l'a tranchée en faveur du système qui garantit l'ordre et la liberté. Aujourd'hui, l'Empire se trouve affermi sur sa base. Il montrera sa force par sa modération [...]. Il ne déviera pas de la ligne libérale qu'il s'est tracée [...]. Débarrassés des questions constitutionnelles qui divisent les meilleurs esprits, nous ne devons plus avoir qu'un but: rallier autour de la Constitution que le pays vient de sanctionner les honnêtes gens de tous les partis [...].
« Nous devons plus que jamais envisager l'avenir sans crainte. »
Il est vrai qu'un tel succès n'a rien de conjoncturel. Il éclaire et donne tout son sens à l'action conduite depuis 1860. Les réformes décidées par Louis Napoléon n'ont nullement altéré l'architecture de l'édifice fondé en 1852. La synthèse opérée entre des principes apparemment contradictoires est celle dont il a toujours rêvé. Il n'y a pas un Empire libéral succédant à un Empire autoritaire. L'Empire est un; il s'est construit peu à peu.
IX
LE VAINCU
La chute de Louis Napoléon n'est due qu'en apparence aux événements extérieurs.
En fait, c'est de l'intérieur que tout est venu. La France a préparé elle-même sa défaite. Par aveuglement et par veulerie. Parce qu'elle s'est illusionnée sur sa capacité à faire front. Parce qu'elle a refusé de consentir l'effort nécessaire à la défense de ses intérêts. Elle en tiendra pour responsable un régime dont le chef est presque seul à avoir eu conscience de l'urgente nécessité des mesures à prendre mais qui, du fait même de la libéralisation, n'était plus capable de les imposer par voie d'autorité.
L'empereur est-il du moins coupable d'avoir créé les conditions du conflit dont la France va sortir ébranlée? On l'a prétendu. Contribuer à l'indépendance de l'Italie aurait affaibli l'Autriche; l'affaiblissement de l'Autriche aurait ouvert la voie aux ambitions de la Prusse; le processus de l'unification allemande aurait inéluctablement impliqué une guerre franco-prussienne.
Les choses ne sont pas si simples. L'affaiblissement de l'Autriche est tout relatif. Quant à la montée en puissance de la Prusse, elle se serait produite en tout état de cause. L'unification allemande était inscrite dans la nature des choses; et si Bismarck a choisi la guerre pour l'obtenir, c'est qu'il était convaincu — voilà tout le drame — que la guerre la hâterait, que les Français accepteraient de se battre sans s'en donner les moyens.
***
Par tempérament, Louis Napoléon se sentait sans doutebeaucoup plus proche de la Prusse que de l'Autriche. Son inclination pour celle-là, sa répulsion pour celle-ci tenaient à son expérience vécue. Enfant, jeune homme, il a trouvé accueil en pays allemand, c'est en langue germanique qu'il a fait ses études, et son séjour à Augsbourg ne lui a laissé que de bons souvenirs. En revanche, plus tard, les Autrichiens l'ont pourchassé, devenant très tôt à ses yeux les symboles de l'oppression. Comment donc s'étonner que cet apôtre du principe des nationalités ne reste pas insensible devant la volonté de la Prusse... de mettre ce principe en pratique, et éprouve quelque peine à comprendre et apprécier l'étonnante mosaïque que constitue la « double monarchie », ce conglomérat rassemblant par la force Allemands, Hongrois, Italiens, Tchèques et tant d'autres populations...
Il a donc suivi avec intérêt, et même avec faveur, les efforts de la Prusse pour remplacer l'Autriche à la tête du mouvement
Weitere Kostenlose Bücher