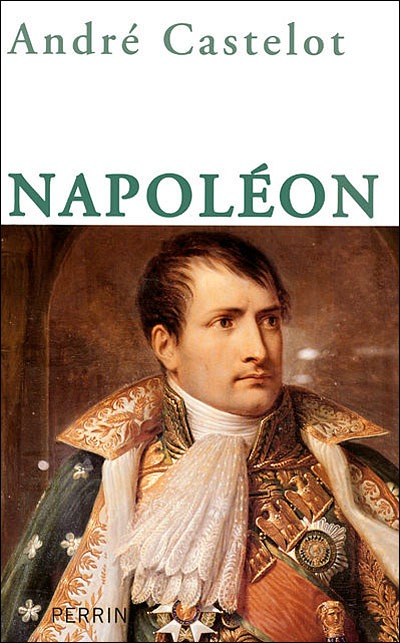![Napoléon]()
Napoléon
soixante-quatorze mille Autrichiens de Bellegarde et les troupes napolitaines de Murat.
Les souverains alliés tiennent une conférence. Que faire ? Schwarzenberg, à la tête de cent vingt mille soldats, penche pour la retraite, tandis que le tsar voudrait continuer la lutte. Avec les forces dont on dispose, il n’est pas possible que les coalisés ne parviennent pas à anéantir soixante-quatorze mille Français ! Finalement, on prend la décision de faire reculer l’armée de Bohême jusqu’au plateau de Langres. Le 1 er mars, à Chaumont, les souverains et les ministres alliés signent un traité – prélude de la Sainte-Alliance – qui lie entre elles les puissances ennemies de Napoléon pour vingt années, obligeant la Russie, l’Autriche et la Prusse à fournir, chacune, à la coalition cent cinquante mille hommes, tandis que lord Castlereagh ouvre largement sa bourse en offrant aux alliés de l’Angleterre cent cinquante millions de francs à se partager.
Blücher a été laissé libre de faire ce qu’il jugerait bon. Avec quarante-huit mille combattants, il s’apprête à commencer une marcher de flanc sur Paris. Napoléon, – il est ce soir du 27 février au presbytère d’Herbisse – informé du mouvement conçu par le Prussien, laisse à ses lieutenants le soin de résister aux harcèlements de Schwarzenberg, et part le 28, à la poursuite de Blücher. Son plan est d’écraser rapidement – il dit même exterminer – l’armée de Silésie, puis d’aller tendre la main aux garnisons qui occupent les places fortes du Nord-Est. Ensuite, on se retournera contre les Austro-Russes. Cependant, le mardi 1 » mars – après avoir quitté le matin le château d’Esternay où il a passé la nuit — Napoléon se trouve déjà arrêté dans son entreprise. Il ne peut traverser la Marne : Blücher, en se retirant, a fait détruire les ponts... On va les rétablir. Pendant ce temps, Russes et Prussiens courent vers Soissons, occupé par les Français. L’un des ponts réparé, Napoléon, le 2 mars, à deux heures du matin, s’élance. Il quitte La Ferté-sous-Jouarre pour Château-Thierry et Bézu-Saint-Germain, où il logera chez le maire, M. Harmand. Assurément, Soissons tiendra et le maréchal Vorwärts, pris dans « les replis » de l’Aisne, sera irrémédiablement perdu ! Mais le soir du 4, à Fismes, l’Empereur apprend la capitulation – la veille – de Soissons. Le général de brigade Moreau, avec treize cent vingt hommes, s’était trouvé attaqué par d’importantes forces prussiennes et russes. Après la reddition, en voyant la petite garnison défiler tambour battant devant l’état-major ennemi, le général Wintzingerode avait demandé à Moreau :
— Pourquoi ne faites-vous pas partir votre division en même temps que votre avant-garde ?
— Mais, répondit Moreau, c’est là tout ce que j’ai de troupes.
Moreau aurait pu sans aucun doute résister davantage et obéir aux ordres reçus, mais il céda dès le premier assaut. S’il faut en croire Thiers, « la capitulation de Soissons est, après la bataille de Waterloo, le plus funeste événement de notre histoire ! » La prise de Soissons ouvrait la route de Paris à Blücher ! Mais Henry Houssaye me semble plus juste en disant avec modération que « la reddition de cette ville sauva Blücher des plus grands périls ».
L’Empereur ne décolère point. Blücher va pouvoir emprunter le pont de Soissons et traverser l’Aisne ! L’armée de Silésie est tirée d’affaire ! Napoléon doit renoncer à l’écraser dans la nasse qu’il a préparée. De Fismes, il écrit à Clarke :
« L’ennemi était dans le plus grand embarras, et nous espérions recueillir aujourd’hui le fruit de quelques jours de fatigue, lorsque la trahison ou la bêtise du commandant de Soissons lui a livré cette place... Faites arrêter ce misérable, ainsi que les membres du conseil de défense ; faites-les traduire par-devant une commission militaire composée de généraux, et, pour Dieu ! faites en sorte qu’ils soient fusillés dans les vingt-quatre heures sur la place de Grève. »
Le coup est rude. Pour la première fois une profonde tristesse envahit l’Empereur. Dès lors, nous dit son valet de chambre « ses sourires furent forcés et pénibles ». De Fismes même – le matin du samedi 5 mars – il signe le décret ordonnant la levée en masse, mais il sait qu’il n’y a plus d’espoir. En
Weitere Kostenlose Bücher