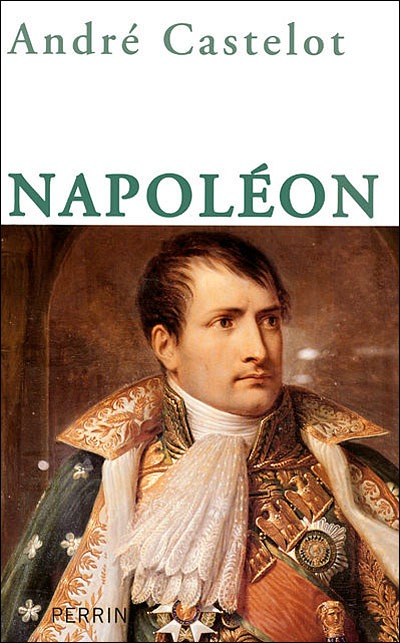![Napoléon]()
Napoléon
Montholon. Je ne veux plus d’Antommarchi... J’ai fait mon testament : je lui lègue vingt francs pour acheter une corde pour se pendre. C’est un homme sans honneur.
Antommarchi quitte la pièce. En présence des deux valets de chambre, Napoléon déclare encore une fois à Bertrand :
— Vous favorisez une chose déshonorante pour vous : le docteur est l’amant de votre femme... Mme Bertrand a perdu Antommarchi comme elle a perdu Gourgaud.
La semaine suivante – le 14 avril – le grand-maréchal n’en apporte pas moins au mourant des fleurs cueillies dans le jardin et lui propose de nouveau les soins de sa femme :
C’est une excellente garde-malade ; elle garderait Votre Majesté de jour et de nuit. Rien ne lui coûterait... elle a pris la plus grande part à sa maladie.
Napoléon refuse :
— Elle a trop de présomption, cela l’éreinterait. Elle a manqué à son rôle depuis six ans ; elle aurait du dîner avec moi, du moins faire ma partie, le soir.
— Eh bien, proteste Bertrand, elle a voulu réparer cela ; elle le veut encore.
Mais l’Empereur rejette la proposition.
Le lendemain 15 avril, le grand-maréchal lui ouvre son coeur et lui parle de « ses chagrins » :
— Je suis navré de douleur que l’Empereur me traite avec rigueur.
— Mais non. Je ne sais ce que vous voulez dire.
Expliquez-vous. Je suis malade, dans mon lit, je parle peu. Vous n’avez à vous plaindre de rien.
— Votre Majesté m’a ôté toute sa confiance. J’ai perdu presque sans regret le haut rang, la fortune et les honneurs où vous m’avez élevé. Mais ce nouveau malheur m’accable. J’ai quitté les honneurs comme un habit d’emprunt, mais je croyais avoir quelque droit à votre estime et à votre amitié. Je ne puis les perdre sans éprouver une vive peine. Il n’y a pas longtemps Votre Majesté disait que ma conduite avait été parfaite. Puis voici que vous êtes blanc et noir pour moi. Comment en si peu de temps ai-je pu perdre votre bonne grâce ?
— Mais je ne sais ce que vous voulez dire. Je vous traite très bien. Je n’ai rien contre vous. Marchand est celui dont les soins me sont les plus agréables parce que ce sont ceux auxquels je suis accoutumé. C’est vous rendre toute ma pensée.
— Ma pauvre femme, si le climat ne suffit pas pour la tuer, mourra de chagrin. Vous avez pardonné à tant d’ennemis. Ne pardonnerez-vous pas à d’anciens amis ? Elle a des torts sans doute, mais ne les a-t-elle pas cruellement expiés ? N’est-elle pas très malheureuse ? N’a-t-elle pas été exposée aux calomnies même les plus atroces ?
— Mais je n’ai rien à reprocher à Mme Bertrand. C’est une excellente femme. Je n’ai pas l’habitude de la voir.
On croit entendre la voix du grand-maréchal implorer :
— Elle vous aurait soigné avec tant d’affection. Elle vous est sincèrement attachée, bien plus que vous ne le pensez. Voyez-la demain, ne fût-ce qu’un instant.
— Mais quand je vous ai dit que les soins de Marchand m’étaient les plus agréables, parce que j’y étais le plus accoutumé, je vous ai fait comprendre toute ma pensée. Il en serait de même avec ma mère si elle ne m’eût pas soigné habituellement. Cependant je verrai Mme Bertrand avant de mourir.
— Nous n’en sommes pas là ! Nous vous conserverons. Vous m’avez dit quelquefois que vous étiez un père, pardonnez-nous comme à vos enfants. Ne sommes-nous pas vos amis ?
« Le grand-maréchal, écrit Bertrand en parlant toujours de lui-même, n’a pu retenir ses larmes. Il est resté encore une demi-heure avec l’Empereur qui n’a plus rien dit. »
Ce jour-là, Napoléon va livrer sa dernière bataille. Cet homme rongé par le cancer, ce prisonnier dont le corps est sans relâche secoué par des vomissements, cet agonisant qui ne se nourrit plus que de gelée de viande et demande d’une pauvre voix à Arnott « si l’on meurt de faiblesse et combien de temps l’on peut vivre en mangeant aussi peu qu’il le fait », ce mourant va dicter d’abord, écrire ensuite, en s’appliquant, afin de rendre lisible son effroyable écriture, un texte que l’on ne peut lire sans éprouver une intense émotion :
« Ce jourd’hui, 15 avril 1821, à Longwood, île de Sainte-Hélène.
« Ceci est mon testament ou acte de ma dernière volonté.
« Je meurs dans la religion apostolique et romaine, dans le sein de laquelle je suis né, il y a plus de
Weitere Kostenlose Bücher