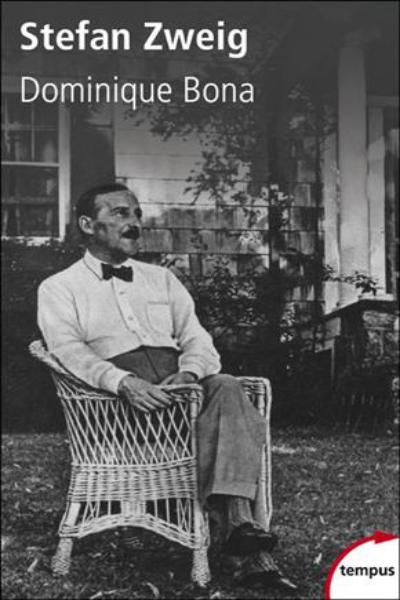![Stefan Zweig]()
Stefan Zweig
une ère nouvelle », les étudiants nazis brûlent d’autres ouvrages d’auteurs étrangers, également coupables d’« exercer une action subversive » et de « porter atteinte aux racines de la pensée allemande, du foyer allemand et des forces motrices de notre peuple ». Ainsi partent également en fumée des ouvrages de Jack London, d’André Gide et de Marcel Proust, d’Upton Sinclair, de Havelock Ellis, d’Emile Zola ou de H.G. Wells…
« Je me serais volontiers passé de cette publicité », écrit Zweig à l’un de ses amis avec cet humour qui est chez lui l’une des formes achevées de la pudeur et de la politesse.
En Allemagne, il est désormais diabolisé. Ses livres ont été retirés des librairies et des bibliothèques, ils sont interdits de toute publicité et de tout commentaire dans la presse. Il n’y sera plus publié. Son éditeur, Anton Kippenberg, lui écrit de Leipzig pour s’excuser : force lui est de l’abandonner. Son premier public, qui le portait au zénith, s’évanouit. Zweig peut déjà, avec horreur, envisager le jour où ses lecteurs seront à leur tour traqués et poursuivis. Nul esprit libre n’échappe à la persécution : cette même année, Thomas Mann, connu pour être un opposant au régime, quitte Munich avec sa famille ; sa maison et ses biens sont confisqués. Pour les nazis, Stefan Zweig, esprit libéral s’il en fut, est surtout coupable d’être rassenfremder – de race étrangère –, puisqu’il est juif, comme bon nombre d’écrivains victimes de l’autodafé. Différence notoire entre les deux communautés : la plupart des écrivains juifs allemands décident d’émigrer, tandis que leurs confrères autrichiens ne sont pas encore inquiétés. L’été 1933, Zweig assiste en toute tranquillité à son dernier festival de Salzbourg, et il s’assure les services d’un nouvel éditeur autrichien pour remplacer Insel Verlag, son éditeur à Leipzig depuis 1906. Ce sera Herbert Reichner, le directeur de la revue Philobiblon , qui s’y appliquera, tant que les lois raciales épargneront l’Autriche. Pour Zweig, Reichner Verlag est une manière d’échapper au diktat et de survivre en tant qu’écrivain. « La langue allemande est ma patrie, indissolublement », écrit-il, malheureux, conscient que tout son drame se joue dans ce déchirement.
« La langue dans laquelle on écrit ne permet pas de se séparer d’un peuple, même dans sa folie, et de le maudire, explique-t-il à Romain Rolland. Je ne veux pas, fidèle à moi-même, haïr tout un pays. » Il se garde, il se gardera toujours de la haine. Il ne veut pas subir la contagion de la violence.
De son côté, Richard Strauss poursuit sa bataille. Au terme d’une véritable crise politique qui oblige ses collaborateurs directs à avoir recours à Hitler en personne, il impose, face à face avec celui qui, entre-temps, est devenu le Führer, le choix de son librettiste. Fragile et dangereuse réponse à l’autodafé de Berlin, Strauss gagne la partie après de longs mois de négociations, obtenant enfin que le nom de Zweig apparaisse sur l’affiche.
Pour Zweig, la victoire est à double tranchant. En cosignant une œuvre dont le compositeur est compromis avec les nazis, ne va-t-il pas cautionner un régime qu’il honnit, et un musicien génial mais sulfureux ? Ne va-t-il pas commettre une faute impardonnable en acceptant que son nom et sa prose servent à leur tour le fascisme, qui vient de faire une éclatante exception pour lui seul, et condamne tous ses amis à l’exil ou au silence ? N’apparaîtra-t-il pas comme un traître à sa propre communauté ? Et, pire encore à ses yeux, un traître à ce combat pour les libertés chaque jour plus bafouées en Allemagne, et dont beaucoup pensent qu’elles vont être radicalement supprimées ? Il dira avoir réfléchi à tout cela mais, malgré les pressions qui pèsent lourd sur sa conscience, malgré le danger qu’il y a à apporter, à travers Strauss, un peu de lustre à l’univers médiocre et odieux des nazis, Zweig ne veut pas, en retirant sa pièce, « désavouer un artiste, qui a toujours été loyal et même amical » envers lui. « Il me répugnait de créer des difficultés à un génie du rang de Richard Strauss », dira-t-il. Aussi décide-t-il, comme il est coutumier de le faire, comme il le sera toujours, de laisser aller le cours des choses, en se gardant de les commenter.
Weitere Kostenlose Bücher