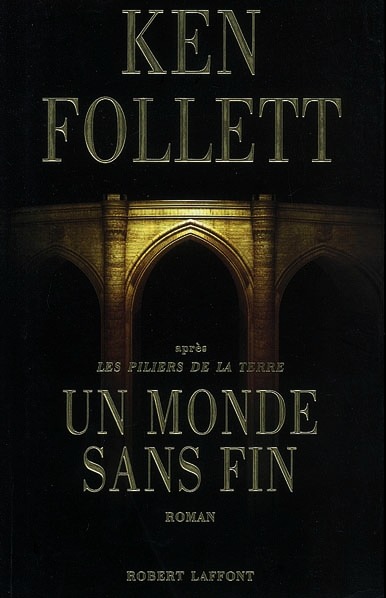![Un Monde Sans Fin]()
Un Monde Sans Fin
c’est-à-dire de faux pennies grossièrement
fabriqués dans un mauvais alliage d’argent, que l’on utilisait en guise de
menue monnaie. Il y avait aussi quelques pièces d’or : des florins, des
ducats et d’autres pièces similaires telles que le génois qui avait cours dans
la ville de Gênes, le real utilisé à Naples. Il y avait aussi des moutons
français de taille plus imposante, et des nobles anglais. Sœur Beth compara le
montant avec celui reporté dans un petit cahier. « Le compte est
juste », dit-elle quand elle eut fini.
Elles remirent toutes les pièces dans le coffret, le
fermèrent, et le rangèrent dans sa cachette souterraine.
Puis elles entreprirent de compter les pièces d’or du second
coffret, les rangeant en piles de dix. Arrivée presque au fond, sœur Beth
laissa échapper un petit cri.
« Qu’y a-t-il ? » demanda Caris.
Godwyn sentit une peur coupable l’oppresser.
Sœur Beth expliqua : « Ce coffret contient
exclusivement la somme léguée par la femme pieuse de Thornbury. J’ai veillé à
ne pas la mélanger au reste.
— Que voulez-vous dire ?
— J’étais certaine que la somme tout entière était en
ducats, or je vois qu’il y a là des florins ! »
Godwyn et Philémon se figèrent, aux aguets.
« Il est vrai que son mari commerçait avec Venise.
— C’est curieux, malgré tout, déclara Caris.
— Ce sera une erreur de ma part.
— Je trouve cela suspect.
— Vraiment ? objecta sœur Beth. Des voleurs ne
viendraient pas déposer de l’argent dans notre trésor.
— Vous avez raison », admit Caris de mauvais gré.
Elles achevèrent leur comptage. Elles avaient devant elles
dix piles de pièces équivalant à la somme de cent cinquante livres.
« C’est bien le chiffre reporté dans mon livre.
— La somme exacte jusqu’au dernier penny ! »
Et sœur Beth de conclure : « Comme je vous le disais, ma
sœur ! »
45.
Déconcertée par ce baiser, Caris avait passé des heures
entières à penser à sœur Mair. Sa propre réaction l’étonnait plus encore, car
elle devait bien admettre qu’elle avait éprouvé une sorte d’excitation. À ce
jour, elle ne s’était jamais sentie attirée par Mair ou par une autre femme. À
vrai dire, une seule personne au monde avait fait naître en elle le désir
d’être touchée, embrassée et pénétrée : Merthin. Au couvent, elle avait
appris à se passer de tout contact physique. L’unique main à se promener sur
son corps avec sensualité était la sienne, dans l’obscurité du dortoir,
lorsqu’elle se rappelait les moments où elle avait été aimée. Elle enfouissait
alors son visage dans l’oreiller pour que les autres religieuses ne l’entendent
pas haleter.
Si Mair était loin de lui inspirer le désir joyeux que la
simple vue de Merthin suffisait jadis à susciter en elle, elle lui plaisait
bien malgré tout, se dit-elle après mûre réflexion. Probablement à cause de son
visage angélique, de ses yeux bleus, et de la gentillesse dont elle faisait
preuve tant à l’hospice qu’à l’école. Et puis Merthin n’était-il pas à mille
lieues de Kingsbridge ? Cela faisait sept ans déjà qu’elle ne l’avait pas
vu.
Mair lui parlait toujours avec douceur. Quand personne ne
les regardait, elle frôlait son bras ou son épaule. Une fois, elle avait même
osé lui caresser la joue. Sans aller jusqu’à la repousser, Caris veillait à ne
pas répondre à ses gestes. Non qu’elle considère ces relations comme un péché,
car Dieu, dans son infinie sagesse, ne pouvait pas tenir rigueur aux femmes de
vouloir procurer du plaisir à autrui ou à soi-même ou en recevoir ; non,
si elle se retenait, c’était plutôt par crainte de décevoir Mair, devinant
instinctivement que celle-ci éprouvait pour elle des sentiments forts et
définis alors que les siens étaient incertains. Mair est amoureuse de moi,
comprenait-elle, moi, je ne le suis pas. Si je l’embrasse encore, elle risque
de voir en moi une âme sœur pour le reste de sa vie, et moi, je ne peux rien
lui promettre.
Et c’est ainsi qu’elle ne répondit à aucune des avances de
la jolie religieuse jusqu’à la semaine de la foire à la laine.
La foire de Kingsbridge avait retrouvé son éclat depuis la
récession de 1338. Certes, le marché de la laine vierge continuait à pâtir des
édits royaux et les marchands italiens ne se déplaçaient plus qu’une fois tous
les deux ans, mais le
Weitere Kostenlose Bücher