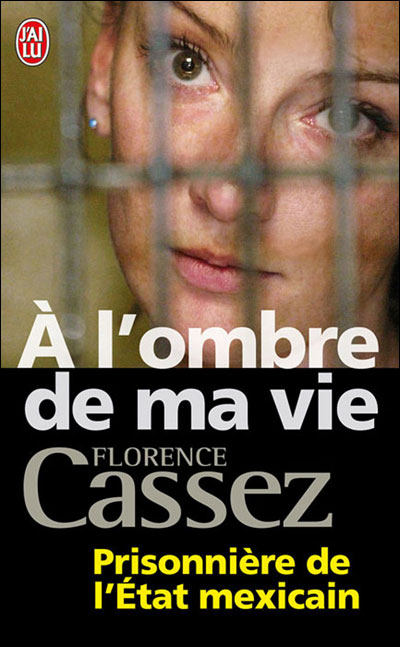![A l'ombre de ma vie]()
A l'ombre de ma vie
français s’est prononcé afin de se
réserver, pour lui-même, la compétence de prendre des décisions concernant la
suspension ou la réduction de la peine ou les moyens de la faire exécuter. Cela
ouvrait la possibilité que Florence Cassez ne purge pas sa peine conformément
au jugement décidé par les autorités mexicaines, ou qu’elle la purgerait dans
un délai significativement réduit. Pour le Mexique, cela est inacceptable.
J’ai beau être à moitié ivre de désespoir, j’ai encore
l’esprit suffisamment clair pour comprendre qu’aucun message n’a encore été
envoyé au gouvernement français, cette fois ouvertement méprisé. En parlant de
la sorte, Felipe Calderón veut montrer à son peuple que la France a voulu le
berner, le prendre pour un naïf et qu’il lui signifie aujourd’hui qu’il est le
plus fort, le plus malin. Je ne m’en sortirai jamais.
Nous sommes à la fin du mois de juin, à quelques jours des
élections législatives pour lesquelles les sondages promettent la défaite du
PAN, le parti de Calderón. Même ici, on sourit de la manœuvre politique, mais
je n’ai plus le cœur à sourire. Ce qui m’envahit, à cet instant, c’est la
signification pour moi de ce que vient d’annoncer Calderón : soixante
années ici, c’est mon arrêt de mort.
Frank Berton veut que nous continuions à nous battre. Qu’il
continue s’il veut, moi je ne peux plus. Il dit aux journalistes que je suis
devenue une otage politique, que ce sera maintenant à la justice internationale
d’en décider ; devant le concert mondial des nations, il annonce de nouveau
sa plainte contre Garcia Luna, dont il continue d’affiner les arguments, et le
recours de l’État français contre l’État mexicain devant la Cour internationale
de justice – de toute façon, au point où en sont leurs relations…
Je n’ai pas grand-chose à faire de tout cela. Frank veut que
j’appelle Denise Maerker, qui me sollicite : alors je m’exécute. Et deux
ou trois autres, aussi, qui me demandent des interviews. Je dis ce que j’ai sur
le cœur, ma douleur, mon innocence, mon désespoir, sans y réfléchir avant,
comme d’habitude, mais sans chercher à retenir mes larmes, cette fois, parce
que, tout simplement, je n’en ai plus la force.
Trois ou quatre interviews, alors que j’en ai tant donné,
depuis trois ans et demi. Trois ou quatre de trop, semble-t-il. Elles sont
relayées dans l’opinion, dirait-on : mes mots et mes pleurs font un peu de
bruit, remuent quelques consciences refusant de suivre aveuglément
l’acharnement de Felipe Calderón. Pascal Beltràn del Rio, le très respecté
directeur du journal El Excelsior, écrit une chronique cinglante et
dénonce son gouvernement, qui perd selon lui toute crédibilité dans cette
affaire. Le pénaliste Samuel Gonzales Ruiz dénonce l’incohérence dans le
comportement de son pays. Ce sont autant de coups de semonce puissants que
Felipe Calderón ne peut admettre, que Genaro Garcia Luna, sans doute, veut
briser dans l’œuf, car il sent que l’opinion semble de nouveau touchée.
Œil pour œil, dent pour dent, la réponse ne se fait pas
attendre. Un jeudi soir, vers vingt-deux heures, une escorte policière vient me
chercher dans ma cellule. Au fond de moi, je panique à l’idée de ce qui peut
m’arriver, mais je suis incapable d’exprimer cette terreur qui me prend et me
paralyse encore plus. C’est ainsi depuis quelques jours : je ne peux même
plus manger, je suis amorphe. Et c’est bien ce que je craignais de pire :
ils m’emmènent et j’ai juste le temps d’attraper deux ou trois sous-vêtements
et ma brosse à dents. Dans ce que j’entends des conversations entre les
policiers et les gardes de la prison, il semble que c’est bien à cause de mes
interviews, notamment à Denise Maerker. Évidemment, ce n’est pas ce qu’ils me
disent, à moi. Officiellement, je change de prison parce que je ne vais pas
bien et que je serai mieux surveillée où je vais, c’est donc pour me protéger
de moi-même. J’ai compris : ils me ramènent à Santa Martha.
On est en pleine nuit. Revoilà le couloir sordide,
l’ambiance de fin du monde qui règne ici, en dehors de toute vie normale,
l’humidité, les rats et l’eau marron – quand il y a de l’eau. Et la violence.
On me traite comme on l’a toujours fait ici, avec un mélange de mépris et de
provocation, et on me fait entrer dans une cellule où une femme est
Weitere Kostenlose Bücher