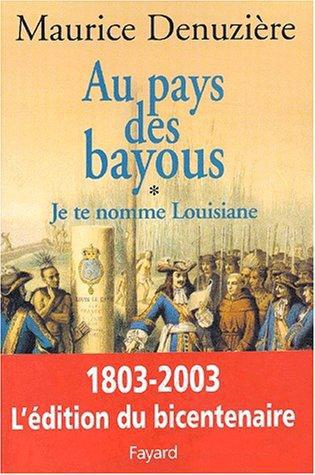![Au Pays Des Bayous]()
Au Pays Des Bayous
admonestées par Bienville. Venues en Louisiane aux frais du roi pour assurer le peuplement du pays, ne devaient-elles pas « s'établir suivant l'usage des colonies » ?
L'état des lieux
La Louisiane du commencement du XVIII e siècle n'avait rien de la terre accueillante que décrivaient alors, à Paris, les recruteurs coloniaux. Le voyageur d'aujourd'hui peut aisément imaginer, en parcourant le delta sauvage où, il y a une trentaine d'années, William Faulkner chassait le daim et le cerf, ce que devaient ressentir les Européens qui débarquaient en 1700 dans ce pays subtropical. Le décor naturel du bas Mississippi, où il serait vain de chercher une pierre, car la terre n'est que limon porté par le fleuve au cours des millénaires, n'a guère changé, même si les derricks des pétroliers dressent, çà et là, des silhouettes importunes. Sur des milliers d'hectares, l'immense plaine palustre, parsemée de cyprières, lézardée de ramifications sinueuses par où s'écoulent paresseusement vers la mer, derrière des rideaux de plantes aquatiques, les eaux lasses du fleuve, suscite autant l'admiration que l'angoisse. Sur les quelques routes inondables qui traversent maintenant cette vaste réserve naturelle, des panneaux indiquent clairement au voyageur de notre temps qu'il circule à ses risques et périls. Les initiés ne s'y aventurent qu'à bord de quatre-quatre amphibies et pourvus de treuil et de radio !
Les premiers colons de la vallée de la Mobile ne disposaient pas de ces commodités. Ceux qui, partis des forts, s'égaillèrent vers l'ouest furent d'abord étonnés par le nombre, la variété et la beauté de certains oiseaux. L'abondance du gibier à plume et à poil dut les réjouir. Daims, chevreuils, dindes sauvages, outardes, cailles, perdrix que les Indiens nommaient Ho-Ouy, merles, canards de toute sorte offraient aux chasseurs de quoi améliorer le maigre ordinaire de garnison. En faisant l'inventaire des ressources du pays, ils furent, en revanche, moins favorablement impressionnés par le foisonnement des reptiles de toute taille : serpent d'eau gros comme du câble d'amarrage, mocassin au venin mortel, tête-de-cuivre au dard empoisonné, serpent-collier qui se fond dans le décor en déployant ses anneaux rouges et verts, serpent-congo à bouche blanche, serpent-corail à l'œil de chat, couleuvre énorme mais inoffensive, serpent à sonnette, que les scientifiques appellent Crotalus horridus et qui peut vivre plus de vingt ans en s'allongeant jusqu'à atteindre quatre mètres !
La présence d'innombrables alligators aux mâchoires broyeuses, aux dents acérées, rendait dangereuse toute progression dans les marais. L'été, on pouvait confondre les sauriens, cuirassés d'écailles repoussantes, avec des troncs d'arbres à demi immergés quand ils somnolaient étendus sur l'eau ou vautrés dans la vase au milieu des joncs. L'hiver, ils disparaissaient enfouis dans la boue et malheur à qui les réveillait. Leurs plongeons, quand ils redoutaient l'approche de l'homme ou se jetaient sur une proie, résonnaient en ploufs sonores et effrayants.
Mais la plaie dont souffraient tous les Européens, dès qu'ils mettaient pied à terre, était le maringouin, moustique des pays chauds auquel les Louisianais donnent encore aujourd'hui son ancien nom français. Parcourant le delta un siècle et demi après les premiers colons français, le géographe Élisée Reclus 3 se plaint encore de l'agressivité des maringouins : « […] le fléau, la calamité, la malédiction de la Louisiane, ce qui change parfois la vie en martyre de tous les instants, c'est un petit insecte, le maringouin. Rien ne le tue, ni les pluies, ni les sécheresses, ni la chaleur de l'été, ni le froid de l'hiver ; le jour, on le voit partout volant par essaims ; la nuit, on entend sans relâche le bourdonnement importun de ses ailes ; il s'insinue à travers les fentes les plus étroites, il pénètre sous les voiles les plus épais, et se précipite sur sa victime en exécutant avec ses ailes une petite fanfare victorieuse 4 . »
La piqûre du maringouin n'était pas qu'un cuisant désagrément. Dans certains cas, elle portait le germe de la mort.
Moins dangereuse, mais plus douloureuse encore que celle du maringouin, la piqûre de la mouche-brûlot, térébrante comme une pointe de feu, éprouvait cruellement ceux qui allaient jambes nues dans la folle avoine où paissaient les cervidés à cornes
Weitere Kostenlose Bücher