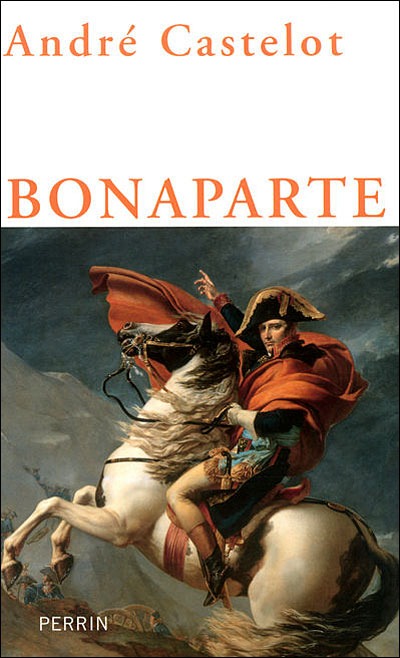![Bonaparte]()
Bonaparte
douter qu’elle ne fût une fille. Je la regardais : elle s’arrêta, non pas avec cet air grenadier (des autres), mais un air convenant parfaitement à l’allure de sa personne. Ce rapport me frappa. Sa timidité m’encouragea et je lui parlai, moi qui, pénétré plus que personne de l’odieux de son état, me suis toujours cru souillé par un seul regard... Mais son teint pâle, son physique faible, son organe doux ne me firent pas un moment en suspens. Ou c’est, me dis-je, une personne qui me sera utile à l’observation que je veux faire, ou elle n’est qu’une bûche.
— Vous aurez bien froid, lui dis-je, comment pouvez-vous vous résoudre à passer dans les allées ?
— Ah, Monsieur ! l’espoir m’anime. Il faut terminer ma soirée.
L’indifférence avec laquelle elle prononça ces mots, le flegmatique de cette réponse me gagna et je passai avec elle.
— Vous avez l’air d’une constitution bien faible. Je suis étonné que vous ne soyez pas fatiguée du métier.
— Ah ! dame ! Monsieur, il faut bien faire quelque chose.
— Cela peut-être, mais n’y a-t-il pas de métier plus propre à votre santé ?
— Non Monsieur, il faut vivre !
Je fus enchanté, je vis qu’elle me répondait au moins, succès qui n’avait pas couronné toutes les tentatives que j’avais faites.
— Il faut que vous soyez de quelque pays septentrional car vous bravez le froid.
— Je suis de Nantes en Bretagne.
— Je connais ce pays-là... Il faut, mademoiselle, que vous me fassiez le plaisir de me raconter la perte de votre p...
— C’est un officier qui me le prit.
— En êtes-vous fâchée ?
— Oh ! oui, je vous en réponds. (Sa voix prenait une saveur, une onction, que je n’avais pas encore remarquée). Je vous en réponds. Ma soeur est bien établie actuellement. Pourquoi ne l’eussé-je pas été ?
— Comment êtes-vous venue à Paris ?
— L’officier qui m’avilit, que je déteste, m’a abandonnée. Il fallut fuir l’indignation d’une mère. Un second se présenta, me conduisit à Paris, m’abandonna et un troisième, avec lequel je viens de vivre trois ans, lui a succédé. Quoique Français, ses affaires l’ont appelé à Londres et il y est... Allons chez vous.
— Mais qu’y ferons-nous ?
— Allons, nous nous chaufferons et vous assouvirez votre plaisir.
J’étais bien loin de devenir scrupuleux. Je l’avais agacée pour qu’elle ne se sauvât point quand elle serait pressée par le raisonnement que je lui préparais en contrefaisant une honnêteté que je voulais lui prouver ne pas avoir... »
Bonaparte n’a pas conté la suite. Je gage cependant que, lorsque selon l’usage, la fille pénétrant dans la chambre n° 9 de l’hôtel de Cherbourg, demanda comment s’appelait son client, elle fut passablement étonnée en l’entendant répondre : Napollioné.
Les affaires de Buonaparte traînent toujours et il se voit contraint de demander une nouvelle prolongation de son congé pour six mois. Celle-ci lui est accordée jusqu’au 1 er juin 1788, et il décide, puisqu’il n’a rien pu obtenir à Paris, de retourner en Corse.
Sa famille vit toujours dans une grande pénurie d’argent. Letizia qui a encore près d’elle quatre enfants à élever et assume les dépenses de Joseph parti pour l’Université de Pise, et celles de Lucien au Séminaire d’Aix, fait des prodiges d’économie domestique. Napoléon le dira plus tard – non sans fierté d’ailleurs : « le principe était de ne pas dépenser ». La Madré s’astreint aux travaux ménagers et l’argent ne sort de la poche que pour ce qui est absolument indispensable : le café, le sucre ou le riz que l’on est bien obligé d’acheter chez l’épicier. Pour le reste, on vit des produits de la propriété. Les Bonaparte possèdent un moulin banal où tous les villageois vont moudre et donnent en échange une certaine quantité de farine. Il en est de même pour la location du four qui est acquittée « avec des poissons ». Le vin est fourni par la vigne, le fromage par les chèvres, la viande par le maigre troupeau. « On n’aurait pas acheté des gâteaux, précisera l’Empereur, c’eût été mal vu. La famille tenait à honneur de n’avoir jamais acheté ni pain, ni vin, ni huile. » De tous les fruits, ceux que le petit officier aime le plus sont des cerises génoises : « Il me semble n’avoir jamais mangé rien d’aussi bon. »
Repris par son pays, la France lui paraît
Weitere Kostenlose Bücher