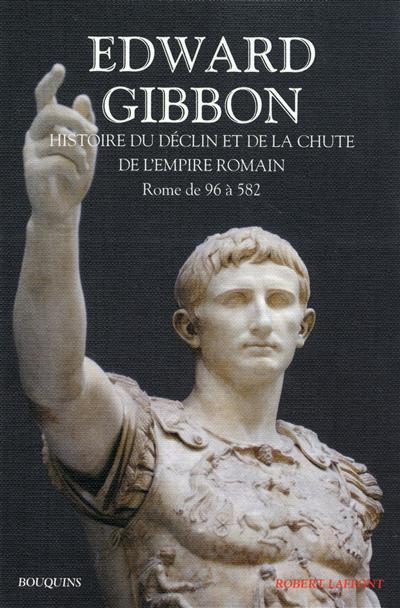![Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain]()
Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
prospérité de l’Église chrétienne, et se
moquaient publiquement sur leurs théâtres des questions théologiques.
Constantinople jouissait seule de l’avantage d’être née, dans le sein de
l’Église, et de n’avoir jamais été souillée par le culte des idoles ; tous ses
habitants avaient fortement embrassé les opinions, les vertus et les passions
qui distinguaient les chrétiens de ce siècle de tout le reste de l’univers.
Après la mort d’Alexandre, Paul et Macedonius se disputèrent le siége épiscopal.
Ils en étaient dignes l’un et l’autre par leur zèle et par leurs talents ;
et si Macedonius l’emportait par la pureté des mœurs, son concurrent avait sur
lui l’avantage d’une élection antérieure et d’une doctrine plus orthodoxe.
L’inviolable attachement à la foi de Nicée, qui l’a placé au rang des saints et
des martyrs, l’exposa au ressentiment des ariens. Dans l’espace de quatorze
ans, il fut cinq fois chassé de son siège, et réinstallé plus souvent par la
révolte du peuple que par la permission du souverain. La mort de Paul pouvait
seule assurer à Macedonius la possession tranquille de son évêché. On traîna
l’infortuné Paul, accablé sous le poids des chaînes, depuis les déserts
sablonneux de la Mésopotamie jusqu’aux plus affreuses habitations du mont Taurus [2455] . On le tint
enfermé dans un donjon obscur, où il resta six jours sans subsistance, et fut
enfin étranglé par l’ordre de Philippe, un des principaux ministres de
Constance [2456] .
La première fois que le sang coula dans la nouvelle capitale, ce fut pour des
démêlés ecclésiastiques ; et un grand nombre de citoyens des deux partis
perdirent la vie dans des émeutes violentes et opiniâtres. Hermogènes, maître
général de la cavalerie, avait été chargé de mettre à exécution la sentence qui
condamnait Paul au bannissement ; cette commission lui devint fatale. Les
catholiques accoururent à la défense de leur évêque ; ils réduisirent en
cendres le palais d’Hermogènes ; traînèrent par les talons ce premier officier
militaire de l’empire dans toutes les rues de Constantinople ; et, lorsqu’il
eut perdu la vie, son corps inanimé demeura exposé à tous les outrages d’une
populace en fureur [2457] .
Le malheur d’Hermogènes servit de leçon à Philippe, préfet du prétoire, et lui
apprit à se conduire avec plus de circonspection dams la même entreprise. Il
fit demander Paul, dans les termes les plus honorables, une entrevue amicale
dans les bains de Zeuxippe, qui communiquaient au palais et à la mer. Entraîné
dans un vaisseau qui attendait au bas dé l’escalier du jardin, tout prêt à mettre
à la voile, le prélat était déjà en route pour Thessalonique, et le peuple
ignorait encore ce projet sacrilège. Il vit bientôt, avec autant de surprise
que d’indignation, les portes du palais s’ouvrir, et l’usurpateur Macedonius
assis à côté du préfet, dans un char élevé, en sortir accompagné d’un nombreux
cortège de gardes, l’épée nue à la main. Cette procession militaire s’avançait
vers la cathédrale ; les catholiques et les ariens se précipitèrent en foule
pour s’en emparer. Cette sanglante émeute coûta la vie à trois mille cent
cinquante habitants de Constantinople ; et Macedonius, soutenu par des troupes
régulières, remporta la victoire, mais son gouvernement fut continuellement
troublé par des séditions et des clameurs. Des objets qui n’avaient aucun
rapport au fond de la dispute, suffisaient pour nourrir et enflammer la
discorde. La chapelle dans laquelle on avait déposé le corps de Constantin le
Grand tombait en ruines ; le prélat fit transporter les vénérables restes de
l’empereur dans l’église de Saint-Acace. Cette pieuse et sage précaution passa
pour une profanation odieuse aux yeux du parti qui suivait la doctrine de l’ homoousion .
Les deux factions prirent les armes ; le terrain consacré servit de champ de
bataille, et un historien ecclésiastique a observé comme un fait réel, et non
pas par figure de rhétorique, que la fontaine située en face de l’église fut
remplie du sang qui en débordait et coulait dans les cours et dans les
portiques des environs. L’historien qui n’imputerait ces fureurs qu’aux
principes religieux, annoncerait bien peu de connaissance du cœur humain :
il faut avouer cependant que le motif qui aveuglait le zèle, et le prétexte qui
déguisait le
Weitere Kostenlose Bücher