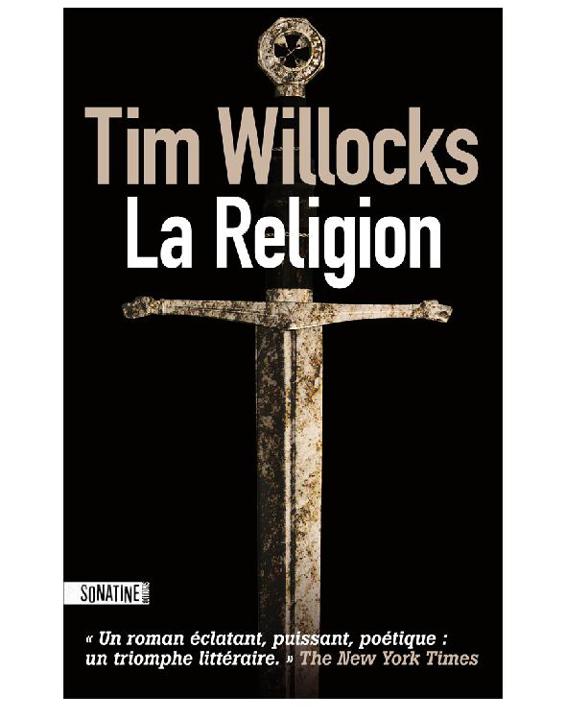![La Religion]()
La Religion
chiens, les bêtes qu’il aimait plus que tout au monde. Il les avait tués pour le peuple, pour la Religion et pour Dieu.
Pour tenter d’attirer l’animal plus près, Orlandu songea à lui tendre la peau trempée de gras encore attachée à son bras ; mais duper ce chien, comme il l’avait fait avec les cabots sauvages des jours précédents, lui sembla ignoble, et peut-être impie. Il montra son couteau au lévrier.
Le lévrier se retourna et fila.
Orlandu partit à sa poursuite.
TOUTE LA MATINÉE, alors que la fraîcheur s’estompait et que la chaleur montait, haute et dure, Orlandu poursuivit, perdit, retrouva et perdit à nouveau le lévrier fugitif, avant de le repérer encore. Du haut au bas du Borgo, de la porte Provençale dans l’énorme enceinte côté terre jusqu’aux quais de la crique des Galères, de Kalkara à Saint-Ange, à travers les marchés et les masures, et du soleil à l’ombre. Et tandis que le chien et le garçon parcouraient chaque rue et chaque ruelle, la ville elle-même se transformait en une ruche terrorisée.
Des tambours roulaient, et des trompettes et des cloches sonnaient. La stupéfaction et l’émoi s’emparaient de la population. Le petit peuple avait cru que les Turcs n’arriveraient pas avant un bon mois. Chaque visage tourmenté était blême d’effroi. Beaucoup couraient s’enfermer dans leurs maisons. D’autres se pressaient frénétiquement de-ci de-là, sans le moindre but. Et à travers toute l’île, ceux qui n’étaient pas encore derrière les remparts se précipitaient vers le Borgo pour demander asile. Les paysans menaient avec eux tout le bétail qui pouvait être utilisé ou mangé. À dos d’âne, dans des chariots ou sur leurs propres épaules opiniâtres, ils apportaient aussi le reste des récoltes moissonnées à la hâte et les fruits arrachés à tous les vergers. Ils amenaient leurs femmes et leurs enfants, leurs légumes et leurs chèvres, et ces précieuses petites choses qui rappellent la vie et ce qu’on a été. Ils apportaient leurs icônes et leurs prières, leur courage et leur peur. Et, dans toutes les directions, des fumées montaient en spirales dans le ciel. Chaque champ, chaque lopin de terre impossible à moissonner et toutes les provisions qu’ils ne pouvaient pas transporter devaient être brûlés. Ils incendiaient la terre. Leur propre terre. Ils empoisonnaient tous les puits avec les entrailles des chiens, des herbes mortelles et des excréments. Rien ne devait être laissé pour le Turc, car le Turc était là.
On aurait dit que tout Malte était en feu.
Une seule fois Orlandu s’arrêta dans sa poursuite, sur le port, là où il avait commencé, qui était maintenant empli d’une agitation tumultueuse. Il n’avait ni mangé ni bu depuis le brasero des sentinelles la veille, et il se sentit défaillir tout d’un coup, et les visages des gens et des chevaux commencèrent à danser devant ses yeux. Il se retrouva à quatre pattes, les narines pleines de la puanteur terreuse du crottin des mulets. Il appuya son front sur le pavé et vomit une pleine bouche de bile. Puis une paire de mains osseuses saisit ses épaules pour le remettre debout.
Il ferma les yeux pour arrêter le tourbillon et fut guidé jusqu’à un seau renversé pour s’asseoir. On lui poussa dans la bouche quelque chose de mouillé, à la fois aigre et sucré, qu’il mâcha et avala. Son estomac se serra sur le pain trempé de vin. Il réussit à le garder pendant que des doigts osseux lui en remplissaient à nouveau la bouche. La nausée et les vertiges disparurent aussi vite qu’ils étaient arrivés. Il cligna plusieurs fois des yeux et découvrit son sauveteur.
Les yeux du vieil homme étaient aussi brillants que ceux d’un enfant, et son nez était si crochu qu’il paraissait rejoindre les poils de son menton pointu. Orlandu le reconnut immédiatement. C’était Omar, le vieux karagozi . Derrière lui se dressait le minuscule théâtre délabré où il exerçait son singulier métier. De toute mémoire, l’homme du karagozi avait toujours été une figure des quais. Certains disaient qu’il était là bien avant l’arrivée des chevaliers. C’était la personne la plus vieille qu’Orlandu ait jamais vue, plus vieux que La Valette lui-même ou Luigi Broglia, et avec tous les autres enfants et beaucoup de marins fatigués et de débardeurs aussi, il avait souvent fait ses délices des bouffonneries
Weitere Kostenlose Bücher