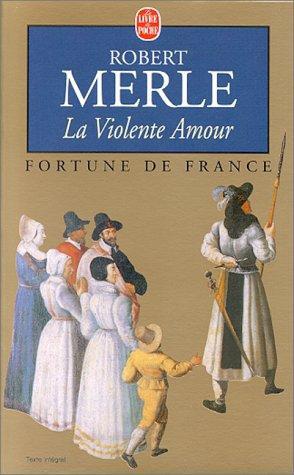![La Violente Amour]()
La Violente Amour
voyait à ce début que Navarre n’avançait si prudemment la
patte que parce qu’il craignait de le piquer, plaise à vous de parler en toute
liberté. Je vous ois.
— Sire,
dit Navarre quand en notre dernière guerre, j’étais contraint, à mon très grand
regret, de vous combattre, si j’avais ouï que vous rassembliez vos forces pour
ne faire qu’une seule armée, je me serais estimé – selon le monde –
ruiné. Au lieu de cela, oyant que vous donniez une armée à Guise, une autre à
Joyeuse et une autre à vous-même, je me disais : « Dieu soit
loué ! Me voilà hors danger d’avoir mal ! »
— Je vous
entends, dit le roi, mais peux-je laisser en le présent prédicament les villes
et provinces que je tiens encore sans soldat ?
— Sans
soldat, non, Sire, mais sans armée, oui, pour ce que leur rôle doit être
défensif, et rien de plus. Et quant à vous, Sire, rassemblant de tous côtés le
surplus de ces armées diverses et dispersées, et vous fortifiant d’autant, vous
pourrez assaillir la Ligue à l’avantage, au lieu d’attendre d’être par elle
attaqué avec les faibles forces que vous avez céans.
C’était bien
dit, et sans nommer le comte de Soissons, ni le duc d’Épernon en faveur
desquels le roi s’était si imprudemment démuni, alors même que la conservation
de la Bretagne et de l’Angoumois n’était point de si grande conséquence que sa
victoire ou sa défaite. Henri, cependant, envisageait Navarre d’un air pensif,
et encore qu’il répugnât, de par l’immense bénignité de son cœur, à enlever à
Soissons et d’Épernon les troupes qu’il leur avait données, je vis bien que la
raisonnableté des propos de Navarre l’en avait persuadé, et qu’il y viendrait,
si du moins Mayenne lui en laissait le temps.
— Assaillir
la Ligue, dit-il à la parfin, mais où ?
— À
Paris, Sire, dit Navarre sans broncher. Les membres ne sont rien, quand on n’a
pas la tête.
— Mais
mon frère, dit le roi d’un air fort troublé, assiéger Paris est une tâche
immense !
— Il y
faudra bien venir, cependant, dit Navarre. Et le plus tôt possible. Pour moi,
Sire, poursuivit-il, ressaisi par sa coutumière impatience, et se levant à demi
de son escabelle, je compte, avec votre permission, départir dès demain pour
Chinon afin de ramener céans le reste de mon infanterie. Et remparer d’autant
vos troupes de Tours.
Lecteur, après
les si grands intérêts qui furent en cet entretien débattus, j’ai quelque
vergogne à dire que ma très humble fortune y fut aussi en quelques mots
décidée. Alors que Navarre déjà se levait pour prendre son congé, et que le
roi, le saisissant par le bras sans lui permettre de se génuflexer, le
reconduisait…
— Siorac,
mon fils, dit tout soudain le roi, en s’arrêtant et se tournant vers moi, tu
m’as dans le passé si bien servi que je te veux laisser libre de choisir le
champ, ou la capacité, où d’ores en avant tu me serviras.
— Sire,
dis-je, quand votre diplomatie, de par la nécessité de caler la voile, était double, je fus votre instrument en celle des deux qui demeurait secrète,
ce que désormais je ne saurais être, puisque de présent votre dessein véritable
est celui que vous proclamez. Je serais donc infiniment obligé à Votre Majesté,
puisqu’il est question d’assaillir la Ligue, que vous me permettiez d’apprendre
la guerre sous l’un de vos capitaines.
— En ce
cas, dit le roi, en souriant, cela ne peut être qu’avec le roi de Navarre,
puisqu’il est le plus grand capitaine du royaume, et avec le baron de Mespech
qui servit si bien mon grand-père à Cerisoles, et mon père à Calais.
Cette phrase
scella mon sort, mais point, cependant, tout à plein, car si le roi me donna à
Navarre, celui-ci ne me donna pas à mon père, mais à M. de Rosny. Et si
j’appris sous M. de Rosny le métier des armes, vint un temps, comme on verra,
où je fus remis derechef, en de quasi incrédibles circonstances, aux secrètes
et périlleuses entreprises que je croyais à jamais révolues.
CHAPITRE II
En départant
pour rameuter son infanterie de Chinon et la ramener au roi, Navarre laissa M.
de Rosny à Tours – et moi-même par conséquent – afin d’y donner avis
et conseils à ceux qui commandaient les forces du roi en la ville.
La tâche n’en
fut pas aisée, Crillon, Gerzé et Rubempré – les trois maîtres de
camp – étant hommes à espincher de
Weitere Kostenlose Bücher