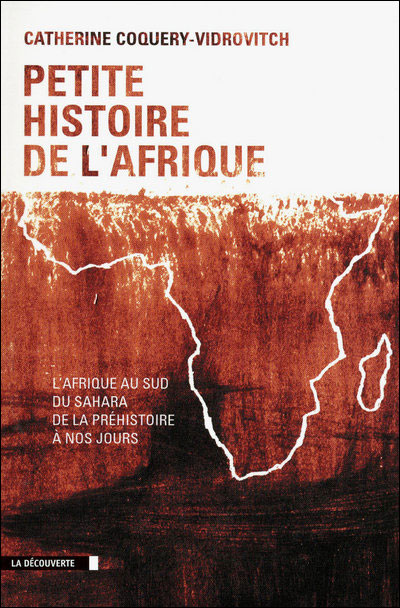![Petite histoire de l’Afrique]()
Petite histoire de l’Afrique
régions « riches » (en cacao ou en café) virent flamber les prix ; si la famille du jeune homme n’avait pas de quoi payer la dot, l’apport du futur mari se faisait en heures de travail, comme en pays igbo (au sud-est du Nigeria actuel), où il pouvait être réduit en quasi-servage par sa future belle-mère. Les hommes pouvaient aussi migrer en ville pour gagner chez les Blancs le salaire qui paierait la dot. Les dons en nature (selon les cas, bracelets ou plateaux de cuivre, vache, etc.) prirent alors une valeur marchande, ce que traduit bien l’évolution du vocabulaire anglais, du « bridewealth » au « brideprice ». En Afrique centrale notamment, la femme devint un bien que le mari pouvait aussi, par courtoisie, offrir à un hôte de passage — unfrère de sang ou un allié lignager — pour l’honorer (on a dit dans le chapitre précédent que cette circulation des femmes ne fut pas sans incidence sur la propagation, exceptionnelle dans cette zone, des maladies vénériennes).
La grande polygamie des chefs était un instrument politique de domination : Mutesa, souverain ganda du XIX e siècle, aurait eu 300 ou 400 épouses. Le roi Njoya des Bamoum (Cameroun) en avait, au début du XX e siècle, 1 200, et laissa à sa mort, au début des années 1930, 163 enfants vivants (il en aurait eu 350 !). Au milieu du XX e siècle, le souverain des Kuba, au Congo belge, possédait encore 600 épouses. L’infériorité du genre féminin ne rendait pas pour autant les femmes solidaires entre elles. Les vieilles reproduisaient les rapports inégalitaires de séniorité, contrôlant à leur place et non pour elles, mais pour les hommes du lignage, le travail effectué par les plus jeunes et les servantes. La mère du mari, puis la ou les premières épouses exerçaient leur pouvoir sur les brus, sur les coépouses plus jeunes et, bien entendu, sur les femmes esclaves (dont certaines pouvaient être coépouses). Ces rapports inégalitaires se répétaient à tous les niveaux, depuis le noyau familial de base jusqu’à l’exploitation d’État.
Si les femmes de l’aristocratie n’avaient qu’à surveiller le travail d’une armada de serviteurs et d’esclaves, certains chefs saisirent l’opportunité des innovations coloniales pour mettre leurs nombreuses épouses, donc autant de houes, au travail dans les plantations de caféiers ou de cacaoyers. Dans la forêt comme en savane,au sein d’un État comme dans une structure politique éclatée, chez les agriculteurs comme chez les éleveurs, le travail des paysannes était organisé de façon similaire. Car il faut bien davantage parler de paysannes que de paysans. Les régions où le travail des champs était effectué par les hommes sont assez rares, surtout localisées en Afrique de l’Ouest. « Le pastoralisme est supérieur à l’agriculture comme l’homme est supérieur à la femme », dit un proverbe luo (Kenya). Chez les éleveurs, les jeunes garçons gardaient les vaches, mais ce sont les femmes qui mettaient les mains à la pâte : elles les trayaient et faisaient le beurre. L’usage masculin de la houe n’existait que dans la zone sahélienne : chez les Senoufo du Mali ou chez les Hausa, où les femmes n’avaient le droit de sortir qu’à la nuit tombée ou vivaient recluses — ce qui fut exceptionnel en Afrique subsaharienne, sauf sur la côte orientale swahilie. Chez les Fon du Bénin, le fait de travailler aux champs était mal vu pour une femme, même si cela n’était pas défendu. Les femmes étaient plutôt marchandes ou artisanes, potières ou teinturières (à l’indigo). Les hommes maniaient la hache pour l’abattage des arbres. En Afrique subsaharienne, la charrue fut un corollaire tardif de la « modernisation », et apparut quand le minimum de capital nécessaire fut monopolisé par les hommes. Aux femmes, il ne resta alors que leur savoir-faire millénaire.
----
Notes du chapitre 4
1 . La transmission matrilinéaire se faisait d’oncle à neveu dit utérin (fils de la sœur), car la transmission du lignage se faisait pas les femmes.
2 . Les « confréries » sont une organisation typiquement africaine de l’islam, que l’on retrouve en particulier au Sénégal. La confrérie mouride a pour origine un pieux musulman, Amadou Bamba, qui fut au début du XX e siècle inquiété par l’administration coloniale, ce qui valut au mouvement de nombreux adeptes ou talibe . Ses
Weitere Kostenlose Bücher