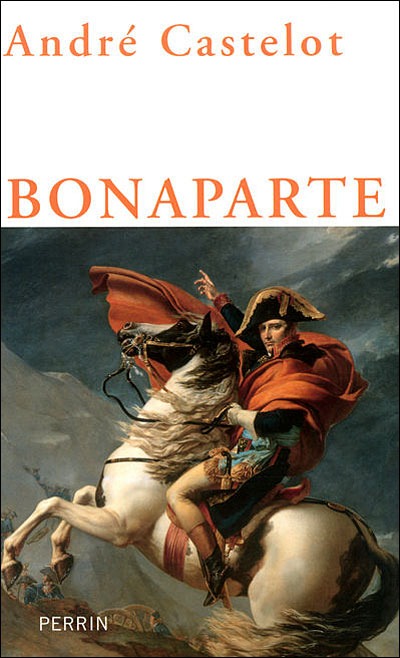![Bonaparte]()
Bonaparte
demeure calme, ce qui permet à La Révellière-Lépeaux de s’extasier : « Pas une goutte de sang n’a été répandue. » Les cent soixante fusillés de la plaine de Grenelle ne furent peut-être pas tout à fait de cet avis... Assurément le coup d’État a criblé de tant de plomb le parti royaliste qu’il ne s’en relèvera pas. Il essayera bien de s’agiter sous le Consulat – même en lançant des bombes et en organisant des guets-apens – mais il faudra la chute de l’Empire pour lui rendre son existence.
« Mon général, écrit Augereau à Bonaparte, ma mission est accomplie... Paris est calme et émerveillé d’une crise qui s’annonçait terrible et qui s’est passée comme une fête... » Sauf, bien sûr, pour les trois cent vingt-neuf déportés dont cent soixante périront à Cayenne !
Le soudard est aux anges... et, comme le constate Thibaudeau :
— Il eût volontiers recommencé tous les matins un dix-huit fructidor.
On expédie Augereau en Allemagne afin de le calmer, et aussi afin de l’opposer éventuellement à Bonaparte...
Venant de Milan, Bonaparte est arrivé, le 27 août, à Passeriano où vont se dérouler les conférences avec l’Autriche. Il loge au bord du Tagliamento, dans une maison de campagne – presque un château – ayant appartenu à Manni, doge de Venise. Chaque jour il se rend à Udine où se trouvent les plénipotentiaires autrichiens. L’Empereur a longtemps tardé avant d’accepter l’ouverture des négociations – ce qui a permis à Napoléon de s’exclamer :
— Il est impossible de se moquer de nous avec aussi peu de pudeur...
Craignant même que ces atermoiements ne cachent le désir de reprendre les combats, il avait écrit à François II : « Serait-il donc possible que le fléau terrible de la guerre dût encore recommencer ? Et Votre Majesté voudra-t-elle donner le signal du ravage de l’Allemagne ? » Mais, au dernier moment, les événements de Paris lui ont fait craindre « que l’on ne s’amusât à gloser sur cette démarche » – et il n’a pas envoyé la lettre...
Enfin l’Empereur s’était décidé. En voulant maintenant conclure la paix le plus rapidement possible, François II espérait bien que son envoyé, l’ambassadeur de Cobenzl, aurait la tâche aisée. En attendant son arrivée, Bonaparte aurait en face de lui le violent et égoïste baron de Thugut. Fils d’un batelier, il avait été ministre plénipotentiaire à Paris au début de la Révolution, puis, ministre des Affaires étrangères et s’était déclaré ennemi acharné de la démocratie française. Une des clauses secrètes du traité de Loeben exigeait son renvoi... Par contre, la franchise du troisième plénipotentiaire – le Napolitain Marzio Mastrilli, marquis, puis un jour duc de Gallo – plut à Bonaparte. « Je fais préparer de beaux présents pour les plénipotentiaires de l’Empereur, en cas que la paix se fasse, annonce le général en chef à Talleyrand. Ce sont des garnitures de diamants formant des branches d’olivier, que l’on estime à quatre-vingts ou quatre-vingt-dix mille écus... »
En dépit des cadeaux, et en l’absence de Cobenzl, les choses se traînent. « Les négociations vont assez mal, écrit Bonaparte au Directoire le 6 septembre. Cependant, je ne doute pas que la Cour de Vienne n’y pense à deux fois avant de s’exposer à une rupture, qui aurait pour elle des conséquences incalculables... Mais si l’on passe le mois d’octobre, il n’y a plus de possibilité d’attaquer l’Allemagne ; il faut se décider promptement et rapidement. » Les pourparlers sont bientôt au point mort. Bonaparte en donne les raisons à Talleyrand : « L’on se figurerait difficilement l’imbécillité et la mauvaise foi de la cour de Vienne. Dans ce moment-ci nos négociations sont suspendues, parce que les plénipotentiaires de Sa Majesté Impériale ont envoyé un courrier à Vienne pour connaître l’ultimatum de l’Empereur. »
Le 26 septembre, un officier arrive de Paris porteur « d’une espèce de circulaire » – l’expression est de Bonaparte – adressée par Augereau aux généraux de division de l’armée d’Italie. Ainsi, Augereau, avec sans doute l’assentiment du Gouvernement, ose donner des directives par-dessus la tête de son ancien chef ! Bonaparte tient le prétexte qui va lui permettre, en menaçant une dixième fois de s’en aller, d’obtenir carte blanche pour traiter avec les Autrichiens
Weitere Kostenlose Bücher