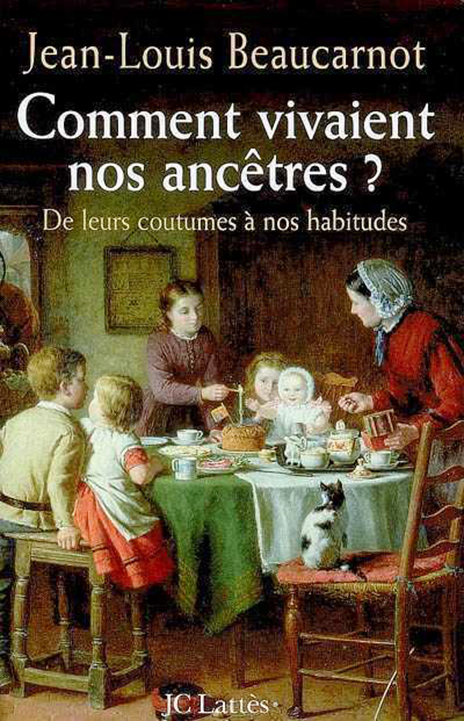![Comment vivaient nos ancêtres]()
Comment vivaient nos ancêtres
s’énerver de corps et d’esprit », bien mauvaise occupation pour des enfants.
En fait d’occupations, les enfants d’autrefois n’en manquent guère, et des plus laborieuses. Rares, très rares sont les jouets, excepté quelques morceaux de bois taillés et transformés en sifflet ou en moulin à eau. Au reste, les plus jeunes jouent avec des chats, ou encore attrapent des grillons ou des cigales. Les plus vieux se bagarrent entre bandes de hameaux ou de quartiers différents dans le plus pur style de La Guerre des boutons.
La majeure partie de leur temps est donc, déjà, largement consacrée au travail. Dès l’âge de six à sept ans, le gosse est envoyé dans les prés pour garder les troupeaux d’oies ou de moutons. Dans le Massif central, il va au « couderc », pré en altitude, pour y garder le cochon. « Avant cinq heures, raconte le vieux Tiennon à Émile Guillaumin dans La Vie d’un simple, maman me tirait du lit et je partais, les yeux gros de sommeil. Un petit chemin tortueux conduisait à la pâture. […] La rue était creuse, toujours assombrie et un peu mystérieuse, si bien qu’une crainte mal définie m’étreignait en la parcourant. Il m’arrivait d’appeler Médor, qui jappait en conscience derrière les brebis fraîchement tondues, pour l’obliger à marcher tout près de moi ; et je mettais ma main sur son dos pour lui demander protection. »
À la pâture, pour beaucoup de ces petits bergers et bergères, la journée est souvent longue, difficile et angoissante. Surtout lorsque la forêt voisine a la réputation d’être infestée de loups que l’on entend parfois hurler pendant la nuit. Et cette fois-ci, point de croque-mitaine… Combien de personnes âgées se souviennent d’authentiques histoires de loups, racontées par leur père qui les avait lui-même vécues étant enfant, à la fin du XX e siècle. Dans les Vosges, en Lorraine, ou jusqu’en Limousin en bordure de la forêt des Cars, les loups étaient bel et bien là, tapis sous les feuillages, prêts à fondre sur le troupeau. La vie dure et laborieuse des petits campagnards aide à comprendre comment le travail en atelier des jeunes enfants de la révolution industrielle, qui durait souvent huit à dix heures par jour, pouvait être facilement accepté. On les avait toujours fait travailler à la campagne, à la différence qu’ils y respiraient l’air pur et non les exhalaisons fétides des ateliers.
On peut se demander si nos ancêtres vont ou non à l’école et ce qu’ils y apprennent. Mais, au fait, l’école existe-t-elle ? Pas plus que Charlemagne, Jules Ferry n’a « créé » l’école qui existe déjà sous l’Ancien Régime. Rarement confiée à un « maître d’école », aussi appelé « recteur d’école », engagé ou approuvé par les habitants, elle est organisée par l’Église, et c’est le curé, ou quelque lai’c pour les plus petits, qui mêle au catéchisme des rudiments de lecture et parfois d’écriture.
Avec des moyens limités, tout au plus un vieil abécédaire, un Évangile et un recueil de prières, il enseigne dans la sacristie ou au presbytère. Les cours sont parfois interrompus par la visite à un malade qui reçoit les derniers sacrements ou par une messe. Cet enseignement est réservé aux garçons. Quelques vieilles femmes se chargent éventuellement des filles à qui elles ont davantage le souci d’enseigner comment « besogner de l’aiguille » que les lettres de l’alphabet. Enfin, ces écoles ne sont guère suivies assidûment. Les élèves les plus réguliers fréquentent l’école tout au plus cinq mois par an pendant huit à dix ans, de la Toussaint à la Saint-Georges, le 23 avril, c’est-à-dire en dehors des périodes de gros travaux nécessitant leur présence aux champs. À ce rythme, les fils de Français moyens de l’époque sont peu instruits. Ceux qui le deviennent suivent des cours particuliers, toujours avec un curé, notamment lorsque la famille en compte un parmi ses membres . Voilà pourquoi, dans bien des régions rurales d’avant la Révolution, savoir écrire est un signe de notabilité. La plupart du temps, le généalogiste ne trouve, au bas de l’acte de baptême ou de mariage, que la signature du prêtre accompagnée de la formule « lesquels ne sachant signés, de ce enquis » (de quoi je me suis enquis), à moins que l’un ou l’autre n’ait tracé « sa marque », c’est-à-dire une croix,
Weitere Kostenlose Bücher