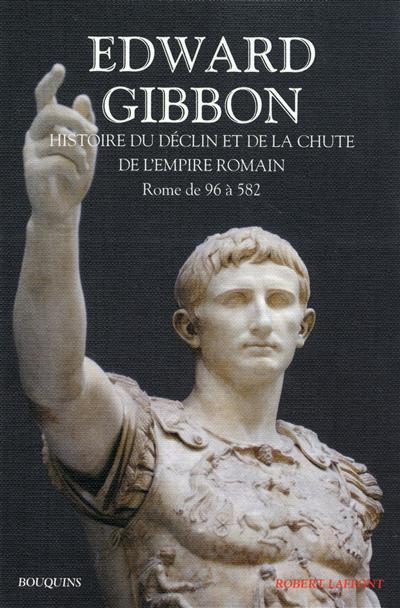![Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain]()
Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
la condition
différente des villes sont marquées avec les plus grands détails.
[188] Strabon, Géogr. , XVII, p. 1189.
[189] Josèphe, de Bello judaico , II, 16 ;
Philostrate, Vies des Sophistes , II, p. 548, édit. Olear.
[190] Tacite, Annales , XV, 55. J’ai pris quelque
peine à consulter et à comparer les voyageurs modernes, pour connaître le sort
de ces onze villes asiatiques. Sept ou huit sont entièrement détruites, Hypæpe,
Tralles, Laodicée, Ilion, Halicarnasse, Mlilet, Éphèse, et nous pouvons ajouter
Sardes. Des trois qui subsistent encore, Pergame est un village isolé contenant
deux ou trois mille habitants. Magnésie, sous le nom de Guzel-Hissar, est une
ville assez considérable, et Smyrne est une grande ville peuplée de cent mille
âmes ; mais à Smyrne, tandis que les Francs soutenaient le commerce, les Turcs
ont ruiné les arts.
[191] Le Voyage de Chandler dans l’Asie-Mineure ,
p. 225, etc., contient une description agréable et fort exacte des ruines de
Laodicée.
[192] Strabon, XII, p. 866 ; il avait étudié à Tralles.
[193] Voyez une dissertation de M. de Boze, Mémoires de
l’Académie , tome XVIII. Il existe encore un discours d’Aristide, qu’il
prononça pour recommander la concorde à ces villes rivales.
[194] Le nombre des Égyptiens, sans compter les habitants
d’Alexandrie, se montait à sept millions et demi (Josèphe, de Bello jud. ,
II, 16). Sous le gouvernement militaire des mameluks, la Syrie était censée
renfermer soixante mille village. Histoire de Timur-Bec , V, c. 20.
[195] L’itinéraire suivant peut nous donner une idée de la
direction, de la route et de la distance entre les principales villes : 1°
depuis le mur d’Antonin jusqu’à York, deux cent vingt-deux milles romains ; 2°
Londres, deux cent vingt-sept ; 3° Rhutupiæ ou Sandwich soixante-sept ; 4°
trajet jusqu’à Boulogne, quarante-cinq ; 5° Reims, cent soixante-quatorze ; 6°
Lyon, trois cent trente ; 7° Milan trois cent vingt-quatre ; 8° Rome, quatre
cent vingt-six ; 9° Brindes, trois cent soixante ; 10° trajet jusqu’à Dyrrachium,
quarante ; 11° Byzance, sept cent onze ; 12° Ancyre, deux cent
quatre-vingt-trois ; 13° Tarse, trois cent un ; 14° Antioche, cent quarante et
un ; 15° Tyr, deux cent cinquante-deux ; 16° Jérusalem, cent soixante-huit ; en
tout quatre mille quatre-vingts milles romains, qui sont un peu plus que trois
mille sept cent quarante milles anglais. Voyez les Itinéraires publiés par
Wesseling, avec ses notes. Voyez aussi Gale et Stukeley, pour la Bretagne, et
M. d’Anville pour la Gaule et l’Italie.
[196] Montfaucon ( Antiquité expliquée , tome IV,
part. 2, liv. I, c.5) a décrit les ponts de Narni, d’Alcantara, de Nîmes, etc.
[197] Bergier, Histoire des grands chemins de l’empire ,
II, c. I, 28.
[198] Procope, in Hist. arcanâ , c. 30 ; Bergier, Hist.
des grands chemins , l. IV ; Code Théodosien , l. VIII, tit. V, vol.
II, .p. 506-563, avec le savant commentaire de Godefroi.
[199] Du temps de Théodose, Cæsarius, magistrat d’un rang
élevé, se rendit en poste d’Antioche à Constantinople : il se mit en route le
soir, passa le lendemain au soir en Cappadoce, à cinquante-cinq lieues
d’Antioche, et arriva le sixième jour, à Constantinople, vers le milieu de la
journée. Le chemin était de sept cent vingt-cinq milles romains, environ six
cent soixante-cinq milles anglais. Voyez Libannius, orat. , XXI ; et les Itinéraires ,
p. 572-581.
[200] Pline, quoique ministre et favori de l’empereur,
s’excuse de ce qu’il avait fait donner des chevaux de poste à sa femme pour une
affaire très pressée, l. X, lett. 121, I22.
[201] Bergier, Hist. des grands chemins , l. IV, c.
49.
[202] Pline, Hist. nat. , XIX, I.
[203] Selon toutes les apparences, les Grecs et les
Phéniciens portèrent de nouveaux arts et des productions nouvelles dans le
voisinage de Cadix et de Marseille.
[204] Voyez Homère, Odyssée , IX, v. 358.
[205] Pline, Hist. nat. , XIV.
[206] Strabon, Géogr. , IV, p. 223. Le froid excessif
d’un hiver gaulois était presque proverbial parmi les anciens.
Strabon dit seulement que le raisin ne mûrit pas
facilement. On avait déjà fait des essais au temps d’Auguste, pour naturaliser
la vigne dans le nord de la Gaule ; mais il y faisait trop froid. Diodore de
Sicile, éd. Rhodomann, p. 304 ( Note de l’Éditeur ).
[207] Cela est prouvé par un passage de Pline l’Ancien, où
il parle
Weitere Kostenlose Bücher