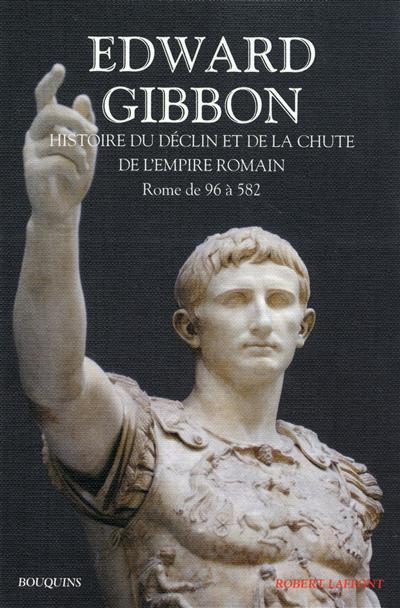![Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain]()
Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
somme énorme ; mais, Appien l’explique en
disant que c’était le revenu de dix ans, ce qui porte le revenu annuel, du
temps d’Antoine, à 20.000 talents ou 3.875.000 sterl., environ 93.000.000
francs ( Note de l’Éditeur ).
[537] Strabon, XVII, p. 798.
[538] Velleius Paterculus, II, c. 39. Cet auteur semble
donner la préférence au revenu de la Gaule.
[539] Les talents cuboïques, phéniciens et alexandrins,
pesaient le double des talents attiques. Voyez Hooper, sur les Poids et
Mesures des anciens , p. IV, c. 5. Il est probable que le même talent fut
porté de Tyr à Carthage.
[540] Polybe, XV, 2.
[541] Appien, in Punicis , p. 84.
[542] Diodore de Sicile, V. Cadix fut bâti par les
Phéniciens un peu plus de mille ans avant la naissance de Jésus-Christ. Voyez
Velleius Paterculus, I, 2.
[543] Strabon, III, p. 148.
[544] Pline, Hist. nat. , XXXIII, c. 3. Il parle
aussi d’une mine d’argent en Dalmatie, qui en fournissait par jour cinquante
livres à l’État.
[545] Strabon, X, p. 485 ; Tacite, Annal. , III, 69,
et IV, 30. Voyez dans Tournefort ( Voyage au Levant , lettre VIII) une
vive peinture de la misère où se trouvait alors Gyare.
[546] Juste Lipse ( de Megnitudine romanâ , II, c. 3)
fait monter le revenu à cent cinquante millions d’écus d’or ; mais tout son
ouvrage, quoique ingénieux et rempli d’érudition, est le fruit d’une
imagination très échauffée.
Si Juste Lipse a exagéré le revenu de l’empire romain,
Gibbon, d’autre part, l’a trop diminué. Il le fixe environ de quinze à vingt
millions sterl. (de trois cent soixante à quatre cent quatre-vingt millions de
francs) ; mais si l’on prend seulement, d’après un calcul modéré, les impôts
des provinces qu’il a déjà citées, ils se montent à peu prés à cette somme, eu
égard aux augmentations qu’y ajouta Auguste : il reste encore les provinces de
l’Italie, de la Rhétie, de la Norique, de la Pannonie, de la Grèce, etc., etc.
; qu’on fasse attention, de plus, aux prodigieuses dépenses de quelques empereurs
(Suétone, Vespasien, 16), on verra que de tels revenus n’auraient pu y suffire.
Les auteurs de l’ Histoire universelle (partie XII) assignent quarante
millions sterl. (environ neuf cent soixante millions de francs), comme la somme
à laquelle pouvaient s’élever à peu près les revenus publics ( Note de
l’Éditeur ).
[547] Il n’est pas étonnant qu’Auguste tint ce langage. Le
sénat déclara aussi, sous Néron, que l’État ne pouvait subsister sans les
impôts tant augmentés qu’établis par Auguste (Tacite, Annales , XII, 50).
Depuis l’abolition des différents tributs que payait l’Italie, abolition faite
en 646-694 et 695 de Rome [108, 60 et 59 av. J.-C.], l’État ne retirait pour
revenu de ce vaste pays que le vingtième des affranchissements ( vicesima
manumissionum ), Cicéron s’en plaint en plusieurs endroits, notamment dans
ses Lettres à Atticus , II, lettre 15 ( Note de l’Éditeur ).
[548] Les douanes ( portoria ) existaient déjà du
temps des anciens rois de Rome ; elles furent supprimées pour l’Italie l’an de
Rome 694 [60 av. J.-C.], par le préteur Cecilius Metellus Nepos : Auguste ne
fit ainsi que les rétablir ( Note de l’Éditeur ).
[549] Ils n’avaient été exempts si longtemps que de l’impôt
personnel ; quant aux autres impôts l’exemption ne datait que des années
646-94, 95 [108, 60, 59 av. J.-C.]. ( Note de l’Éditeur ).
[550] Tacite, Annales , XIII, 31.
[551] Voyez Pline ( Hist. nat. , VI, 23 ; XII, 18) :
il observe que les marchandises de l’Inde se vendaient à Rome cent fois leur
valeur primitive ; de là nous pouvons nous former quelque idée du produit des
douanes ; puisque cette valeur primitive se montait à plus de huit cent mille
liv. sterling.
[552] Dans les Pandectes , l. 39, t. IV, de
Publican . Comparez Cicéron, Verrin , II, 72 et 74 ( Note de
l’Éditeur ).
[553] Les anciens ignoraient l’art de tailler le diamant.
[554] M. Bouchaud, dans son Traité de l’impôt chez les
Romains , a transcrit cette liste, qui se trouve dans le Digeste, et il a
voulu l’éclaircir par un commentaire très prolixe.
[555] Tacite, Annales , I, 78. Deux ans après,
l’empereur Tibère, qui venait de réduire le royaume de Cappadoce, diminua de
moitié l’impôt sur les consommations ; mais cet adoucissement ne fut pas de
longue durée.
[556] Dion ne parle ni de cette proposition ni de la
capitation ; il dit
Weitere Kostenlose Bücher