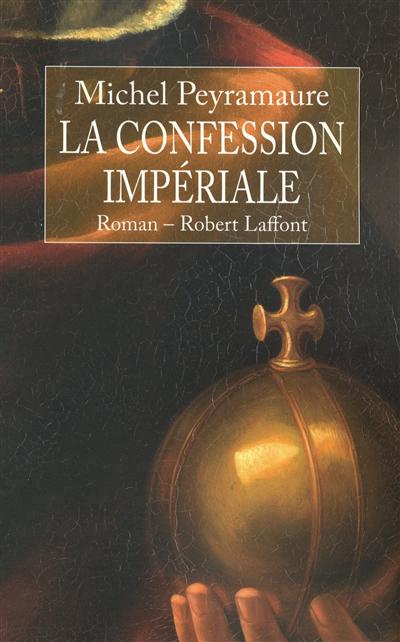![La confession impériale]()
La confession impériale
armes
n’eurent pas à intervenir.
Une assemblée était appelée à débattre d’un
problème crucial pour le salut du monde : savoir si le Saint-Esprit
procédait du Père et du Fils ou des deux à la fois ? Je me gardai de
prendre parti dans cette controverse savante et absconse, dont l’intérêt
d’ailleurs m’échappait. On avait débattu de cette question durant des siècles
sans parvenir à faire éclater la vérité, ce qui n’avait altéré en rien la
puissance de l’Église.
Les débats allaient durer des mois et auraient
pu se poursuivre encore une année sans troubler mes nuits. « Continuez, m’écrivit
le pape, à formuler votre prière suivant la coutume : “Au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, et n’écoutez pas les sirènes de Constantinople”… »
Je respectai son conseil.
D’une autre
importance étaient les événements qui allaient avoir pour théâtre le nord de la
Péninsule italienne, l’année 804. J’avais naguère annexé l’Istrie sans
provoquer de résistance dans la population. Les provinces voisines, Dalmatie et
Vénétie, en principe sous l’administration de Byzance, jouissaient d’une
indépendance de fait.
Ces deux provinces étaient connues pour leur
prospérité, malgré les constantes querelles entre clans et familles pour des
affaires relevant surtout du commerce : elles exportaient des poissons et
du sel et importaient du vin, du blé et des étoffes de Byzance et d’Orient.
Chaque ville était un port fréquenté par des flottes cosmopolites.
La sérénité engendrée par ces transactions
allait être compromise par un événement dramatique.
Une conjuration byzantine avait décidé, pour
des raisons obscures, de faire disparaître le patriarche Jean, l’un des grands
personnages religieux de l’Empire d’Orient, qui résidait dans l’île de Grado,
entre Istrie et Vénétie. On avait retrouvé son cadavre au bas d’une tour de sa
résidence.
Alors que je me trouvais à Salz, j’appris la
nouvelle de ce drame par une visite du nouveau patriarche, Fortunat, porteur de
deux portes d’ivoire merveilleusement sculptées. Il me pressa d’intervenir dans
cette affaire navrante, mais dont l’importance m’échappait.
J’écrivis à Nicéphore pour lui demander raison
de cet acte d’une extrême brutalité ; il ne daigna pas répondre. En
revanche, les populations réclamaient mon aide à cor et à cri.
Je fis connaître cette situation délicate à
mon fils Pépin, roi d’Italie, qui se trouvait dans sa capitale, Pavie, et lui
demandai ce qu’il convenait de faire, ce drame ayant eu lieu au nord de son
pays. Il me répondit qu’il pouvait, en une semaine, réunir une armée pour
remettre de l’ordre dans ces territoires ; il n’attendait qu’un signe de
ma part pour intervenir.
Quelques semaines plus tard, il marchait vers
le nord de la Péninsule, dispersait les quelques garnisons byzantines qui se
trouvaient sur son chemin, ramenait l’ordre dans la population révoltée et
occupait ces territoires avec la ferme intention de les annexer.
C’était la guerre.
Quelques mois plus tard, riposte de
Byzance : une flotte conduite par le patrice Nicétas se présenta sur les
côtes de Dalmatie pour y débarquer une armée. L’arme au pied, Pépin attendait
cette réaction. Excellents marins mais soldats de pacotille, les Byzantins
n’opposèrent à Pépin qu’une résistance dérisoire et furent balayés. Vénétie et
Dalmatie avaient changé de maître.
Le basileus n’allait pas rester sur cette
humiliation. L’année suivante, nouvelle expédition, conduite cette fois par une
sommité militaire, le préfet Paul. Cette fois, Pépin allait avoir affaire à
forte partie. Après une bataille indécise aux portes de Commachio, dans
l’exarchat de Ravenne, il parvint à repousser l’ennemi et à le forcer à rembarquer,
mais le préfet Paul porta son armée, renforcée par des contingents de Sicile,
sur la ville portuaire de Populonia, sur les côtes de Toscane, qu’elle prit et
pilla.
La situation, qui,
dans cette partie de la Péninsule, avait périclité avec la guerre, était
devenue d’une telle complexité que mon fils y perdait son latin et ne savait où
donner de la tête. Il lui était vite apparu dangereux de se fier à la sincérité
de ces peuples, des Vénitiens notamment, réputés cauteleux. Selon les fortunes
de la guerre, ils prenaient partie pour l’un ou l’autre belligérant, dans le
seul but
Weitere Kostenlose Bücher