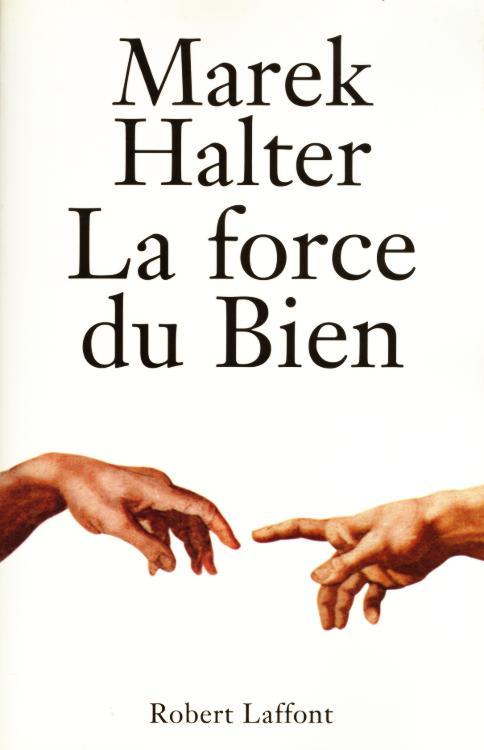![La force du bien]()
La force du bien
organise tout, prend les rendez-vous, revoit les discours et… me fait emprunter l’ascenseur privé de Jean-Paul II. C’est lui qui a mis au point cette nouvelle rencontre. Il a compris ce que signifie pour moi, dans mon enquête à propos des Justes, le fait de buter à chaque pas sur l’Église. Il sait qu’il m’est impossible de contourner cette présence, comme il sait que celle-ci soulève dans ma mémoire des images obsédantes… Et me voici invité à la table du pape, dont j’apprends qu’il vient de décider de déjeuner en ma compagnie !
Stanislas Dziwisz me fait entrer dans la bibliothèque personnelle du pape. Nous attendons quelques instants, et Jean-Paul II arrive.
« Alors, m’apostrophe-t-il d’emblée en polonais, on déjeune ? Vous avez faim ?
— Très Saint-Père, balbutié-je, je suis très ému…
— Vous avez faim, non ? Suivez-moi… »
Nous pénétrons dans la vaste salle à manger, occupée par une table impressionnante, large, recouverte d’une nappe blanche. Trois couverts sont mis : belle vaisselle, argenterie, cristal. Dziwisz est placé en bout de table, et le pape en face de moi…
Les deux mètres de largeur de cette fameuse table vont vite nous poser un petit problème. Le pape entend mal, il place ses mains en cornet autour de ses oreilles pour comprendre ce que je dis quand je lui parle. Résultat : il ne mangera rien si je continue de l’abreuver de paroles !
« Saint-Père, lui dis-je, mangez ! Je me tairai pour que vous puissiez manger !
— Si je mange, s’amuse-t-il, je ne pourrai pas parler. Nous serons contraints au silence. Vous ne parlerez pas et moi non plus : qu’allons-nous faire… ?
Nous rions, et trouvons tout de même moyen de déjeuner. Une vieille servante nous apporte un bouillon de vermicelles, comme, jadis, chez ma mère. Puis nous dégustons de petites escalopes panées accompagnées de chou-fleur, le tout suivi de thé au citron servi dans des verres très hauts, à la polonaise. Ce menu ne serait qu’anecdotique s’il n’éveillait en moi une émotion à peine contrôlable. N’y tenant plus, je soupire :
« Vous savez, c’est comme chez ma mère.
— Ah oui ? Parlez-moi de votre mère. »
Je lui raconte : ma mère, poète yiddish, est morte il y a plus de quinze ans, et depuis plus de quinze ans personne ne m’a fait un tel repas : comme chez elle, à sa façon, avec ses mets favoris. Et je le vois soudain ému à l’idée qu’il a, sans le savoir, dressé un repas maternel , une atmosphère perdue pour moi à tout jamais, et qui, littéralement, ressuscite à sa table.
Une fois ce repas terminé, nous parlerons de tout, de la Russie, du Proche-Orient. Et il m’annonce ce que personne, en dehors des intéressés, ne savait encore : il allait reconnaître Israël.
Et puis, au détour d’une interrogation d’ordre général sur l’état d’esprit des hommes en cette fin de siècle et de millénaire, je lui dis :
« Saint-Père, vous le savez aussi bien que moi, l’homme ne peut vivre sans espoir. Les grands espoirs laïcs universels ont disparu : il ne reste plus que vous, les Églises. »
Jean-Paul II se prend la tête entre les mains :
« C’est dramatique, ce que vous me dites là !
— Pourquoi, Saint-Père ? Voilà une situation où l’on doit se tourner vers vous : ça devrait vous faire plaisir.
— Me faire plaisir ?… Certes, non ! La religion doit être l’ultime recours de l’homme. Si la religion devient le recours exclusif, alors c’est la guerre des religions qui s’allume… Écoutez : quand vous êtes malade, vous appelez d’abord un médecin. Si vous appelez le curé, c’est que vous êtes déjà certain de mourir… L’Église doit maintenir la morale, l’éthique, l’espoir – sinon l’homme deviendrait fou à l’idée de la mort ; il deviendrait fou de devoir sans cesse vivre avec cette idée. Mais si la religion reste seule, comme dernier rempart, face aux problèmes du monde, alors, oui, c’est dramatique. Si ce que vous dites est vrai, si les grandes espérances laïques ont disparu, il faut cependant, en dehors des Églises, qu’il subsiste aussi une croyance en l’homme. »
Oui, mais, pour croire en l’homme, ne faudrait-il pas d’abord qu’il soit crédible ? Or, à l’opposé de ce que disent les philosophes, l’époque de la Shoah n’est pas marquée par l’absence de Dieu, mais par l’absence de l’Homme.
Weitere Kostenlose Bücher