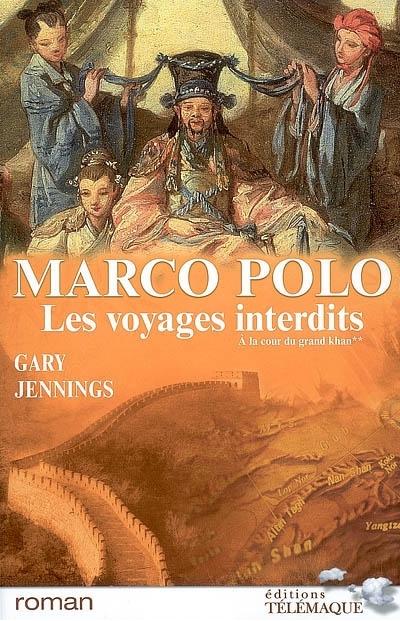![Marco Polo]()
Marco Polo
imperturbable
cheval et espérant qu’il était chaussé de ces sabots infaillibles (car ils ne
glissent jamais) que l’on sculpte dans les cornes des fameux « moutons de
Marco ». Que j’ouvrisse les yeux pour lancer un regard devant moi,
derrière, au-dessus, en dessous ou de quelque côté que ce fût, j’en éprouvais
instantanément le vertige. Vers l’amont comme vers l’aval, l’œil rencontrait
toujours le même spectacle : deux murs de roche grise convergeaient dans
le lointain vers une étroite fissure brillante bordée de vert. En haut, il
s’agissait d’un filet de ciel bordé d’arbres ; en bas, d’un ruisseau ourlé
de mousse, en réalité une rivière qui s’écoulait à travers la forêt. Devant
comme derrière moi, la route des Piliers semblait déjà trop fragile pour
soutenir son propre poids. Alors, imaginer qu’elle puisse supporter un cavalier,
et un convoi entier... D’un côté, la paroi menaçante, au ras de mon étrier,
semblait guetter le moment de me déséquilibrer d’une violente poussée, de
l’autre, sa jumelle, attirante, semblait si proche qu’on l’aurait volontiers
touchée... au risque d’un plongeon mortel dans l’insondable abîme.
La seule chose peut-être encore plus étourdissante que
la route des Piliers était le franchissement d’une gorge sur ce que les gens
des montagnes appelaient, sans exagérer, les « ponts mous ». Ceux-ci,
faits de planches et d’épaisses cordes de fibres de bambou, se balançaient au
gré des vents qui ne cessaient de souffler dans la montagne. Leur tangage
s’accentuait dès qu’un homme y posait le pied, et encore plus dès qu’il y
attirait derrière lui sa monture ; durant la traversée, je suis sûr que
même les chevaux fermaient les yeux.
Bien que les émissaires de Kubilaï aient fait le
nécessaire pour que tous les habitants des montagnes soient avertis de notre
arrivée et que nous ayons de ce fait toujours bénéficié du meilleur accueil de
leur part, celui-ci n’était pas toujours de qualité royale. Dans ce paysage
tourmenté, nous ne trouvâmes que rarement des lieux assez plats pour accueillir
ne serait-ce qu’un village de huttes de bûcherons. Le plus souvent, nous
passions la nuit dans l’une des niches creusées dans la falaise, aux endroits
assez larges pour que des voyageurs cheminant en sens opposé puissent nous
croiser. Là, de petits groupes d’hommes rudes, attendant notre venue, avaient
édifié une tente en poils de yack pour que nous y passions la nuit. Ils avaient
apporté un peu de viande ou abattu une chèvre des montagnes pour la faire cuire
au feu du camp.
Je me souviens fort bien de notre première escale,
dans le jour déclinant. Après nous avoir salués d’un ko-tou, les trois
montagnards entreprirent de nous préparer le repas. Nous ne pouvions converser,
car ils ne parlaient pas le mongol et s’exprimaient dans une langue différente
du han. Ils firent un feu, y mirent à crépiter quelques côtelettes de
chevrotain des montagnes (animal dont on tirait le précieux musc) et firent
chauffer une marmite d’eau. Je remarquai qu’ils avaient utilisé pour le feu des
branches d’arbres, qu’ils avaient dû avoir beaucoup de mal à récupérer en
escaladant les falaises et qu’ils gardaient à côté d’eux un petit tas de tiges
de bambou. Quand la viande fut cuite à point, l’obscurité était tombée, et
tandis que deux hommes nous servaient, le troisième jeta l’une de ces tiges sur
le brasier.
La viande de chevrotain était certes meilleure que
l’habituel mouton ou même la chèvre des montagnes, mais ce qu’on nous servit
avec était épouvantable. La pièce de viande me fut tendue en bloc, à charge
pour moi d’y mordre à belles dents. Le seul ustensile fourni était un bol de
bois peu profond dans lequel l’un des trois hommes me versa un thé vert fumant.
Mais à peine avais-je eu le temps d’en avaler une ou deux gorgées qu’un autre
me le prit poliment des mains pour y ajouter quelque chose. Tenant à la main un
plateau de beurre de yack parsemé d’un certain nombre de poils, de peluches de
tissu, d’une bonne dose de poussière de la route et strié des traces de doigts
de ceux qui y avaient pioché auparavant, il en préleva de ses ongles noirs une
portion qu’il jeta dans mon cha et l’y mélangea. Comme si le redoutable
beurre n’était pas en lui-même assez répugnant, il ouvrit un infect sac de
tissu et versa dans le bol une
Weitere Kostenlose Bücher